16/09/2024
Le Grand.
 L’ironie a voulu qu’on me prévienne au moment de l’exergue, quand on se demande à qui on va dédier le livre qu’on vient de boucler. En 50000 mots, petite coquetterie oulipienne. Auxquels il va falloir, à vie, ajouter les 27 qui disent ce que personne n’a encore dit publiquement, mais qui s’est transmis, dans la matinée, à la vitesse de l’éclair, parmi les amis qu’il comptait par milliers, ou plus, tant le Grand était un élément fédérateur de ce que tout Lyon recense dans le spectacle vivant. Un programmateur, un facilitateur, un gérant et un ami. Il a fallu, en plus de ça, qu’on m’apprenne qu’il était à Vaugneray, au Simplextival, vendredi, avec Lyne, qui en assurait le catering, mais qu’ils sont partis avant les concerts, avant que j’arrive, donc, moi qui me réjouissais de peut-être les voir, comme on les voit (un peu) partout quand Stéphane est par là. J’ai encore son message de la fin août, quand il comptait me mettre en relation avec Benjamin Biolay, parrain de la St Louis, comme ils en avaient convenu au Radiant, en février. Ça n’est jamais bon signe, quand on remonte les dates, ça pousserait presque à en parler au passé alors que l’actualité est tellement forte, chez lui, la Grèce, bientôt, la Corse, où deux maisons, dont une d’amis, les attendent, la Nouvelle-Calédonie, pour que Lyne se fasse faire les rougails-saucisses qu’elle n’a eu de cesse de faire pour les autres, à la Casa. Leur Casa. Je serai à vie le premier écrivain – sans trop de problèmes de vocabulaire – à utiliser le plus de fois ces trois mots, rougail-saucisse et Casa dans un recueil qu’il ne verra hélas pas, dont on aurait évidemment fêté la sortie là-bas, avant qu’ils vendent, avant qu’on en fasse un temps d’avant. C’était déjà dur de s’imaginer sans cet endroit qu’on a tellement fréquenté, pour eux comme pour ce qui s’y passait, c’est encore plus absurde d’imaginer qu’on ne le verra pas passer la tête pour surveiller si la prise de son s’y passe bien, que sa grande carcasse rassurante ne fera pas écho à la nôtre.
L’ironie a voulu qu’on me prévienne au moment de l’exergue, quand on se demande à qui on va dédier le livre qu’on vient de boucler. En 50000 mots, petite coquetterie oulipienne. Auxquels il va falloir, à vie, ajouter les 27 qui disent ce que personne n’a encore dit publiquement, mais qui s’est transmis, dans la matinée, à la vitesse de l’éclair, parmi les amis qu’il comptait par milliers, ou plus, tant le Grand était un élément fédérateur de ce que tout Lyon recense dans le spectacle vivant. Un programmateur, un facilitateur, un gérant et un ami. Il a fallu, en plus de ça, qu’on m’apprenne qu’il était à Vaugneray, au Simplextival, vendredi, avec Lyne, qui en assurait le catering, mais qu’ils sont partis avant les concerts, avant que j’arrive, donc, moi qui me réjouissais de peut-être les voir, comme on les voit (un peu) partout quand Stéphane est par là. J’ai encore son message de la fin août, quand il comptait me mettre en relation avec Benjamin Biolay, parrain de la St Louis, comme ils en avaient convenu au Radiant, en février. Ça n’est jamais bon signe, quand on remonte les dates, ça pousserait presque à en parler au passé alors que l’actualité est tellement forte, chez lui, la Grèce, bientôt, la Corse, où deux maisons, dont une d’amis, les attendent, la Nouvelle-Calédonie, pour que Lyne se fasse faire les rougails-saucisses qu’elle n’a eu de cesse de faire pour les autres, à la Casa. Leur Casa. Je serai à vie le premier écrivain – sans trop de problèmes de vocabulaire – à utiliser le plus de fois ces trois mots, rougail-saucisse et Casa dans un recueil qu’il ne verra hélas pas, dont on aurait évidemment fêté la sortie là-bas, avant qu’ils vendent, avant qu’on en fasse un temps d’avant. C’était déjà dur de s’imaginer sans cet endroit qu’on a tellement fréquenté, pour eux comme pour ce qui s’y passait, c’est encore plus absurde d’imaginer qu’on ne le verra pas passer la tête pour surveiller si la prise de son s’y passe bien, que sa grande carcasse rassurante ne fera pas écho à la nôtre.
J’ai aimé cet homme pour le calme qu’il dégageait, l’autorité qu’il savait manifester, quand il le fallait. Je l’ai vu fréquenter des gens (très) connus, d’autres non, sans aucune espèce de différence. Je crois pouvoir dire qu’il appréciait mon recul quant à ce système, qu’il comprenait pourquoi je disais non quand il me proposait d’aller voir l’artiste en loge, après son concert. Lui y allait parce qu’il ne faisait pas partie du décor, il l’était, le décor, par son flegme et le fait que l’artiste lui savait gré d’être là, de tout arranger pour que tout se passe bien. Il m’a envoyé vers son ami François Morel, à Sète, l’hiver dernier, je l’ai remercié pour les places, j’ai forcé ma nature pour aller saluer la vedette à la fin, j’ai aimé le sourire de cet homme quand je lui ai dit que je venais de sa part à lui, au Grand. Je ne suis pas de son premier cercle, mais on se retrouvait avec plaisir, je les revois chez moi – j’attendais qu’ils reviennent – ou, il n’y a pas longtemps, chez Jutard. Son grand ami Nilda est parti il y a bientôt cinq ans, ça n’était pas prévu qu’il le rejoigne si vite, qu’il nous laisse sans élément fédérateur, sans les dernières dates à la Casa dont la fin se reportait d’elle-même, faute d’avoir encore vendu la maison. Même sa chute dans une piscine sans eau – sans la mythologie rock’n’roll, il a toujours été dans le contrôle - les opérations du poignet qui ont suivi, ces dernières années, n’ont pas eu raison de son enthousiasme, l’ont peut-être poussé à lever le pied, à considérer autrement les années de retraite que Lyne et lui se sont patiemment fabriquées. Quoi de plus normal, finalement, que son trop gros cœur n’ait pas tenu ? Il y a beaucoup de tristesse chez ceux qu’il a laissé, les connus, les anonymes. Il faudra du temps et des artistes pour qu’elle se transforme. D’ici là, laissez-nous avec notre peine, et notre cœur à nous qui se serre.
15:00 Publié dans Blog | Lien permanent
14/09/2024
SIMPLEXSTIVAL.
 Ça aussi, c’est nouveau. Un éditeur de disques – à l’ancienne, vinyls, exclusivement, bandes oubliées et restaurées de groupes lyonnais (et alentours) qui ont eu leur heure de gloire – qui décide de faire une grande fête, d’inviter quelques-uns de ses poulains et, après tout, pourquoi pas, de donner son nom à ce nouveau festival en rase campagne, qui a avant tout l’avantage d’être…juste à côté de chez lui. Le 1er Simplextival - jusqu’aux programmes, on a cru à un canular – à Vaugneray, donc, compte trois groupes, dont un ne coûte pas cher en musiciens puisque Danilo – déjà vu au Tiki Vinyl Store – joue seul devant son rideau à lamelles argentées. Il est doué, Danilo[1], et ses chansonnettes, faussement légères, restent bien en tête, mériteraient de toucher plus qu’un VRP en goguette dans un hôtel de banlieue, histoire que lui aussi, comme il l’a fait il y a longtemps, se demande ce qu’il est en train de faire (ou de ne pas faire) de sa vie, en Méthadone ou ailleurs. Il a son très jeune fils qui fait le show dans la fosse, et ça tombe bien, ça libère des très nombreux photographes qui empêchent un peu le public d’avancer sur des morceaux aussi bons que Bienvenue en Enfer, ou de nouveaux titres, assez porteurs, un Qui aurait cru qu’une nuit blanche m’aurait guéri ? signifiant. Il terminera sur LMQR, la mélodie qui reste, en hommage à sa maman, aux chanteurs-crooners qu’elle écoutait et qu’il est devenu, pour elle. Danilo-Pétrier-(Fragments of) Factory, c’est une belle première affiche, sachant qu’on y va plutôt pour l’un que pour l’autre. On serait même en pleine battle de dinosaures, entre le Pétrier des Noz et ses 40 ans de scène et les encore plus vieux Puce et Matrat, leaders du groupe mythique de Givors Factory, alliés à la section rythmique du groupe lyonnais de power pop the Segments pour revisiter leur répertoire 1977-1980 et les titres de l’album L'Amérique à la casse, ressorti à l’occasion chez Simplex Records. Du rock dur comme l’aime l’Eddy Barclay valnégrien, qui dénote un peu avec la douceur des deux premiers impétrants, qui savent durcir le ton, néanmoins, quand il le faut. Et qui a, quand on parle de Pétrier, le matos pour, sur scène, avec sa session rythmique de l’homme coupé en deux (Simon/Habouzit, en relation visuelle permanente), le synthé et les choeurs de Mathieu Larue, les cuivres de Samuelle de Jesus Pires – quelle entrée trompette/batterie sur Houdini II ! - et le son cristallin de l’éternel acolyte Éric Clapot (et son nouvel ampli), celui qui lui a permis d’aller au bout d’un projet qu’il voulait tenir du début à la fin, à son idée. C’est toujours drôle de voir débarquer Pétrier, ses idées loufoques qu’il met en disque ou en romans, dans le monde du rock’n’roll dur, parce que la finalité n’est pas la même quand il faut faire bouger les popotins ou quand il s’agit de chercher l’équilibre entre le récit – LCED est là encore un roman musical – et la mélodie, l’abandon. Oh, à terme, il a l’habitude, et l’autorité, pour tenir sa place (bien souvent mieux que les autres), mais au départ, ça n’est jamais gagné. Comme tout, remarque. Le voilà qui débarque avec ses copains, sur une grande scène – Éric dira qu’il avait du mal à trouver Damien, pourtant imposant, du regard - il a la charge de passer après la belle prestation de Danilo, son aquoibonisme contagieux, et d’ouvrir pour un groupe dont le public aurait cloué ses Noz au pilori, il y a quarante ans. Sans doute se demande-t-il, comme à chaque fois, les raisons qui le poussent à se mettre en danger, mais le refrain est connu de tous ceux qui le suivent : un bonjour poli, la main dans les cheveux, le micro saisi à deux mains dans un angle des coudes parfaitement réglé, et c’est parti. Une heure pour raconter une histoire, la grande vie d’Houdini (Pétrier lui a consacré deux morceaux, pour épater sa fille, qui lui disait que Kaaris lui avait déjà dédié un titre, sans qu’aucun ne puisse présumer qu'Eminem en ferait, récemment, le single le plus écouté sur la toile…), le lien qu’il a développé avec son frère, les secrets de ses tours les plus célèbres, dont le titre du disque. Du livre-disque, comme ceux qu’on dévorait enfant dans le mange-disque familial. Il faudrait savoir la part des fantasmes enfantins dans la réalisation de ces projets d’adultes, dans le fait de développer autant d’énergie et d’application – au sens antique, les jeunes, quand le mot désignait qu’on allait prendre le temps, pas qu’on allait en gagner à tout prix – pour aller au bout de choses bien anachroniques qu’assez peu de gens, en somme, regardent d’un air poli. Et un poil consterné. Heureusement qu’il en reste des comme ça, des rêveurs, parce qu’on serait bien étriqué, dans nos vies bien calmes. Pas sûr que les rêveries de son Altesse soient du même acabit que celles des Factory, leur comédie musicale sur des textes de Manchette, leur reprise reggae de À la claire fontaine chez Drucker quand les Noz étaient en 4e, les deux morceaux qu’ils ont composés pour le film Le Bahut va craquer, puisqu’on en parle. Mais aussi, récemment, la parution des 11 titres inédits de L'Amérique à la casse, enregistré en 1977 et remasterisé par Simplex Records. Dont ce Flying From The Hairy Stars qui ne peut laisser indifférent les aficionados du mythique gang givordin et les amateurs de rock qui racle et roule, dit le maître des lieux lui-même. Qu’on peut croire mais pas forcément suivre, dans mon cas : litote inside. Moi je suis venu voir comment allait se comporter l’homme coupé en deux au milieu (c’est le mot) de ce cirque-là, pas forcément le sien. Avec un public pas nécessairement venu pour lui, de fait, qui reconnait peut-être Denis Simon parce qu’il a un jour pété les tympans de tout le public du Pez-ner lors d’un concert de rupture avec les Syoodj ou parce qu’il joue (aussi) avec les Slaughter & the dogs, qui leur correspond davantage, en amont, que l’éternel ado hirsute qui secoue sa crinière pour se donner du courage et entamer sa sérénade. L’histoire, une fois encore, de Johnny Eck, né sans jambes, avec une colonne vertébrale en miettes et un torse atrophié, condamné à autant de contorsions sociales que circassiennes et célèbre pour son numéro d’homme coupé en deux. Paradoxe, sur scène, dans un tel festival, celui qui chante cette histoire-là n’a pas de truc, pas de faux-fond dans la malle, il faut donner tout de suite pour que ça prenne. Pas d’illusion, dans le rock n’roll, sinon celle qui s’empare de vous quand on commence ou quand on ne sait pas suffisamment se juger, après le show. Son Je ne dors jamais intrigue les oreilles venues écouter autre chose, il est pêchu et interroge sur les mystères de la création, de l’imaginaire qu’on subit, quand le cerveau tourne à 3000 la nuit, toujours pour envisager le pire. LHCED déroule, Stéphane s’excuse auprès de son producteur et de son batteur d’avoir écrit St Etienne – le morceau – mais le joue avec force, s’excuse d’être parfois un peu déconnecté à l’autre bout du monde mais le défend musicalement via son avatar, les Beaux restes, en full band, confirme son titre de tube interplanétaire : une chanson écrite pour un ami qui est parti, et aussi pour ceux qui sont restés et qui ont la chance de continuer ce truc époustouflant, merveilleux, dramatique et ébouriffant qu’est la vie, annonce Pétrier. Il y a Nu dans la crevasse – pardon, sur le rond-point – au tambourin, un morceau inédit, l’anachronique et oulipesque pour un rien joué en acoustique, au tabouret et le groupe entier pour finir sur Besoin de personne, la plus belle contre-vérité jamais chantée, surtout quand on attend tout du public. Une trois-centaine de personnes, venues, je l’ai dit, pour des raisons différentes, qui auront supporté, dans la deuxième partie de soirée, l’absence de sièges ailleurs que dans la salle, l’évaporation ultra-rapide du blanc au bar et le fait que personne n’ait même touché l’album d’Aurelia Kreit, en vente avec les autres productions Simplex. Une belle soirée néanmoins, dans cette salle de l’Intervalle au son & lumière parfait, peut-être (encore) un peu grande pour autre chose que du très connu et très commun. Mais son atrium, pour finir, valait peut-être davantage que la salle, pour les visages connus, les histoires qui remontent, les promesses qu’on se fait – comme dans les enterrements, dira Guillaume. Évidemment, le froid glacial et l’attente de Jo – pas inintéressant – auront raison de mes derniers anticorps et me vaudront un rappel courroucé du producteur à l’oreillette, à 8h20. Il doit être content, on l’est pour lui : ça n’est pas tous les jours qu’on inaugure un festival, qu’on crée un rendez-vous.
Ça aussi, c’est nouveau. Un éditeur de disques – à l’ancienne, vinyls, exclusivement, bandes oubliées et restaurées de groupes lyonnais (et alentours) qui ont eu leur heure de gloire – qui décide de faire une grande fête, d’inviter quelques-uns de ses poulains et, après tout, pourquoi pas, de donner son nom à ce nouveau festival en rase campagne, qui a avant tout l’avantage d’être…juste à côté de chez lui. Le 1er Simplextival - jusqu’aux programmes, on a cru à un canular – à Vaugneray, donc, compte trois groupes, dont un ne coûte pas cher en musiciens puisque Danilo – déjà vu au Tiki Vinyl Store – joue seul devant son rideau à lamelles argentées. Il est doué, Danilo[1], et ses chansonnettes, faussement légères, restent bien en tête, mériteraient de toucher plus qu’un VRP en goguette dans un hôtel de banlieue, histoire que lui aussi, comme il l’a fait il y a longtemps, se demande ce qu’il est en train de faire (ou de ne pas faire) de sa vie, en Méthadone ou ailleurs. Il a son très jeune fils qui fait le show dans la fosse, et ça tombe bien, ça libère des très nombreux photographes qui empêchent un peu le public d’avancer sur des morceaux aussi bons que Bienvenue en Enfer, ou de nouveaux titres, assez porteurs, un Qui aurait cru qu’une nuit blanche m’aurait guéri ? signifiant. Il terminera sur LMQR, la mélodie qui reste, en hommage à sa maman, aux chanteurs-crooners qu’elle écoutait et qu’il est devenu, pour elle. Danilo-Pétrier-(Fragments of) Factory, c’est une belle première affiche, sachant qu’on y va plutôt pour l’un que pour l’autre. On serait même en pleine battle de dinosaures, entre le Pétrier des Noz et ses 40 ans de scène et les encore plus vieux Puce et Matrat, leaders du groupe mythique de Givors Factory, alliés à la section rythmique du groupe lyonnais de power pop the Segments pour revisiter leur répertoire 1977-1980 et les titres de l’album L'Amérique à la casse, ressorti à l’occasion chez Simplex Records. Du rock dur comme l’aime l’Eddy Barclay valnégrien, qui dénote un peu avec la douceur des deux premiers impétrants, qui savent durcir le ton, néanmoins, quand il le faut. Et qui a, quand on parle de Pétrier, le matos pour, sur scène, avec sa session rythmique de l’homme coupé en deux (Simon/Habouzit, en relation visuelle permanente), le synthé et les choeurs de Mathieu Larue, les cuivres de Samuelle de Jesus Pires – quelle entrée trompette/batterie sur Houdini II ! - et le son cristallin de l’éternel acolyte Éric Clapot (et son nouvel ampli), celui qui lui a permis d’aller au bout d’un projet qu’il voulait tenir du début à la fin, à son idée. C’est toujours drôle de voir débarquer Pétrier, ses idées loufoques qu’il met en disque ou en romans, dans le monde du rock’n’roll dur, parce que la finalité n’est pas la même quand il faut faire bouger les popotins ou quand il s’agit de chercher l’équilibre entre le récit – LCED est là encore un roman musical – et la mélodie, l’abandon. Oh, à terme, il a l’habitude, et l’autorité, pour tenir sa place (bien souvent mieux que les autres), mais au départ, ça n’est jamais gagné. Comme tout, remarque. Le voilà qui débarque avec ses copains, sur une grande scène – Éric dira qu’il avait du mal à trouver Damien, pourtant imposant, du regard - il a la charge de passer après la belle prestation de Danilo, son aquoibonisme contagieux, et d’ouvrir pour un groupe dont le public aurait cloué ses Noz au pilori, il y a quarante ans. Sans doute se demande-t-il, comme à chaque fois, les raisons qui le poussent à se mettre en danger, mais le refrain est connu de tous ceux qui le suivent : un bonjour poli, la main dans les cheveux, le micro saisi à deux mains dans un angle des coudes parfaitement réglé, et c’est parti. Une heure pour raconter une histoire, la grande vie d’Houdini (Pétrier lui a consacré deux morceaux, pour épater sa fille, qui lui disait que Kaaris lui avait déjà dédié un titre, sans qu’aucun ne puisse présumer qu'Eminem en ferait, récemment, le single le plus écouté sur la toile…), le lien qu’il a développé avec son frère, les secrets de ses tours les plus célèbres, dont le titre du disque. Du livre-disque, comme ceux qu’on dévorait enfant dans le mange-disque familial. Il faudrait savoir la part des fantasmes enfantins dans la réalisation de ces projets d’adultes, dans le fait de développer autant d’énergie et d’application – au sens antique, les jeunes, quand le mot désignait qu’on allait prendre le temps, pas qu’on allait en gagner à tout prix – pour aller au bout de choses bien anachroniques qu’assez peu de gens, en somme, regardent d’un air poli. Et un poil consterné. Heureusement qu’il en reste des comme ça, des rêveurs, parce qu’on serait bien étriqué, dans nos vies bien calmes. Pas sûr que les rêveries de son Altesse soient du même acabit que celles des Factory, leur comédie musicale sur des textes de Manchette, leur reprise reggae de À la claire fontaine chez Drucker quand les Noz étaient en 4e, les deux morceaux qu’ils ont composés pour le film Le Bahut va craquer, puisqu’on en parle. Mais aussi, récemment, la parution des 11 titres inédits de L'Amérique à la casse, enregistré en 1977 et remasterisé par Simplex Records. Dont ce Flying From The Hairy Stars qui ne peut laisser indifférent les aficionados du mythique gang givordin et les amateurs de rock qui racle et roule, dit le maître des lieux lui-même. Qu’on peut croire mais pas forcément suivre, dans mon cas : litote inside. Moi je suis venu voir comment allait se comporter l’homme coupé en deux au milieu (c’est le mot) de ce cirque-là, pas forcément le sien. Avec un public pas nécessairement venu pour lui, de fait, qui reconnait peut-être Denis Simon parce qu’il a un jour pété les tympans de tout le public du Pez-ner lors d’un concert de rupture avec les Syoodj ou parce qu’il joue (aussi) avec les Slaughter & the dogs, qui leur correspond davantage, en amont, que l’éternel ado hirsute qui secoue sa crinière pour se donner du courage et entamer sa sérénade. L’histoire, une fois encore, de Johnny Eck, né sans jambes, avec une colonne vertébrale en miettes et un torse atrophié, condamné à autant de contorsions sociales que circassiennes et célèbre pour son numéro d’homme coupé en deux. Paradoxe, sur scène, dans un tel festival, celui qui chante cette histoire-là n’a pas de truc, pas de faux-fond dans la malle, il faut donner tout de suite pour que ça prenne. Pas d’illusion, dans le rock n’roll, sinon celle qui s’empare de vous quand on commence ou quand on ne sait pas suffisamment se juger, après le show. Son Je ne dors jamais intrigue les oreilles venues écouter autre chose, il est pêchu et interroge sur les mystères de la création, de l’imaginaire qu’on subit, quand le cerveau tourne à 3000 la nuit, toujours pour envisager le pire. LHCED déroule, Stéphane s’excuse auprès de son producteur et de son batteur d’avoir écrit St Etienne – le morceau – mais le joue avec force, s’excuse d’être parfois un peu déconnecté à l’autre bout du monde mais le défend musicalement via son avatar, les Beaux restes, en full band, confirme son titre de tube interplanétaire : une chanson écrite pour un ami qui est parti, et aussi pour ceux qui sont restés et qui ont la chance de continuer ce truc époustouflant, merveilleux, dramatique et ébouriffant qu’est la vie, annonce Pétrier. Il y a Nu dans la crevasse – pardon, sur le rond-point – au tambourin, un morceau inédit, l’anachronique et oulipesque pour un rien joué en acoustique, au tabouret et le groupe entier pour finir sur Besoin de personne, la plus belle contre-vérité jamais chantée, surtout quand on attend tout du public. Une trois-centaine de personnes, venues, je l’ai dit, pour des raisons différentes, qui auront supporté, dans la deuxième partie de soirée, l’absence de sièges ailleurs que dans la salle, l’évaporation ultra-rapide du blanc au bar et le fait que personne n’ait même touché l’album d’Aurelia Kreit, en vente avec les autres productions Simplex. Une belle soirée néanmoins, dans cette salle de l’Intervalle au son & lumière parfait, peut-être (encore) un peu grande pour autre chose que du très connu et très commun. Mais son atrium, pour finir, valait peut-être davantage que la salle, pour les visages connus, les histoires qui remontent, les promesses qu’on se fait – comme dans les enterrements, dira Guillaume. Évidemment, le froid glacial et l’attente de Jo – pas inintéressant – auront raison de mes derniers anticorps et me vaudront un rappel courroucé du producteur à l’oreillette, à 8h20. Il doit être content, on l’est pour lui : ça n’est pas tous les jours qu’on inaugure un festival, qu’on crée un rendez-vous.
[1] Il les lâche, ses chansons, sur la route, sur les différents dépits que la vie propose au fur et à mesure qu’on s’y coltine. Dans Méthadone, il y a cette voix qui lui répond – c’est sans doute sa chérie, elle est dans la bonne cinquantaine de jeunes qui ont peuplé l’endroit : (tu reviendras) je ne reviendrai pas (tu reviendras) nan, il nique la panique, parmi les nombreuses interjections qui ponctuent son show, il se décrit lui-même quasi-ingénieur en quête de contrats se demandant ce qu’il fait là et s’imposant, pour survivre, sa première composition, Danilo, avec son look anachronique d’Elno ressurgi de nulle part s’étonne en permanence d’être là, d’avoir été signé, à l’ancienne, de pouvoir montrer ce qu’il sait faire et quand il aura définitivement cessé de le faire, ses chansons gagneront encore, comme sur disque, où la production et le spectre musical impressionnent. CDT 26.01.2024
09:55 Publié dans Blog | Lien permanent
10/09/2024
JOURDOTHÈQUE (10/10)
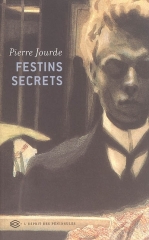 Dans Festins screts, sorti là aussi il y a bientôt vingt ans, Pierre Jourde entrecroise des histoires liées à un seul et même destin, celui d’un agrégé de Lettres stagiaire qui va connaître sa première affectation – à 1200€ - dans un collège prioritaire de Logres, dans le Nord. Une ville qui n’existe pas, dans la réalité, mais dont la sémantique – la géographie symbolique - n’échappe pas à l’aspirant-fonctionnaire, pour qui le premier trajet, déjà, est éloquent. Il croise, dans le compartiment, un vieil homme qui pourrait être son double, qui a enseigné là-bas, n’a jamais su en sortir mais y revient tout de même. Il en dresse un tableau apocalyptique, concentrationnaire, parle d’une ville délétère qui, intimement, pue. Il l’avertit (à votre place, je fuirais tout de suite) puis se dissipe, laissant place à une famille de dégénérés qui ne fait que relever la lâcheté latente de l’homme – Gilles Saurat – qui prend sa mutation comme une semi-vérité sans fondement, voire l’opportunité de se débarrasser de la femme qu’il n’aime plus mais à qui il n’ose le dire. Ses premiers pas au collège Prévert sont l’occasion, pour Jourde, de dresser un portrait au vitriol des fossés entre réalité sociale et discours pédagogiste – entre sigles, acronymes, évaluations et propos sur l’inénarrable bienveillance. Son personnage, que le narrateur interpelle dans l’énonciation, croise des professeurs devenus de vieux acteurs oubliés par leur public,les corps tristes de vieux soutiers de la pédagogie. Tu as trouvé là ton enfer. Pour l’éternité, lui assène-t-on, alors qu’il croise Zablanski, le prof d’histoire, un Cioran des collèges qui lui décrit, avec cynisme et détachement, une apocalypse miniature. Il sera question, néanmoins, de violences permanentes – jusqu’au meurtre, dans la Cité voisine - de harcèlement, d’antisémitisme. Et de la cohabitation silencieuse de la plèbe et des notables de la ville, que Saurat rencontre chez sa logeuse, Mme Van Reeth, veuve d’un grand collectionneur qui fit des envieux et des jaloux, au point que sa noyade est restée un mystère, au même titre que son implication – à titre de témoin – dans l’Affaire des disparues de la Côte du Soleil. Il en faut peu pour que cette bourgeoisie, que Jourde traite à la Balzac - dans des scènes de dîners pour lesquels on le charge de faire l’homme de maison - attire la curiosité du personnage, fasciné par leur attraction pour le Mal, leur envie avouée de le réintroduire pour le neutraliser, pour cette ville qui, dit-on, se nourrit de fictions.
Dans Festins screts, sorti là aussi il y a bientôt vingt ans, Pierre Jourde entrecroise des histoires liées à un seul et même destin, celui d’un agrégé de Lettres stagiaire qui va connaître sa première affectation – à 1200€ - dans un collège prioritaire de Logres, dans le Nord. Une ville qui n’existe pas, dans la réalité, mais dont la sémantique – la géographie symbolique - n’échappe pas à l’aspirant-fonctionnaire, pour qui le premier trajet, déjà, est éloquent. Il croise, dans le compartiment, un vieil homme qui pourrait être son double, qui a enseigné là-bas, n’a jamais su en sortir mais y revient tout de même. Il en dresse un tableau apocalyptique, concentrationnaire, parle d’une ville délétère qui, intimement, pue. Il l’avertit (à votre place, je fuirais tout de suite) puis se dissipe, laissant place à une famille de dégénérés qui ne fait que relever la lâcheté latente de l’homme – Gilles Saurat – qui prend sa mutation comme une semi-vérité sans fondement, voire l’opportunité de se débarrasser de la femme qu’il n’aime plus mais à qui il n’ose le dire. Ses premiers pas au collège Prévert sont l’occasion, pour Jourde, de dresser un portrait au vitriol des fossés entre réalité sociale et discours pédagogiste – entre sigles, acronymes, évaluations et propos sur l’inénarrable bienveillance. Son personnage, que le narrateur interpelle dans l’énonciation, croise des professeurs devenus de vieux acteurs oubliés par leur public,les corps tristes de vieux soutiers de la pédagogie. Tu as trouvé là ton enfer. Pour l’éternité, lui assène-t-on, alors qu’il croise Zablanski, le prof d’histoire, un Cioran des collèges qui lui décrit, avec cynisme et détachement, une apocalypse miniature. Il sera question, néanmoins, de violences permanentes – jusqu’au meurtre, dans la Cité voisine - de harcèlement, d’antisémitisme. Et de la cohabitation silencieuse de la plèbe et des notables de la ville, que Saurat rencontre chez sa logeuse, Mme Van Reeth, veuve d’un grand collectionneur qui fit des envieux et des jaloux, au point que sa noyade est restée un mystère, au même titre que son implication – à titre de témoin – dans l’Affaire des disparues de la Côte du Soleil. Il en faut peu pour que cette bourgeoisie, que Jourde traite à la Balzac - dans des scènes de dîners pour lesquels on le charge de faire l’homme de maison - attire la curiosité du personnage, fasciné par leur attraction pour le Mal, leur envie avouée de le réintroduire pour le neutraliser, pour cette ville qui, dit-on, se nourrit de fictions.
Peu à peu, il va sortir, clandestinement, de l’espace qu’on lui a alloué, dans la maison, dans la forêt proche aussi, dans laquelle ses virées nocturnes l’emmènent à l’irréalité d’une présence dont il tombe amoureux, scénario étrangement prévu et retrouvé dans l’ordinateur de M. Van Reeth, écrit…trois ans avant qu’il arrive en ville. Comme s’il y avait une fatalité dans cette géhenne et qu’il n’y échappait pas. Un pandémonium, un dossier Gérien, une sirène dans la sylve cachée et le lien qui se fait entre toutes les histoires. Il n’y a pas d’autre vie que celle des nuits dans la forêt, se dit-il, au moment où se propre réalité se joue, dans les couloirs d’une administration kafkaienne ou dans les renoncements auxquels on le destine (tu comprends vite que tu ne parviendras à rien enseigner). On envisage les bacchanales des notables comme les sauvageries des enfants perdus, qui ne sauront jamais qui est Jean Bijoux – l’avatar de Sollers, vraisemblablement- mais regrettent collectivement qu’Hitler n’en ait eu que 6 millions. La fatalité qui colle aux victimes, au point qu’elles s’associent aux bourreaux pour s’acheter une paix sociale, est une des grandes pistes de réflexion du livre, qui n’en manque pas. La discussion, qui se poursuit au café, entre le prof d’histoire, Zablanski, et le jeune lettré encore idéaliste, résonne étrangement, vingt ans après, quand il est question des crimes d’honneur, des délits de fuite, des victimes de l’exclusion dont Z. dit qu’ils sont en fait les Dieux de leur famille, qui ont décrété que si le monde ne ressemble pas assez à Maman, alors il faut laver le sacrilège, à tout prix. La culture de l’excuse, évoquée via Hegel ou Girard, son bouc émissaire. On a eu la dureté dans des sociétés contraignantes, on a l’indulgence dans une société de liberté, assène l’historien, qui montre par l’exemple qu’il est désormais impossible d’emmener des élèves radicalisés visiter un mémorial de la déportation juive. Si les récits se croisent, dans la culture du secret des uns et l’acculturation de la masse des autres, c’est que Jourde veut montrer que les premiers – les maîtres, les favorisés – sont aussi morts que les autres, les asservis. Que Logres, qui porte bien son nom, est une ville-Moloch, qui retient son agent dès qu’il veut la quitter, et dont les habitants ne s’animent qu’en présence de celui qu’elle a accroché. Un piège, une plante carnivore, dit-on, sans qu’il en ressente, dans un premier temps, d’autre symptôme que l’innocuité de la pensée, quand la mort de sa mère, par exemple, l’emmène à se demander si elle a jamais existé. Les fantômes sur les faux quais de gare, lors du voyage initial, auraient dû l’avertir, mais c’est un voyage sans fin – sans heure d’arrivée non plus – qui engloutira sa thèse, repère ironique d’un ancien temps, lui a déjà échoué à faire l’écrivain. Les figures des repas chez Mme Van Reeth sont imbriquées l’une à l’autre par les histoires et les secrets, soigneusement consignés dans l’ordinateur du défunt, auxquels il faudra néanmoins accoler une réalité, que Saurat fuit de lui-même : il y retrouve la fille du train, l’ancien professeur, également, qu’on accusa de pédophilie. C’est l’âme noire de la ville que Van Reeth a consignée. La suite, la fin, l’analepse, appartiennent au roman lui-même : il convient de savoir si le supplicié s’en sort, s’il y a une issue dans ces enfers croisés.
On peut se féliciter, à la lecture de cet ouvrage massif, dense, parfois délité, d’avoir vécu une première affectation plutôt tranquille, en 1993. Naïve, sans doute, sans conscience du zablanskisme, sur le seul terrain de l’Éducation Nationale, étrillée façon puzzle. Les âmes damnées des petites communes, pour autant, n’ont jamais été aussi actuelles, dans leurs agissements, leurs réseaux et leurs cadavres – réels ou pas – dans des placards qu’on n’en finit pas de fermer.
18:45 Publié dans Blog | Lien permanent
03/09/2024
JOURDOTHÈQUE (9/10)
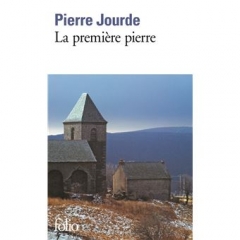 Pays perdu ayant eu, un an après sa parution – le temps qu’il arrive au village – l’impact (sans jeu de mots) qu’il a eu, il a fallu dix ans à Pierre Jourde pour en faire l’exégèse, dans un livre, la première pierre, qui relate les faits, leur naissance, les conséquences juridiques et humaine d’un roman qu’il continue de défendre comme une ode à la paysannerie, à la rusticité et aux histoires qui font un village avant que le village lui-même cherche des histoires. Et pas qu’un peu : la première pierre fait le récit, dans un premier temps, d’une embuscade davantage que d’une altercation qui aurait mal tourné. Entre guerre mortelle et brouille, s’interroge le narrateur, qui questionne l’auteur qui n’est autre que lui-même. Il y voit un malentendu entre les deux extrêmes, Paris et là-haut, sans se résoudre à ce qu’on le limite au premier, lui pour qui l’insulte suprême, dans la rixe, aura été de s’entendre dire tu n’es pas d’ici, de la bouche même de celui à qui il a confié la gestion de sa ferme et de ses terrains. Ça aurait pu en rester là, et déboucher sur une poignée de mains, de celles qu’on donne après une bagarre de bal ou de bistrot, quand les coups accentuent la conscience que ça n’en valait pas la peine. Mais c’est allé beaucoup plus loin, parce que cette embuscade, Jourde y a mêlé – pauvre idiot, s’insulte-t-il, réroactivement – sa femme et ses trois enfants, dont un d’un an. Étrangers à la brutalité, la violence qui font la dureté de la vie, là-bas, cette rudesse consubstantielle à ce que tu aimais là-haut, s’interpelle-t-il. Jourde reproche au gentil petit bonhomme en lui de ne pas avoir appréhendé la situation, d’avoir été naïf : il fallait que tu rentres chez toi, chez eux, écrit-il, que tu ailles remuer cette vieille réserve de merde qui est ton origine, à toi aussi, mais dont la narration sera jugée comme diffamatoire. Le malentendu – l’objet de l’ouvrage – connaîtra des étapes qui, habituellement, ne sortent jamais du village : les plaintes, les dépositions, le procès, le régal des journalistes. Parce qu’une des parties est allée trop loin, pour qu’on ne considère que la fiction, celle que le village engendre, celle qu’il compose, pour qu’on les démêle et les rapproche de la vie, dit-il. Il y eut, au-delà des insultes visant le père, un supposé adultère, des propos envers l’origine des enfants – traités de bicots, de sales arabes – une menace sur eux qui dépasse l’irréalité des coups, la simplicité épique d’une séance rurale de bourre-pifs. Heureusement que les chiens, écrit Jourde, ne savent pas où donner de la rage, eux qui ont réussi à chasser un jour un Chevillard en visite estivale. Heureusement que les pierres n’ont lapidé qu’en surface – le plus petit, le moins armé – dans cette séance de haine en soi, générant, ensuite, face à l’autorité, deux récits contradictoires, dont l’un sera facilement défait, mais se protégera devant le talent de l’autre à user des mots. Naulleau, l’éditeur, restera bouche bée, ne voyant toujours dans Pays perdu qu’un hommage émouvant à la paysannerie ; en tout cas rien qui puisse provoquer un tel déferlement de haine. La première pierre pose la question du pouvoir de la littérature, mais se heurte au réel, vite : ce livre que tous ont condamné – en dehors des quelques justes qui l’auront sauvé, par leur témoignage courageux - nombreux sont qui ne l’ont pas lu, qui en ont lu quelques pages, qui n’y ont rien compris. Rien qui justifie une tentative d’assassinat – ce sur quoi le tribunal (d’Aurillac) aura à statuer – mais tout qui provoque, dans ce roman-codicille, une irréalité, encore, proche de la parodie, mais présidée par la rudesse que tu aimes, se convainc-t-il, par tout ce qui te hait et te rejette au cœur même de ce que tu aimes. Jourde n’en démord pas, Pays perdu est un hommage, dont on n’aurait pas parlé sans les blessures et les traumatismes des enfants. Sans la charge du réel : ceux dont il disait qu’ils n’étaient que peu, il n’a pas assez dit, sans doute, qu’ils n’étaient pas que cela ; que lui-même était son père, retrouvé dans l’histoire des mûres. Sans les hypothèses généalogiques dont le village s’est toujours chargé, et qu’on lui reproche d’avoir relevé. On l’accuse : tu n’aurais pas dû dire qu’on était un pays de merde, ce qu’il n’a jamais dit. S’il a retracé la merde qui l’entoure, par tonnes, c’est – c’était – pour en souligner la beauté, sauvage. Lui-même, dit-il, a construit sa réminiscence (proustienne) en tombant dans une fosse à purin, à 14 ans : on a le Combray que l’on peut. L’important, c’est le tabou, écrit-il, celui du secret – et de sa fiction - celui de Lucie, qu’il a portée dans sa tombe, celui de son père, qui le ramène à cet étonnement d’enfant qu’il n’aurait jamais voulu quitter. Qui le pousse à écrire la dernière partie au présent de narration, même si des belligérants sont morts, même s’ils ont laissé une loi poussant les autres – y compris les nouveaux – à faire comme s’il n’existait pas. La première pierre se termine pourtant par des souvenirs poignants d’estives ou de montades, par une topographie experte de la région, une connaissance pointue de ses vaches – les Salers, les Aubrac ou les simples laitières – et des coutumes locales : à chaque estive, on sort le troupeau inépuisable des histoires, écrit-il, comme pour se dédouaner après de l’avoir fait lui. On jurerait que l’auteur rêve d’une réconciliation autour d’un verre, mais le temps a passé, là aussi, et dans ces contrées, il ne passe jamais par l’oubli. Et surtout pas par le sang d’un gamin d’un an. Il restera le salaud, le pestiféré, le méchant, on le considérera comme un fantôme, une non-présence, mais même dans la condition de fantôme, se contente-t-il, il y a des joies. Et s’ils le rejettent, après tout, c’est qu’il est l’un des leurs : il faut bien une fonction sociale, au village. Chez lui, pleinement.
Pays perdu ayant eu, un an après sa parution – le temps qu’il arrive au village – l’impact (sans jeu de mots) qu’il a eu, il a fallu dix ans à Pierre Jourde pour en faire l’exégèse, dans un livre, la première pierre, qui relate les faits, leur naissance, les conséquences juridiques et humaine d’un roman qu’il continue de défendre comme une ode à la paysannerie, à la rusticité et aux histoires qui font un village avant que le village lui-même cherche des histoires. Et pas qu’un peu : la première pierre fait le récit, dans un premier temps, d’une embuscade davantage que d’une altercation qui aurait mal tourné. Entre guerre mortelle et brouille, s’interroge le narrateur, qui questionne l’auteur qui n’est autre que lui-même. Il y voit un malentendu entre les deux extrêmes, Paris et là-haut, sans se résoudre à ce qu’on le limite au premier, lui pour qui l’insulte suprême, dans la rixe, aura été de s’entendre dire tu n’es pas d’ici, de la bouche même de celui à qui il a confié la gestion de sa ferme et de ses terrains. Ça aurait pu en rester là, et déboucher sur une poignée de mains, de celles qu’on donne après une bagarre de bal ou de bistrot, quand les coups accentuent la conscience que ça n’en valait pas la peine. Mais c’est allé beaucoup plus loin, parce que cette embuscade, Jourde y a mêlé – pauvre idiot, s’insulte-t-il, réroactivement – sa femme et ses trois enfants, dont un d’un an. Étrangers à la brutalité, la violence qui font la dureté de la vie, là-bas, cette rudesse consubstantielle à ce que tu aimais là-haut, s’interpelle-t-il. Jourde reproche au gentil petit bonhomme en lui de ne pas avoir appréhendé la situation, d’avoir été naïf : il fallait que tu rentres chez toi, chez eux, écrit-il, que tu ailles remuer cette vieille réserve de merde qui est ton origine, à toi aussi, mais dont la narration sera jugée comme diffamatoire. Le malentendu – l’objet de l’ouvrage – connaîtra des étapes qui, habituellement, ne sortent jamais du village : les plaintes, les dépositions, le procès, le régal des journalistes. Parce qu’une des parties est allée trop loin, pour qu’on ne considère que la fiction, celle que le village engendre, celle qu’il compose, pour qu’on les démêle et les rapproche de la vie, dit-il. Il y eut, au-delà des insultes visant le père, un supposé adultère, des propos envers l’origine des enfants – traités de bicots, de sales arabes – une menace sur eux qui dépasse l’irréalité des coups, la simplicité épique d’une séance rurale de bourre-pifs. Heureusement que les chiens, écrit Jourde, ne savent pas où donner de la rage, eux qui ont réussi à chasser un jour un Chevillard en visite estivale. Heureusement que les pierres n’ont lapidé qu’en surface – le plus petit, le moins armé – dans cette séance de haine en soi, générant, ensuite, face à l’autorité, deux récits contradictoires, dont l’un sera facilement défait, mais se protégera devant le talent de l’autre à user des mots. Naulleau, l’éditeur, restera bouche bée, ne voyant toujours dans Pays perdu qu’un hommage émouvant à la paysannerie ; en tout cas rien qui puisse provoquer un tel déferlement de haine. La première pierre pose la question du pouvoir de la littérature, mais se heurte au réel, vite : ce livre que tous ont condamné – en dehors des quelques justes qui l’auront sauvé, par leur témoignage courageux - nombreux sont qui ne l’ont pas lu, qui en ont lu quelques pages, qui n’y ont rien compris. Rien qui justifie une tentative d’assassinat – ce sur quoi le tribunal (d’Aurillac) aura à statuer – mais tout qui provoque, dans ce roman-codicille, une irréalité, encore, proche de la parodie, mais présidée par la rudesse que tu aimes, se convainc-t-il, par tout ce qui te hait et te rejette au cœur même de ce que tu aimes. Jourde n’en démord pas, Pays perdu est un hommage, dont on n’aurait pas parlé sans les blessures et les traumatismes des enfants. Sans la charge du réel : ceux dont il disait qu’ils n’étaient que peu, il n’a pas assez dit, sans doute, qu’ils n’étaient pas que cela ; que lui-même était son père, retrouvé dans l’histoire des mûres. Sans les hypothèses généalogiques dont le village s’est toujours chargé, et qu’on lui reproche d’avoir relevé. On l’accuse : tu n’aurais pas dû dire qu’on était un pays de merde, ce qu’il n’a jamais dit. S’il a retracé la merde qui l’entoure, par tonnes, c’est – c’était – pour en souligner la beauté, sauvage. Lui-même, dit-il, a construit sa réminiscence (proustienne) en tombant dans une fosse à purin, à 14 ans : on a le Combray que l’on peut. L’important, c’est le tabou, écrit-il, celui du secret – et de sa fiction - celui de Lucie, qu’il a portée dans sa tombe, celui de son père, qui le ramène à cet étonnement d’enfant qu’il n’aurait jamais voulu quitter. Qui le pousse à écrire la dernière partie au présent de narration, même si des belligérants sont morts, même s’ils ont laissé une loi poussant les autres – y compris les nouveaux – à faire comme s’il n’existait pas. La première pierre se termine pourtant par des souvenirs poignants d’estives ou de montades, par une topographie experte de la région, une connaissance pointue de ses vaches – les Salers, les Aubrac ou les simples laitières – et des coutumes locales : à chaque estive, on sort le troupeau inépuisable des histoires, écrit-il, comme pour se dédouaner après de l’avoir fait lui. On jurerait que l’auteur rêve d’une réconciliation autour d’un verre, mais le temps a passé, là aussi, et dans ces contrées, il ne passe jamais par l’oubli. Et surtout pas par le sang d’un gamin d’un an. Il restera le salaud, le pestiféré, le méchant, on le considérera comme un fantôme, une non-présence, mais même dans la condition de fantôme, se contente-t-il, il y a des joies. Et s’ils le rejettent, après tout, c’est qu’il est l’un des leurs : il faut bien une fonction sociale, au village. Chez lui, pleinement.
22:13 Publié dans Blog | Lien permanent
02/09/2024
JOURDOTHÈQUE (8/10)
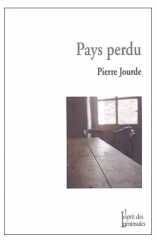 Il faut savoir relire les livres qui vous ont – considérablement – marqué en leur temps. Ainsi, l’antépénultième station de ma jourdothèque m’a conduit à rouvrir Pays perdu, un roman dont on a trop parlé pour le scandale qui a suivi que pour sa réalité littéraire, époustouflante. Même 20 ans après, ou un peu plus. Ainsi Jourde, dans Pays perdu, s’attaque-t-il à la légende des villages pour mieux, a contrario, en restituer la réalité, fût-elle sordide. Aux yeux de qui, par ailleurs ? Son abord est celle d’un orographe – celui qui étudie l’étude des reliefs montagneux, on l’a vu dans Littérature & authenticité (2005) – dans un premier temps, puisqu’il aborde vite, après le prétexte littéraire d’un héritage sur des terres anciennes, la notion de paysage fait d’axes, de bifurcations, de courbes, de route épuisée pour vite, interroger l’idée même de lieu, la présence invisible et tyrannique de l’espace. S’il revient 35 ans après, parce que son frère a hérité du cousin Joseph, c’est pour (re)trouver un pays plus perdu que jamais, ce qui reste une expression puisque le temps n’a eu aucune emprise sur la topologie, pas davantage sur les êtres, sauf que la plupart des seconds ont disparu, sans bruit, alors que la première est en place, ad vitam aeternam. Si les deux frères y vont dans la fantasmagorie du trésor (souvent fait de dettes et de lieux dont personne ne veut), ils retrouvent des hommes qui ont fini, dit l’auteur, par ressembler aux pierres. Et tombent, puisque l’analogie ne manque pas d’ironie, au moment de la mort de Lucie, qu’ils ont connue, qui est de leur âge. Ainsi se doivent-ils d’aller saluer les parents – François et Marie-Claude – lors de la veillée funèbre, et voir défiler, au fur et à mesure de la journée, toutes les figures du village et des villages voisins, que Jourde étudie en entomologiste, avec des descriptions qu’on jugerait dures si elles n’étaient pas l’exacte réalité de ce qu’il voit mieux qu’il ne voyait enfant.
Il faut savoir relire les livres qui vous ont – considérablement – marqué en leur temps. Ainsi, l’antépénultième station de ma jourdothèque m’a conduit à rouvrir Pays perdu, un roman dont on a trop parlé pour le scandale qui a suivi que pour sa réalité littéraire, époustouflante. Même 20 ans après, ou un peu plus. Ainsi Jourde, dans Pays perdu, s’attaque-t-il à la légende des villages pour mieux, a contrario, en restituer la réalité, fût-elle sordide. Aux yeux de qui, par ailleurs ? Son abord est celle d’un orographe – celui qui étudie l’étude des reliefs montagneux, on l’a vu dans Littérature & authenticité (2005) – dans un premier temps, puisqu’il aborde vite, après le prétexte littéraire d’un héritage sur des terres anciennes, la notion de paysage fait d’axes, de bifurcations, de courbes, de route épuisée pour vite, interroger l’idée même de lieu, la présence invisible et tyrannique de l’espace. S’il revient 35 ans après, parce que son frère a hérité du cousin Joseph, c’est pour (re)trouver un pays plus perdu que jamais, ce qui reste une expression puisque le temps n’a eu aucune emprise sur la topologie, pas davantage sur les êtres, sauf que la plupart des seconds ont disparu, sans bruit, alors que la première est en place, ad vitam aeternam. Si les deux frères y vont dans la fantasmagorie du trésor (souvent fait de dettes et de lieux dont personne ne veut), ils retrouvent des hommes qui ont fini, dit l’auteur, par ressembler aux pierres. Et tombent, puisque l’analogie ne manque pas d’ironie, au moment de la mort de Lucie, qu’ils ont connue, qui est de leur âge. Ainsi se doivent-ils d’aller saluer les parents – François et Marie-Claude – lors de la veillée funèbre, et voir défiler, au fur et à mesure de la journée, toutes les figures du village et des villages voisins, que Jourde étudie en entomologiste, avec des descriptions qu’on jugerait dures si elles n’étaient pas l’exacte réalité de ce qu’il voit mieux qu’il ne voyait enfant.
La matière des morts, dit-il, agit comme un révélateur de ce qu’ils ont vécu, voire de ce à quoi ils échappent désormais. Le village, c’est Freaks, empli d’obèses, d’handicapés, de vin rouge dans le biberon, de dents uniques, d’estropiés et de blessés par les machines modernes, on y croise, dans l’histoire, un scalpé qui remet son chapeau tranquillement, un autre qui laisse ses doigts gelés dans les barbelés dans lesquels sa cuite l’a laissé toute la nuit. Des fatalités domestiques locales, comme ces monceaux et chiffons qu’on laisse s’accumuler et se déliter. Des araignées dans les verres, du pus sur le visage, des cadavres de chiots dans les draps, la crasse entre les doigts qui s’écoule sous l’effet du jambon cru mangé à pleines mains… Une dizaine de foyers, dans un très petit espace, à 40 minutes de route de la première ville, où personne n’est allé. Des êtres qui sont des très peu d’hommes, des vies qui sont si peu, mais rien ne relève du jugement ou du dégoût. Juste une réflexion sur le temps – qui ne passe que pour celui qui s’est défait de ceux, différents,entrecroisés pour l’enterrement, des gens d’ici (ou de là-bas, c’est selon), sur la nécessité de revenir à l’image du mort, à sa tombe, à son corps. Le père du narrateur est enterré dans ce pays perdu, détenteur d’un secret que seule la tante Léontine pourra lever : généalogiste et chroniqueuse, dit Jourde, en digne héritier, puisqu’il mène, de son côté, une étude sociologique qui vaut celle de la Vie mode d’emploi, sans l’esthétique. Ou alors avec l’esthétique propre aux rituels complexes de la vie paysanne. Il y a parfois une pointe de nostalgie – le pays de son enfance perdue – dans le constat clinique : si rien ne semble évoluer, les machines ont remplacé les fenaisons avec les vieux et les enfants au râteau ; il n’y a toujours pas de toilettes ni de douche, mais des télés, qui ouvrent sur un monde qu’ils ne connaîtront jamais. Dans ces crêtes désertiques, on croise les écrasés, les ébouillantés, les énuclées, ceux qui se pendirent d’ennui, une détrousseuse de cadavres, les tonnes de merde remuées, puisque, écrit-il, une grande partie de l’activité agricole lui est consacrée. Et l’alcool, partout, dont Jourde étudie la fonction avec dureté mais – une fois de plus – justesse. On gage que ça n’a pas plu, et que le mode coup de poing (et pire) a remplacé le débat sur réalité et fiction, la licence littéraire, les prête-noms, les lieux déplacés ailleurs. Mais un ailleurs qui ne se reconnaît pas comme tel, surtout pour ceux qui n’en sont pas, et qui se sont reconnus jusque dans l’holocauste des mouches. Dans les années 80, on vantait le mérite littéraire de l’autofiction, baudruche heureusement vite démontée (quoique)… Au début du XXI°s. Jourde posait là un brûlot dont le seul défaut est celui de sa très grande qualité : une écriture du réel, sans faux-semblants, sans récit mélioratif qui éloigne de la véracité. Dure mais juste. Il s’est expliqué largement depuis, sur le sujet, mais ce roman-là, qui enterre les derniers paysans avec une mélancolie qu’on n’aura pas reconnue, va au-delà de la nécessité de mémoire : il en est le sujet.
21:39 Publié dans Blog | Lien permanent
01/09/2024
JOURDOTHÈQUE (7/10)
 Sacrée gageure, pour un intellectuel, de poser la question de Dieu en 40 pages, dans la belle collection des Tracts de Gallimard. Pourtant, il y a deux ans, Pierre Jourde s’y est attelé, sous le titre Croire en Dieu, pourquoi ? qui n’a rien d’anodin puisqu’il pose en soi la problématique de l’utilité dans un domaine supposé immanent, au-dessus même de toute question. Il y répond en un essai en six points, qui vont de la Création à sa bizarrerie, de l’autorité des textes sacrés au choix d’un Dieu (plutôt qu’un autre), des prescriptions divines au concept de morale. Une construction philosophique, qui commence – on s’en serait douté – par déconstruire la croyance, au nom de l’évolution et de la connaissance. Jusqu’à l’époque moderne, dit Jourde, toutes les sociétés étaient religieuses, et n’offraient donc pas la possibilité d’interroger la nature de la religion. On sait désormais par la science que Dieu ne peut pas être considéré comme la cause originelle – une cause en soi – pour autant, il relève encore, pour certains, d’un besoin profond, considérant (avec Kant) qu’il est impossible pour l’homme seul d‘avoir une connaissance de l’absolu. Dieu devient donc, dit Jourde, sollicitant Nabilla (sic) une hypothèse possible, mais non nécessaire, dans la perception des multivers qu’appréhendent les cosmologues. Dieu devient donc, avec l’histoire, un créateur bizarre, que l’auteur interroge en même temps que l’idée de souffrance qui justifierait une vie meilleure, après. Difficile de ne pas rapprocher les drames qu’il a vécus lui de l’idée d’en questionner Dieu, dans l’idée de salut, qu’il finit néanmoins par associer, de l’Immaculée conception chrétienne aux vierges du martyr d’Allah, à des énormités qu’il convient, toujours, de dénoncer, au nom de la connaissance.
Sacrée gageure, pour un intellectuel, de poser la question de Dieu en 40 pages, dans la belle collection des Tracts de Gallimard. Pourtant, il y a deux ans, Pierre Jourde s’y est attelé, sous le titre Croire en Dieu, pourquoi ? qui n’a rien d’anodin puisqu’il pose en soi la problématique de l’utilité dans un domaine supposé immanent, au-dessus même de toute question. Il y répond en un essai en six points, qui vont de la Création à sa bizarrerie, de l’autorité des textes sacrés au choix d’un Dieu (plutôt qu’un autre), des prescriptions divines au concept de morale. Une construction philosophique, qui commence – on s’en serait douté – par déconstruire la croyance, au nom de l’évolution et de la connaissance. Jusqu’à l’époque moderne, dit Jourde, toutes les sociétés étaient religieuses, et n’offraient donc pas la possibilité d’interroger la nature de la religion. On sait désormais par la science que Dieu ne peut pas être considéré comme la cause originelle – une cause en soi – pour autant, il relève encore, pour certains, d’un besoin profond, considérant (avec Kant) qu’il est impossible pour l’homme seul d‘avoir une connaissance de l’absolu. Dieu devient donc, dit Jourde, sollicitant Nabilla (sic) une hypothèse possible, mais non nécessaire, dans la perception des multivers qu’appréhendent les cosmologues. Dieu devient donc, avec l’histoire, un créateur bizarre, que l’auteur interroge en même temps que l’idée de souffrance qui justifierait une vie meilleure, après. Difficile de ne pas rapprocher les drames qu’il a vécus lui de l’idée d’en questionner Dieu, dans l’idée de salut, qu’il finit néanmoins par associer, de l’Immaculée conception chrétienne aux vierges du martyr d’Allah, à des énormités qu’il convient, toujours, de dénoncer, au nom de la connaissance.
C’est ainsi qu’il faut aborder les textes sacrés, dans leur autorité même, qui ne trouve réponse que dans le nombre, la répétition et l’opinion. En philosophie, l’inverse de la vérité, parce qu’elle est fondée sur l’aléa, le fait que possiblement, l’autre ait la même opinion que moi – auquel cas ça me conforte dans l’idée que j’ai raison – ou pas – auquel cas, je considère que c’est un imbécile, voire que je peux le tuer, au nom de Dieu. Le texte sacré, avance Jourde, a ceci de sacré qu’il décide à l’avance être la vérité, quelles qu’en soient les approximations, les imbécillités ou les anachronismes. Mais qui a décidé de ça, s’interroge-t-il, encore, opposant le discours scientifique, réfutable par essence, au religieux, définitif, même s’il est fondé sur des connaissances d’époque, une vision du monde très militée, de fait. Et Jourde de souligner un paradoxe (de plus) : les croyants évitent de se poser des questions sur un sujet aussi important que Dieu et, par extension, c’est l’ignorance qui fait la religion. Facile, ensuite, de donner les exemples multiples dans la vie que nous menons ou celle que nous entendons des autres. Alors, interroge-t-il, puisque c’est la nature de l’exercice de susciter des questions davantage que d’apporter de réponses, pourquoi ce Dieu plutôt qu’un autre ? Là encore, il remet l’aléa en route, soulignant qu’un Turc, par exemple, serait né Chrétien au XVI° siècle, à Istanbul, alors qu’il naîtra musulman, vraisemblablement, aujourd’hui. Ça n’est ni idéologique, ni spirituel, mais factuel. Dans l’histoire, des conversions se sont faites au nom d’un confort social, pas d’une croyance acharnée, rappelle-t-il. Sur ce terrain glissant – on tue des intellectuels pour moins que ça – il cite l’hindouisme comme la croyance la moins opposée à la connaissance, puisque la divinité se confond avec la matière, ramène les règles, contraintes et interdits (souvent imbéciles) à la crainte que l’homme se fait de sa propre liberté. Et conclue sur la confusion qu’on doit, chacun, éviter de faire entre la morale et la croyance, sous peine de tartufferie, notamment quand il s’agit de définir et faire le Bien. On lapide des jeunes filles, dans certains pays, parce qu’elles ont été immorales, dit-on ; ceux qui jettent les pierres – et Jourde, malheureusement, sait ce que le geste signifie, même dans d’autres circonstances – le font au nom de la morale, mais pose-t-il, qui fait mal à l’autre ? La morale n’a pas besoin de Dieu, elle est inhérente à l’homme.
C’est toujours un plus, des petits textes philosophiques très abordables, offerts (3,90€) à la conscience de chacun. Et dans l’œuvre – la vie, même - d’un auteur, c’est important qu’il se confronte à des idées beaucoup plus grandes que lui. C’est réussi.
18:27 Publié dans Blog | Lien permanent
06/08/2024
JOURDOTHÈQUE (6/10)
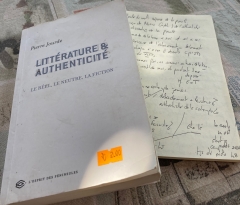 Il y a près de vingt ans, deux ans après l’avoir traitée dans son roman Pays perdu – qui prend une dimension autre à la lecture de cet essai – Pierre Jourde aborde la notion de l’authenticité dans la littérature, avec comme sous-thèmes le réel, le neutre et la fiction et reprend des scènes rencontrées dans son roman-phare (que complètera la première pierre, et on sait pourquoi) en traitant, dans une démonstration philosophique, épistémologique et analytique, de la dimension complexe de l’authenticité, au sens même où elle n’existe pas à partir du moment où on la considère. Où l’on se perd dans notre propre fiction, énonce-t-il, en mettant en jeu, déjà, le nous, le je. Le réel, dit-il, n’est souvent qu’un désir de réel, une comédie, et l’authentique, si l’on n’y prend garde, ne sera lui-même qu’une affirmation de l’authenticité. Jourde avance d’entrée quelles seront ses références, dans l’essai, cite Blanchot, Bataille, Jabès, d’autres, comme Barthès et son Vers le neutre ; Heidegger, en filigrane, pour son Être et Temps, entre être jeté et oubli de l’être, Giorgio Agamben - penseur des formes de vie - et sa communauté qui vient. Jourde se targue donc de définir l’indéfinissable, s’excusant en amont de ne pas y parvenir : c’est que l’essai, par nature, joue au neutre, c’est donc complexe, pour le moins, d’en déterminer l’aura métaphysique, l’indistinction heureuse. Dans sa volonté, difficile, de délimiter le réel, il se sert de ce qui a fait son matériau littéraire, dans Pays perdu : la mort et l’enterrement (d’une enfant) tels qu’ils sont vécus dans la campagne profonde, jouant de l’authentique, de l’illusion et du langage inhérent pour rendre compte d’une impression, taraudante et parfois destructrice selon laquelle une part de nous, infiniment minime, mais suffisante pour tout compromettre reste étrangère à ce qui se passe. Jourde offre une (auto) réflexion ouverte sur ce qu’il nomme l’autorité du réel, via la régence de la parole, son indiscrétion : il n’y a pas plus de lien entre le monde de la terre et soi qu’entre soi et soi, déduit-il de son expérience de l’enterrement où même le chagrin n’a rien d’absolu et semble vécu à travers une toile du XIX°s. Même constat devant le paysage qui nous fait face : on ne contemple jamais, dit-il, se référant autant à son Auvergne qu’au Tibet qu’il a parcouru, on oscille entre le sentiment, son débordement et la frustration qu’il génère pour dire qu’on n’est jamais vraiment là – au sens du dasein d’Heidegger – voire qu’on n’y est plus du tout : un événement dont je comprends avoir toujours été exclu. Son orographie – l’étude des reliefs montagneux – Jourde la double d’une analyse de la neutralité dans le paysage, explique qu’être là implique une dissipation du je. Double sa réaction devant les reliefs tibétains (ça n’est pas possible, littéralement) d’une étude du beau tempschez Proust, explique comment faire de la littérature avec de la contemplation, sachant que c’est l’impersonnel, contre toute attente, qui constitue la personnalité. Ainsi, au village, l’authenticité croit venir des rites agricoles alors que c’est précisément l’inverse. Valère Novarina, que l’auteur a adoubé depuis longtemps (notamment depuis la Littérature sans estomac) énonce qu’être homme, c’est aussi avoir en soi l’absence d’homme, dans la perte des traditions – la tradition n’a de sens que dans sa perte– ou la contestation d’un romantisme qui est en soi une négation de la neutralité. Que Jourde démontre par son addiction au Saint-Nectaire, l’objet singulier, ce qui vaut quelques pages remarquables et étonnantes.
Il y a près de vingt ans, deux ans après l’avoir traitée dans son roman Pays perdu – qui prend une dimension autre à la lecture de cet essai – Pierre Jourde aborde la notion de l’authenticité dans la littérature, avec comme sous-thèmes le réel, le neutre et la fiction et reprend des scènes rencontrées dans son roman-phare (que complètera la première pierre, et on sait pourquoi) en traitant, dans une démonstration philosophique, épistémologique et analytique, de la dimension complexe de l’authenticité, au sens même où elle n’existe pas à partir du moment où on la considère. Où l’on se perd dans notre propre fiction, énonce-t-il, en mettant en jeu, déjà, le nous, le je. Le réel, dit-il, n’est souvent qu’un désir de réel, une comédie, et l’authentique, si l’on n’y prend garde, ne sera lui-même qu’une affirmation de l’authenticité. Jourde avance d’entrée quelles seront ses références, dans l’essai, cite Blanchot, Bataille, Jabès, d’autres, comme Barthès et son Vers le neutre ; Heidegger, en filigrane, pour son Être et Temps, entre être jeté et oubli de l’être, Giorgio Agamben - penseur des formes de vie - et sa communauté qui vient. Jourde se targue donc de définir l’indéfinissable, s’excusant en amont de ne pas y parvenir : c’est que l’essai, par nature, joue au neutre, c’est donc complexe, pour le moins, d’en déterminer l’aura métaphysique, l’indistinction heureuse. Dans sa volonté, difficile, de délimiter le réel, il se sert de ce qui a fait son matériau littéraire, dans Pays perdu : la mort et l’enterrement (d’une enfant) tels qu’ils sont vécus dans la campagne profonde, jouant de l’authentique, de l’illusion et du langage inhérent pour rendre compte d’une impression, taraudante et parfois destructrice selon laquelle une part de nous, infiniment minime, mais suffisante pour tout compromettre reste étrangère à ce qui se passe. Jourde offre une (auto) réflexion ouverte sur ce qu’il nomme l’autorité du réel, via la régence de la parole, son indiscrétion : il n’y a pas plus de lien entre le monde de la terre et soi qu’entre soi et soi, déduit-il de son expérience de l’enterrement où même le chagrin n’a rien d’absolu et semble vécu à travers une toile du XIX°s. Même constat devant le paysage qui nous fait face : on ne contemple jamais, dit-il, se référant autant à son Auvergne qu’au Tibet qu’il a parcouru, on oscille entre le sentiment, son débordement et la frustration qu’il génère pour dire qu’on n’est jamais vraiment là – au sens du dasein d’Heidegger – voire qu’on n’y est plus du tout : un événement dont je comprends avoir toujours été exclu. Son orographie – l’étude des reliefs montagneux – Jourde la double d’une analyse de la neutralité dans le paysage, explique qu’être là implique une dissipation du je. Double sa réaction devant les reliefs tibétains (ça n’est pas possible, littéralement) d’une étude du beau tempschez Proust, explique comment faire de la littérature avec de la contemplation, sachant que c’est l’impersonnel, contre toute attente, qui constitue la personnalité. Ainsi, au village, l’authenticité croit venir des rites agricoles alors que c’est précisément l’inverse. Valère Novarina, que l’auteur a adoubé depuis longtemps (notamment depuis la Littérature sans estomac) énonce qu’être homme, c’est aussi avoir en soi l’absence d’homme, dans la perte des traditions – la tradition n’a de sens que dans sa perte– ou la contestation d’un romantisme qui est en soi une négation de la neutralité. Que Jourde démontre par son addiction au Saint-Nectaire, l’objet singulier, ce qui vaut quelques pages remarquables et étonnantes.
Être est aussi éloigné de l’étant que l’existence l’est de l’essence, dit-il, citant Sartre avec distance, par le biais de Kierkegaard, surtout. Ou de Merleau-Ponty, puisque la deuxième partie de l’ouvrage relève, quand même, de la somme de références. Il faut savoir parfois ne pas regarder er ne pas prêter attention, c’est ce qu’on relève de son étude du paysage, que sauve son abord par le foot ou la cueillette des champignons. Il applique ça à l’amour – champ d’écriture infini – sachant que tout ce qui s’est dit et écrit sur l’amour fait aimer. Que la souffrance qui en découle ne peut être vécue comme telle – idem pour l’expérience du deuil – puisque l’amour est toujours, dès l’origine, un chagrin d’amour. Dans l’Être et le Néant, Sartre définit l’écart de cette façon : Je ne suis pas ce que je suis ; Jourde en détermine une culpabilité narcissique, une théologie négative de soi, qu’il rapproche de la souffrance du neutre dans le moi, un état hypnagogique – une forme de conscience particulière entre la veille et le sommeil, qui a lieu durant l’endormissement – qui mènerait à un dessaisissement du langage. Jourde exécute les phases de narcissisme coupable (l’homme qui souffre de n’être que lui) mais aussi de modestie, le mensonge stratégique, définit-il, d’un orgueil bien géré. Il faut, lâche-t-il (enfin ?) un mélange de solitude neutralisante et de vanité active pour déterminer une vocation littéraire, et il sait de quoi il parle. Quel que soit le sujet abordé, celui qui écrit ne fait jamais que parler de lui : l’authenticité de l’émotion est un leurre – du rousseauisme spectaculaire – et l’on en arrive, via la faute, à l’antique doctrine théologique du péché originel, dixit Agambon, fil conducteur de l’essai. Jourde cite le succès de Houellebecq, pour sa critique de la compétition individuelle, mais le contrecarre par René Girard, qui donne la réalité en tant de ce qu’elle a à être. Ou Louis de Funès, cité ici pour ce qu’il dit de l’expression Mon Dieu (inepte puisque Dieu est un dépossessif). Dans l’acte littéraire – le rêve de quelque chose comme un désert mondain, d’une parole sans bruit et d’un acte sans acte – tout se passe comme si le neutre n’était que parole, sans considération d’un rapport à soi entre volontaire et involontaire. Ainsi, ce que Jourde intitule les Artifices littéraires, s’appuie, dit Blanchot, sur l’impropriété :écrire, c’est vouloir se faire, par le livre, l’autre de l’autre. Montaigne même n’est, de manière plus ou moins implicite, que le nom de quelqu’un qui a su n’être personne, puisqu’il a fait des livres. Et Jourde, qui ne se prive pas d’une analogie supplémentaire avec la boxe, d’opposer l’authenticité à l’excès, de saveur ou de visibilité, de s’appuyer, aussi, sur les écrivains moins que rien(Delerm, Autin-Grenier, Holder) qui font que la chose ou la sensation particulières ont une valeur en elles-mêmes, de par leur particularité. Son analyse de la modestie vaut également son pesant de cacahuètes, sa réflexion sur la tradition moderne de la critique aussi, son stratagème de vouloir dissocier l’homme de l’œuvre, Céline à l’appui, surtout. Comment faire en sorte qu’il existe un langage sans vouloir dire, pose Agamben, une possibilité littéraire du neutre ? Jourde n’en trouve que dans les comptines et les vieilles chansons populaires, comme la Claire Fontaine, dans l’incongru comme effet produit : le réalisme loufoque avec lequel il clôt son essai. Ou la littérature bouffonne, avec Pierre Dac, Max Jacob ou, encore, Valère Novarina, puisque son texte sonne comme une parodie mais on ne saurait dire au juste ce qui s’y trouve parodié, sinon le langage même. C’est dans l’épilogue, entre deux précautions psychanalytiques et un dernier renvoi à l’ipséité via Ricoeur que Jourde bascule vers le lecteur – je suis le sujet de ce que je lis – pour faire de l’écrivain un homme du réel et de l’irréel, en quête de sa voix. C’était il y a vingt ans, et la curiosité reste de savoir comment l’écrivain Jourde se mesure à l’aune de l’essai sur la littérature qu’il a posé là : entre contradiction et authenticité, en soi. Une vie d’homme, quoi.
Pierre Jourde, Littérature & authenticité (le réel, le neutre, la fiction), l’Esprit des Péninsules, 2005
15:19 Publié dans Blog | Lien permanent
20/07/2024
Because the night.
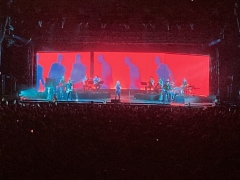 Je n’ose pas faire la moyenne de l’âge des artistes que je suis allé voir cet été, et plus globalement au cours d’une année 2024 que je terminerai, si Dieu me tripote, par un octogénaire sémillant, mais quand même. Une espèce de Farewell Tour, après que j’ai failli moi-même tirer ma révérence avant Véronique Sanson. Après Simple Minds mercredi dernier, mon retour est passé par Nîmes, aux Arènes, pour un coplateau atypique mais (plus qu’) attirant. Patti Smith, je n’aurais sans doute jamais payé pour la voir seule, malgré tout le respect que j’ai pour une œuvre que j’écoute régulièrement. Mais bon, avec elle, il faut jongler entre les moments où elle vient déclamer des poèmes (j’ai déjà les Voix Vives en bas de chez moi) ou autres créations censées l’éloigner un peu de ses standards auxquels, sans doute, une bonne partie de son public la restreint. Mais Patti Smith, comme Joan Baez, c’est une voix de la folk-rock, auteure elle-même mais, surtout, formidable passeuse de textes. Et hier, en formation rock – un quartet avec son fils à la guitare – elle ne s’en est pas privée, chantant du Lana Del Rey, du Bob Dylan, jouant un morceau en hommage à Johnny Cash, un autre pour les 30 ans de la mort de Kurt Cobain, enchaîné avec un Smells like Teen Spiritsde très bon aloi, qui fait oublier aux fans qui secouent la tête à tout crin qu’ils n’ont presque plus de cheveux. La femme à côté de nous, dans le vomitoire (sic) nous a annoncé en amont que c’est Patti qui ouvrirait le concert : sa sœur de rock, dit-elle, joue à Marseille aujourd’hui, il faut qu’elle parte tôt. De fait, il fait jour quand elle donne son show, mais le son et la voix sont impeccables, la présence scénique impressionnante et puis un concert qui offre Dancing Barefoot, Because The night en clin d’œil au rendez-vous manqué avec le Boss, en mai, et People have the power, une des dernières raisons de lever le poing en public, à notre époque, est déjà un concert à part. Qui ferait presque douter de la capacité d’Etienne Daho de relever le gant. Peut-être est-ce pour ça, en partie, que le changement de plateau est très long, surtout parce que le light show est impressionnant : un double cadre lumineux, l’un qui définit la scène en entier, deux pans d’écrans réunis derrière pour un show impressionnant, stroboscopique – obligeant une encore récente victime d’AVC à détourner les yeux, souvent – avec des ombres d’un Daho derrière, dansant, en mode générique d’Amicalement vôtre. L’esprit pop (Satori) n’a pas bougé, et malgré un son très fort et une voix en avant qui a franchement relégué les cordes, Daho est le même qu’il y a quarante ans, et c’est toujours fascinant de voir un type plutôt sympathique vous rappeler qu’il a dicté la bande son de votre vie en multipliant les tubes : le grand sommeil, sortir ce soir, Comme un boomerang - avec un rappel des parrainages qu’il a connus dans le métier avec Hardy, Dutronc et donc Gainsbourg, dont il n’est pas sorti vivant, selon ses termes, de l’apéro qu’il a un jour partagé avec lui – Des heures hindoues qui tirent déjà des larmes (même si je suis rien, si j’suis personne, personne), mon manège à moi, Duel au soleil, qui en tire d’autres, Tombé pour la France, Bleu comme toi, le premier jour (du reste de ta vie) qui ouvre les vannes, Week-end à Rome, Épaule Tatoo, j’échangerais bien mon dernier relevé SACEM (31,02€) contre le sien, mais je ne lui en veux pas. C’est touchant également de le voir présenter des morceaux moins connus, pour lesquels il a une certaine affection, dit-il avec pudeur : j’espère un temps Promesses, qui ne viendra pas, mais il lance l’homme qui marche, sa préférée, En surface, que lui a écrite Dominique A. Et d’autres, qui ponctuent un show rodé, qu’il termine, en rappel, par Ouverture, histoire de marquer la vie de cet éternel jeune homme, qui ne vieillit pas quand son public le fait, ce qui ne l’empêche pas de danser dans les gradins des Arènes comme on dansait dans les boums des 80’s. Il a parlé d’une K7, à un moment, s’est enquis de savoir si tout le monde savait de quoi il parlait. Et c’était ça, en fait, hier : deux heures calées avec un walkman sur les oreilles, à faire comme si rien ne s’était passé depuis la Teste-de-Buch, en 1983.
Je n’ose pas faire la moyenne de l’âge des artistes que je suis allé voir cet été, et plus globalement au cours d’une année 2024 que je terminerai, si Dieu me tripote, par un octogénaire sémillant, mais quand même. Une espèce de Farewell Tour, après que j’ai failli moi-même tirer ma révérence avant Véronique Sanson. Après Simple Minds mercredi dernier, mon retour est passé par Nîmes, aux Arènes, pour un coplateau atypique mais (plus qu’) attirant. Patti Smith, je n’aurais sans doute jamais payé pour la voir seule, malgré tout le respect que j’ai pour une œuvre que j’écoute régulièrement. Mais bon, avec elle, il faut jongler entre les moments où elle vient déclamer des poèmes (j’ai déjà les Voix Vives en bas de chez moi) ou autres créations censées l’éloigner un peu de ses standards auxquels, sans doute, une bonne partie de son public la restreint. Mais Patti Smith, comme Joan Baez, c’est une voix de la folk-rock, auteure elle-même mais, surtout, formidable passeuse de textes. Et hier, en formation rock – un quartet avec son fils à la guitare – elle ne s’en est pas privée, chantant du Lana Del Rey, du Bob Dylan, jouant un morceau en hommage à Johnny Cash, un autre pour les 30 ans de la mort de Kurt Cobain, enchaîné avec un Smells like Teen Spiritsde très bon aloi, qui fait oublier aux fans qui secouent la tête à tout crin qu’ils n’ont presque plus de cheveux. La femme à côté de nous, dans le vomitoire (sic) nous a annoncé en amont que c’est Patti qui ouvrirait le concert : sa sœur de rock, dit-elle, joue à Marseille aujourd’hui, il faut qu’elle parte tôt. De fait, il fait jour quand elle donne son show, mais le son et la voix sont impeccables, la présence scénique impressionnante et puis un concert qui offre Dancing Barefoot, Because The night en clin d’œil au rendez-vous manqué avec le Boss, en mai, et People have the power, une des dernières raisons de lever le poing en public, à notre époque, est déjà un concert à part. Qui ferait presque douter de la capacité d’Etienne Daho de relever le gant. Peut-être est-ce pour ça, en partie, que le changement de plateau est très long, surtout parce que le light show est impressionnant : un double cadre lumineux, l’un qui définit la scène en entier, deux pans d’écrans réunis derrière pour un show impressionnant, stroboscopique – obligeant une encore récente victime d’AVC à détourner les yeux, souvent – avec des ombres d’un Daho derrière, dansant, en mode générique d’Amicalement vôtre. L’esprit pop (Satori) n’a pas bougé, et malgré un son très fort et une voix en avant qui a franchement relégué les cordes, Daho est le même qu’il y a quarante ans, et c’est toujours fascinant de voir un type plutôt sympathique vous rappeler qu’il a dicté la bande son de votre vie en multipliant les tubes : le grand sommeil, sortir ce soir, Comme un boomerang - avec un rappel des parrainages qu’il a connus dans le métier avec Hardy, Dutronc et donc Gainsbourg, dont il n’est pas sorti vivant, selon ses termes, de l’apéro qu’il a un jour partagé avec lui – Des heures hindoues qui tirent déjà des larmes (même si je suis rien, si j’suis personne, personne), mon manège à moi, Duel au soleil, qui en tire d’autres, Tombé pour la France, Bleu comme toi, le premier jour (du reste de ta vie) qui ouvre les vannes, Week-end à Rome, Épaule Tatoo, j’échangerais bien mon dernier relevé SACEM (31,02€) contre le sien, mais je ne lui en veux pas. C’est touchant également de le voir présenter des morceaux moins connus, pour lesquels il a une certaine affection, dit-il avec pudeur : j’espère un temps Promesses, qui ne viendra pas, mais il lance l’homme qui marche, sa préférée, En surface, que lui a écrite Dominique A. Et d’autres, qui ponctuent un show rodé, qu’il termine, en rappel, par Ouverture, histoire de marquer la vie de cet éternel jeune homme, qui ne vieillit pas quand son public le fait, ce qui ne l’empêche pas de danser dans les gradins des Arènes comme on dansait dans les boums des 80’s. Il a parlé d’une K7, à un moment, s’est enquis de savoir si tout le monde savait de quoi il parlait. Et c’était ça, en fait, hier : deux heures calées avec un walkman sur les oreilles, à faire comme si rien ne s’était passé depuis la Teste-de-Buch, en 1983.
15:28 Publié dans Blog | Lien permanent















































