06/08/2024
JOURDOTHÈQUE (6/10)
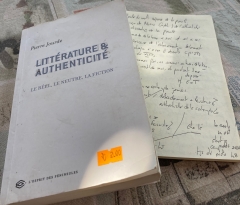 Il y a près de vingt ans, deux ans après l’avoir traitée dans son roman Pays perdu – qui prend une dimension autre à la lecture de cet essai – Pierre Jourde aborde la notion de l’authenticité dans la littérature, avec comme sous-thèmes le réel, le neutre et la fiction et reprend des scènes rencontrées dans son roman-phare (que complètera la première pierre, et on sait pourquoi) en traitant, dans une démonstration philosophique, épistémologique et analytique, de la dimension complexe de l’authenticité, au sens même où elle n’existe pas à partir du moment où on la considère. Où l’on se perd dans notre propre fiction, énonce-t-il, en mettant en jeu, déjà, le nous, le je. Le réel, dit-il, n’est souvent qu’un désir de réel, une comédie, et l’authentique, si l’on n’y prend garde, ne sera lui-même qu’une affirmation de l’authenticité. Jourde avance d’entrée quelles seront ses références, dans l’essai, cite Blanchot, Bataille, Jabès, d’autres, comme Barthès et son Vers le neutre ; Heidegger, en filigrane, pour son Être et Temps, entre être jeté et oubli de l’être, Giorgio Agamben - penseur des formes de vie - et sa communauté qui vient. Jourde se targue donc de définir l’indéfinissable, s’excusant en amont de ne pas y parvenir : c’est que l’essai, par nature, joue au neutre, c’est donc complexe, pour le moins, d’en déterminer l’aura métaphysique, l’indistinction heureuse. Dans sa volonté, difficile, de délimiter le réel, il se sert de ce qui a fait son matériau littéraire, dans Pays perdu : la mort et l’enterrement (d’une enfant) tels qu’ils sont vécus dans la campagne profonde, jouant de l’authentique, de l’illusion et du langage inhérent pour rendre compte d’une impression, taraudante et parfois destructrice selon laquelle une part de nous, infiniment minime, mais suffisante pour tout compromettre reste étrangère à ce qui se passe. Jourde offre une (auto) réflexion ouverte sur ce qu’il nomme l’autorité du réel, via la régence de la parole, son indiscrétion : il n’y a pas plus de lien entre le monde de la terre et soi qu’entre soi et soi, déduit-il de son expérience de l’enterrement où même le chagrin n’a rien d’absolu et semble vécu à travers une toile du XIX°s. Même constat devant le paysage qui nous fait face : on ne contemple jamais, dit-il, se référant autant à son Auvergne qu’au Tibet qu’il a parcouru, on oscille entre le sentiment, son débordement et la frustration qu’il génère pour dire qu’on n’est jamais vraiment là – au sens du dasein d’Heidegger – voire qu’on n’y est plus du tout : un événement dont je comprends avoir toujours été exclu. Son orographie – l’étude des reliefs montagneux – Jourde la double d’une analyse de la neutralité dans le paysage, explique qu’être là implique une dissipation du je. Double sa réaction devant les reliefs tibétains (ça n’est pas possible, littéralement) d’une étude du beau tempschez Proust, explique comment faire de la littérature avec de la contemplation, sachant que c’est l’impersonnel, contre toute attente, qui constitue la personnalité. Ainsi, au village, l’authenticité croit venir des rites agricoles alors que c’est précisément l’inverse. Valère Novarina, que l’auteur a adoubé depuis longtemps (notamment depuis la Littérature sans estomac) énonce qu’être homme, c’est aussi avoir en soi l’absence d’homme, dans la perte des traditions – la tradition n’a de sens que dans sa perte– ou la contestation d’un romantisme qui est en soi une négation de la neutralité. Que Jourde démontre par son addiction au Saint-Nectaire, l’objet singulier, ce qui vaut quelques pages remarquables et étonnantes.
Il y a près de vingt ans, deux ans après l’avoir traitée dans son roman Pays perdu – qui prend une dimension autre à la lecture de cet essai – Pierre Jourde aborde la notion de l’authenticité dans la littérature, avec comme sous-thèmes le réel, le neutre et la fiction et reprend des scènes rencontrées dans son roman-phare (que complètera la première pierre, et on sait pourquoi) en traitant, dans une démonstration philosophique, épistémologique et analytique, de la dimension complexe de l’authenticité, au sens même où elle n’existe pas à partir du moment où on la considère. Où l’on se perd dans notre propre fiction, énonce-t-il, en mettant en jeu, déjà, le nous, le je. Le réel, dit-il, n’est souvent qu’un désir de réel, une comédie, et l’authentique, si l’on n’y prend garde, ne sera lui-même qu’une affirmation de l’authenticité. Jourde avance d’entrée quelles seront ses références, dans l’essai, cite Blanchot, Bataille, Jabès, d’autres, comme Barthès et son Vers le neutre ; Heidegger, en filigrane, pour son Être et Temps, entre être jeté et oubli de l’être, Giorgio Agamben - penseur des formes de vie - et sa communauté qui vient. Jourde se targue donc de définir l’indéfinissable, s’excusant en amont de ne pas y parvenir : c’est que l’essai, par nature, joue au neutre, c’est donc complexe, pour le moins, d’en déterminer l’aura métaphysique, l’indistinction heureuse. Dans sa volonté, difficile, de délimiter le réel, il se sert de ce qui a fait son matériau littéraire, dans Pays perdu : la mort et l’enterrement (d’une enfant) tels qu’ils sont vécus dans la campagne profonde, jouant de l’authentique, de l’illusion et du langage inhérent pour rendre compte d’une impression, taraudante et parfois destructrice selon laquelle une part de nous, infiniment minime, mais suffisante pour tout compromettre reste étrangère à ce qui se passe. Jourde offre une (auto) réflexion ouverte sur ce qu’il nomme l’autorité du réel, via la régence de la parole, son indiscrétion : il n’y a pas plus de lien entre le monde de la terre et soi qu’entre soi et soi, déduit-il de son expérience de l’enterrement où même le chagrin n’a rien d’absolu et semble vécu à travers une toile du XIX°s. Même constat devant le paysage qui nous fait face : on ne contemple jamais, dit-il, se référant autant à son Auvergne qu’au Tibet qu’il a parcouru, on oscille entre le sentiment, son débordement et la frustration qu’il génère pour dire qu’on n’est jamais vraiment là – au sens du dasein d’Heidegger – voire qu’on n’y est plus du tout : un événement dont je comprends avoir toujours été exclu. Son orographie – l’étude des reliefs montagneux – Jourde la double d’une analyse de la neutralité dans le paysage, explique qu’être là implique une dissipation du je. Double sa réaction devant les reliefs tibétains (ça n’est pas possible, littéralement) d’une étude du beau tempschez Proust, explique comment faire de la littérature avec de la contemplation, sachant que c’est l’impersonnel, contre toute attente, qui constitue la personnalité. Ainsi, au village, l’authenticité croit venir des rites agricoles alors que c’est précisément l’inverse. Valère Novarina, que l’auteur a adoubé depuis longtemps (notamment depuis la Littérature sans estomac) énonce qu’être homme, c’est aussi avoir en soi l’absence d’homme, dans la perte des traditions – la tradition n’a de sens que dans sa perte– ou la contestation d’un romantisme qui est en soi une négation de la neutralité. Que Jourde démontre par son addiction au Saint-Nectaire, l’objet singulier, ce qui vaut quelques pages remarquables et étonnantes.
Être est aussi éloigné de l’étant que l’existence l’est de l’essence, dit-il, citant Sartre avec distance, par le biais de Kierkegaard, surtout. Ou de Merleau-Ponty, puisque la deuxième partie de l’ouvrage relève, quand même, de la somme de références. Il faut savoir parfois ne pas regarder er ne pas prêter attention, c’est ce qu’on relève de son étude du paysage, que sauve son abord par le foot ou la cueillette des champignons. Il applique ça à l’amour – champ d’écriture infini – sachant que tout ce qui s’est dit et écrit sur l’amour fait aimer. Que la souffrance qui en découle ne peut être vécue comme telle – idem pour l’expérience du deuil – puisque l’amour est toujours, dès l’origine, un chagrin d’amour. Dans l’Être et le Néant, Sartre définit l’écart de cette façon : Je ne suis pas ce que je suis ; Jourde en détermine une culpabilité narcissique, une théologie négative de soi, qu’il rapproche de la souffrance du neutre dans le moi, un état hypnagogique – une forme de conscience particulière entre la veille et le sommeil, qui a lieu durant l’endormissement – qui mènerait à un dessaisissement du langage. Jourde exécute les phases de narcissisme coupable (l’homme qui souffre de n’être que lui) mais aussi de modestie, le mensonge stratégique, définit-il, d’un orgueil bien géré. Il faut, lâche-t-il (enfin ?) un mélange de solitude neutralisante et de vanité active pour déterminer une vocation littéraire, et il sait de quoi il parle. Quel que soit le sujet abordé, celui qui écrit ne fait jamais que parler de lui : l’authenticité de l’émotion est un leurre – du rousseauisme spectaculaire – et l’on en arrive, via la faute, à l’antique doctrine théologique du péché originel, dixit Agambon, fil conducteur de l’essai. Jourde cite le succès de Houellebecq, pour sa critique de la compétition individuelle, mais le contrecarre par René Girard, qui donne la réalité en tant de ce qu’elle a à être. Ou Louis de Funès, cité ici pour ce qu’il dit de l’expression Mon Dieu (inepte puisque Dieu est un dépossessif). Dans l’acte littéraire – le rêve de quelque chose comme un désert mondain, d’une parole sans bruit et d’un acte sans acte – tout se passe comme si le neutre n’était que parole, sans considération d’un rapport à soi entre volontaire et involontaire. Ainsi, ce que Jourde intitule les Artifices littéraires, s’appuie, dit Blanchot, sur l’impropriété :écrire, c’est vouloir se faire, par le livre, l’autre de l’autre. Montaigne même n’est, de manière plus ou moins implicite, que le nom de quelqu’un qui a su n’être personne, puisqu’il a fait des livres. Et Jourde, qui ne se prive pas d’une analogie supplémentaire avec la boxe, d’opposer l’authenticité à l’excès, de saveur ou de visibilité, de s’appuyer, aussi, sur les écrivains moins que rien(Delerm, Autin-Grenier, Holder) qui font que la chose ou la sensation particulières ont une valeur en elles-mêmes, de par leur particularité. Son analyse de la modestie vaut également son pesant de cacahuètes, sa réflexion sur la tradition moderne de la critique aussi, son stratagème de vouloir dissocier l’homme de l’œuvre, Céline à l’appui, surtout. Comment faire en sorte qu’il existe un langage sans vouloir dire, pose Agamben, une possibilité littéraire du neutre ? Jourde n’en trouve que dans les comptines et les vieilles chansons populaires, comme la Claire Fontaine, dans l’incongru comme effet produit : le réalisme loufoque avec lequel il clôt son essai. Ou la littérature bouffonne, avec Pierre Dac, Max Jacob ou, encore, Valère Novarina, puisque son texte sonne comme une parodie mais on ne saurait dire au juste ce qui s’y trouve parodié, sinon le langage même. C’est dans l’épilogue, entre deux précautions psychanalytiques et un dernier renvoi à l’ipséité via Ricoeur que Jourde bascule vers le lecteur – je suis le sujet de ce que je lis – pour faire de l’écrivain un homme du réel et de l’irréel, en quête de sa voix. C’était il y a vingt ans, et la curiosité reste de savoir comment l’écrivain Jourde se mesure à l’aune de l’essai sur la littérature qu’il a posé là : entre contradiction et authenticité, en soi. Une vie d’homme, quoi.
Pierre Jourde, Littérature & authenticité (le réel, le neutre, la fiction), l’Esprit des Péninsules, 2005
15:19 Publié dans Blog | Lien permanent

















































Les commentaires sont fermés.