09/09/2025
LES DESTRIERS DE LA PÉDALE.
 Il faut parfois savoir sortir du temps, de l’urgence et de l’imbécillité du monde. Faire comme avant, rentrer en urgence avec un vinyl sous le bras, enlever la cellophane avec précaution, poser fébrilement la galette sur la platine, poser le bras et s’assoir. Se dire que ce disque qu’on a attendu près de cinq ans – le temps d’un roman, finalement – il est là et, n’en déplaise à son auteur, on n’a plus besoin de lui pour en écouter les chansons. Fausto, de Nicolas Grosso, est un album particulier pour lui, parce qu’il arrive au bout d’un long cheminement et d’une maturité dans l’écriture qui n’a jamais d’autre origine que l’existence qui avance, la façon dont on a de répondre aux coups qu’elle nous met. Nico, en plus d’être un musicien surdoué, s’est toujours montré sous des aspects festifs, Gretsch Nashville siglée Brian Setzer, rockabilly, jazz manouche, bœufs et fiestas improvisées. Là, il faut avouer que si la musique touche au sublime dans son éclectisme, c’est le panel des thèmes abordés qui impressionne, avec la façon unique de contrecarrer le pire des pépins qui puisse nous arriver, la mort, via les morceaux qu’il dédie à Edmond Zabal (Bye Eddy bye-bye Parti sans trop de bruit faire danser l’au-delà Sais-tu qu’ici-bas depuis que t’es en haut On fait semblant de rien mais Tout part à vau-l’eau ?) ou à Frédéric Maltese, que tout le monde ici appelait Freddy, le sosie d’Elvis Presley (Sous sa voix de braise, la voix d’Elvis reprenait vie) mort d’un accident de voiture (comme James Dean). Dans les deux cas, faire swinguer la mort, c’est ce qu’il pouvait faire de mieux, comme hommage, et on sourit franchement quand il nous semble entendre Freddy dire Ta race!, t’appeler Fils, ou quand on revoit Zabal, sa casquette molle, Dans tes souliers vernis, ton plus joli costard, qui n’aurait pas renié ce Blues mâtiné de quelques touches d’électro, un crescendo de voix posant un chœur qui monte jusque là-haut. Les voix féminines apportent une touche délicate dans l’album, comme les cordes de Bertille sur Vie de vioque, adoucissent un poil un propos plutôt grave, in fine.
Il faut parfois savoir sortir du temps, de l’urgence et de l’imbécillité du monde. Faire comme avant, rentrer en urgence avec un vinyl sous le bras, enlever la cellophane avec précaution, poser fébrilement la galette sur la platine, poser le bras et s’assoir. Se dire que ce disque qu’on a attendu près de cinq ans – le temps d’un roman, finalement – il est là et, n’en déplaise à son auteur, on n’a plus besoin de lui pour en écouter les chansons. Fausto, de Nicolas Grosso, est un album particulier pour lui, parce qu’il arrive au bout d’un long cheminement et d’une maturité dans l’écriture qui n’a jamais d’autre origine que l’existence qui avance, la façon dont on a de répondre aux coups qu’elle nous met. Nico, en plus d’être un musicien surdoué, s’est toujours montré sous des aspects festifs, Gretsch Nashville siglée Brian Setzer, rockabilly, jazz manouche, bœufs et fiestas improvisées. Là, il faut avouer que si la musique touche au sublime dans son éclectisme, c’est le panel des thèmes abordés qui impressionne, avec la façon unique de contrecarrer le pire des pépins qui puisse nous arriver, la mort, via les morceaux qu’il dédie à Edmond Zabal (Bye Eddy bye-bye Parti sans trop de bruit faire danser l’au-delà Sais-tu qu’ici-bas depuis que t’es en haut On fait semblant de rien mais Tout part à vau-l’eau ?) ou à Frédéric Maltese, que tout le monde ici appelait Freddy, le sosie d’Elvis Presley (Sous sa voix de braise, la voix d’Elvis reprenait vie) mort d’un accident de voiture (comme James Dean). Dans les deux cas, faire swinguer la mort, c’est ce qu’il pouvait faire de mieux, comme hommage, et on sourit franchement quand il nous semble entendre Freddy dire Ta race!, t’appeler Fils, ou quand on revoit Zabal, sa casquette molle, Dans tes souliers vernis, ton plus joli costard, qui n’aurait pas renié ce Blues mâtiné de quelques touches d’électro, un crescendo de voix posant un chœur qui monte jusque là-haut. Les voix féminines apportent une touche délicate dans l’album, comme les cordes de Bertille sur Vie de vioque, adoucissent un poil un propos plutôt grave, in fine.
Fausto, c’est un peu plus qu’un disque, puisqu’en s’emparant de la vie d’un autre – dans le dernier morceau, qui devait au départ être un blind-track, de mémoire – Grosso se situe volontairement a contracorrente de son époque - avec nos airs d’antiquités nos vélos sont parfois moqués, dit-il dans le Vélo, le single accrocheur – et n’hésite pas à regarder dans le miroir de sa propre existence, de faire un bilan sur l’amitié - les amis toujours contents, jamais à crédit se comptent tout de go sur les doigts de la main gauche de Django – l’enfance et la vieillesse en deux morceaux qui se suivent, l’un, Petit, écrit par un minot, aux genoux couleur bétadine - J’aime la musique et je lis Pas trop de copains à l’école Je ne me fais pas remarquer, 6,5 ans bien tassés – l’autre, Vie de vioque, avec la collaboration du grand Jean Fauque, qui relate la vie du Play-boy de l’EPHAD, qui raccroche les gants : Au royaume des chanceux j’suis tombé sur la fève, avoue-t-il. Davantage que les Enfants perdus, cette référence à James Matthew Barrie, un morceau aux riffs assez durs, au traitement rock et au texte difficile, tout juste allégé (c’est pas vrai) par les chœurs de la classe CP/CM2 de l’école Ferdinand Buisson de Sète : Nous n’étions pas méchants Dans cette île où les grands nous retenaient reclus/Posaient leur main dessus Nous étions hors du temps. Sète, Nico Grosso y revient de façon récurrente, comme Freddy (Sète, son Memphis à lui), comme les vieux fourneaux du Vélo - les anciens on les préfère à regretter Yvette Horner - Didier Wampas et lui (le Môle à Sète et ses pavés, c’est un peu notre Paris-Roubais, doublé d’une petite pique aux habitants du St Clair, on n'y va point car on n’a pas les moyens !), comme au Château d’eau et son jardin dans C’était mieux demain. C’était mieux demain* et ses fadaises fanées, j’en parlerai une autre fois, promis, j’en reste à la petite larme que j’ai versée, ce soir.
Fausto, qui s’achève sur le morceau éponyme, une biographie musicale en douceur qui montre l’envers du décor de la vie d’un campionissimo – j’prends mon vélo et j’oublie - les deuils, les failles, les rivalités est un p… d’album complet et délicieusement archaïque, au sens étymologique. On y trouve aussi une chanson d’amour raté (j’suis pas l’nonosse de ta vie) dédiée à la chienne de Didier Wampas (ouah ouah ouah ouah ouah), une ode aussi festive dans le rythme que mélancolique dans le texte aux chaussettes dépareillées. Et puis, de toute manière, un artiste qui s’appuie sur des expressions aussi désuètes que Tout de go et partir à vau-l’eau vaut déjà la peine d’être écouté ; qu’un fringant quadragénaire fan de cyclisme ne jure que par Gimondi, Eddy Merckx, Bartali, De Vlaeminck, Anquetil ou Coppi ne peut, dans la réminiscence, que rassurer sur le tour (pas le Tour) un peu imbécile que prend le temps, parfois.
Fausto, Chichois Prod., 2025 - sortie le 13 septembre
Mixé par Loïs Eichelbrenner, masterisé par Bruno Varca.
*et des deux autres chansons présentes sur le Cd, la Guitare et les vieux de la vieille, et pas sur le vinyl.
22:45 Publié dans Blog | Lien permanent
20/07/2025
Dis-leur (que le portrait est un art littéraire).
 Alain Rollat a une qualité énorme, c'est qu'il a beau avoir été directeur-adjoint du Monde, participant en cela à sa marche active, il est resté humble, d'abord, et éminemment curieux, de toutes les formes de littérature. Qu'il consacre un (long) article au genre du Portrait et qu'il accorde une place conséquente à mes Figures Singulières me remplit de joie et de fierté. C'est ICI.
Alain Rollat a une qualité énorme, c'est qu'il a beau avoir été directeur-adjoint du Monde, participant en cela à sa marche active, il est resté humble, d'abord, et éminemment curieux, de toutes les formes de littérature. Qu'il consacre un (long) article au genre du Portrait et qu'il accorde une place conséquente à mes Figures Singulières me remplit de joie et de fierté. C'est ICI.
Et ça se commande LÀ.
07:30 Publié dans Blog | Lien permanent
05/07/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (11)
 Concrètement, il se passe peu de choses, lit-on à la page… 359 d’un roman qui en fait 635 et c’est une des plus belles antiphrases de la littérature moderne, tant Histoires de la nuit tient son lecteur en haleine, l’obligeant, toujours, à un chapitre supplémentaire pour savoir ce qu’il va (enfin) advenir de ces quatre protagonistes du hameau qu’occupent Bergogne, sa femme Marion (dont c’est le 40e anniversaire, le jour du récit) et leur petite fille Ida, qui a l’âge d’aller à l’école du bourg, de regarder des dessins animés à la télé et d’attendre que sa maman rentre du bureau, que Papa ait rentré les vaches, à la Bassée (toujours), au lieu-dit Écart des trois filles seules (la voisine, la femme et l’enfant ?) ; il y a Christine, aussi, dans la ferme à côté, une artiste-peintre (exubérante et barrée) qui a renoncé à la ville pour venir habiter ici, dix ans auparavant : c’est ici et pas ailleurs qu’elle voulait vivre, vieillir, mourir . Ida adore Christine, son chien Radjah, va prendre son goûter chez elle quand l’école est terminée, ne s’étonne plus des peintures étranges et dénudées dans l’atelier – tout l’intérêt c’était que l’atelier soit dans la maison. La vie s’écoulait simple et tranquille, jusqu’à ce jour-anniversaire pour lequel Christine s’est engagée à faire des gâteaux – elle n’aime pas beaucoup Marion, qu’elle juge prétentieuse : une pétasse tatouée (au ras du cou) qui fait tout pour rentrer tard – mais garde ça pour elle : dans Histoires de la nuit, plus encore que dans tout Mauvignier, on dit peu mais on disserte sur ce qu’on ne dit pas. Ce sont les pensées qui prédominent, pas le discours, toujours restreint. Christine ne dit rien parce qu’elle aime beaucoup Bergogne, qu’elle a toujours appelé comme ça, comme on appelait son père, avant que l’agriculture intensive le tue, avant que ses deux autres fils se fassent la malle et laissent Patrice à ses dettes, à ses bêtes et à ses insatisfactions, que la rencontre – via Internet – avec Marion n’a pas comblées. Il est aux petits oignons pour elle, pourtant, s’apprête à mettre les petits plats dans les grands pour lui faire la surprise : il est allé à la ville lui acheter un ordinateur, est passé chez Picard pour prendre des ris de veau, puisqu’elle les aime, a pris un quart d’heure pour trouver chez une prostituée ce que Marion ne lui concède (presque) plus – Oui, il est un homme et il veut baiser - a crevé en route, s’est blessé à un doigt… Ça l’a mis en retard et il n’a rien su, en son absence, du premier passage d’un homme dans le hameau, dont Christine s’est immédiatement méfiée. Il veut prétendument visiter la maison laissée libre, dont tous, ici, savent que personne ne l’a mise en vente. C’est Christophe, obséquieux dans son discours et son sourire, qui prépare le terrain ; arrivera le Bègue, le jeune frère, qui réglera la question du chien dans un passage terrible où le crime se mêle à la pâtisserie, sur fond des suites de Bach par Gastinel, que Christine écoute à fort volume, ce qui ne lui permet pas d’entendre les bruits, de les reconnaître comme chacun a appris à le faire, ici. Ils vont prendre en otage la peintre et l’enfant, le père quand il arrive enfin, se dispatchent sur les deux lieux – d’une maison l’autre, le Bègue dans l’atelier avec Christine, les autres dans la maison, à préparer l’arrivée de Marion. À partir de là, les chapitres sont alternés, on a le récit de la relation Le Bègue – qui sort d’un centre spécialisé pour attardés – Christine, l’évolution d’un syndrome de Stockholm inversé, et celui de la maison d’à côté, dans laquelle arrive Denis, le plus âgé des frères. Le meneur d’hommes, quand il est là, parce que pendant dix ans, il a payé pour des fautes qu’il va incomber à Marion… Qui, alors qu’elle passe le seuil de sa maison – avec bannière, table dressée et champagne au frais – est rattrapée par son passé. T’as vraiment cru qu’on t’oublierait ? lâche Denis, qui jubile de la situation, reçoit les deux amies de Marion (Nathalie et Lydie, invitées pour le dessert, avec Christine, censée le fournir) avec courtoisie, si bien qu’elles ne se rendent compte de rien, estiment qu’il compense l’attitude renfermée de Bergogne et Marion, dont elles vantent pourtant les mérites, puisqu’elle les a sauvées, dans l’après-midi, d’une faute professionnelle dont on voulait les accabler. La scène de captivité – passée par la sidération, les pulsions de violence, l’accablement – est vue, via un narrateur omniscient, par Bergogne, par Marion, par Ida et son regard d’enfant, qui voit son livre de chevet – Histoires de la nuit – toucher une réalité sur laquelle ses parents, elle le comprend maintenant, n’ont qu’un pouvoir restreint. Dans les deux lieux de l’action, la question est la même : Qu’est-ce qu’ils veulent ? Combien de temps cela va-t-il durer ?, prend toutes les formes de sa verbalisation silencieuse. On cesse de respirer quand Christine échappe à la surveillance du simplet de service, veut appeler la police – ils n’ont pas répondu– on retient son souffle quand Bergogne se dit qu’en décrochant son fusil de chasse, en saisissant le couteau de cuisine, il pourrait inverser le rapport de force, on se demande si Marion va dévoiler son vrai visage, on se questionne même, avec Denis, pour savoir si les vrais salauds, dans cette histoire, sont vraiment ceux qui en jouent le rôle. Quel serait, à nous, notre propre poids d’histoires à taire. Il faut gagner du temps, mais du temps sur quoi et pour en faire quoi ? Que fait-on, humainement, d’un mélange de fête et de terreur suspendues, d’un acte qui en appelle d’autres, surtout quand on laisse la surveillance d’un otage – peut-être s’il n’avait pas vu la terreur dans ses yeux, il n’aurait pas frappé - à un taré. Les images d’Oradour-sur-Glane, un village pas si lointain, surgissent sans qu’on le nomme, sorties des histoires entendues enfant, qui prennent corps, quand le drame se tend, que les armes sont sorties. Avant que Marion lâche un – D’accord, ça suffit, ça suffit, avant ce qu’enfin Marion va dire. Ou du moins ce qu’on entendra dire d’elle, dans les 90 dernières pages. Des histoires de premier train pour n’importe où de de furieux coups de pied de l’intérieur de son ventre… Et de digues qui se passent, de cercles concentriques qui se recoupent, comme toujours chez Mauvignier. Pour finir par sept coups de feu, comme dans les contes, ou presque, dont quatre toucheront leur cible, répète-t-il, pour maintenir le lecteur jusqu’au bout. Littéralement, jusqu’à la dernière ligne.
Concrètement, il se passe peu de choses, lit-on à la page… 359 d’un roman qui en fait 635 et c’est une des plus belles antiphrases de la littérature moderne, tant Histoires de la nuit tient son lecteur en haleine, l’obligeant, toujours, à un chapitre supplémentaire pour savoir ce qu’il va (enfin) advenir de ces quatre protagonistes du hameau qu’occupent Bergogne, sa femme Marion (dont c’est le 40e anniversaire, le jour du récit) et leur petite fille Ida, qui a l’âge d’aller à l’école du bourg, de regarder des dessins animés à la télé et d’attendre que sa maman rentre du bureau, que Papa ait rentré les vaches, à la Bassée (toujours), au lieu-dit Écart des trois filles seules (la voisine, la femme et l’enfant ?) ; il y a Christine, aussi, dans la ferme à côté, une artiste-peintre (exubérante et barrée) qui a renoncé à la ville pour venir habiter ici, dix ans auparavant : c’est ici et pas ailleurs qu’elle voulait vivre, vieillir, mourir . Ida adore Christine, son chien Radjah, va prendre son goûter chez elle quand l’école est terminée, ne s’étonne plus des peintures étranges et dénudées dans l’atelier – tout l’intérêt c’était que l’atelier soit dans la maison. La vie s’écoulait simple et tranquille, jusqu’à ce jour-anniversaire pour lequel Christine s’est engagée à faire des gâteaux – elle n’aime pas beaucoup Marion, qu’elle juge prétentieuse : une pétasse tatouée (au ras du cou) qui fait tout pour rentrer tard – mais garde ça pour elle : dans Histoires de la nuit, plus encore que dans tout Mauvignier, on dit peu mais on disserte sur ce qu’on ne dit pas. Ce sont les pensées qui prédominent, pas le discours, toujours restreint. Christine ne dit rien parce qu’elle aime beaucoup Bergogne, qu’elle a toujours appelé comme ça, comme on appelait son père, avant que l’agriculture intensive le tue, avant que ses deux autres fils se fassent la malle et laissent Patrice à ses dettes, à ses bêtes et à ses insatisfactions, que la rencontre – via Internet – avec Marion n’a pas comblées. Il est aux petits oignons pour elle, pourtant, s’apprête à mettre les petits plats dans les grands pour lui faire la surprise : il est allé à la ville lui acheter un ordinateur, est passé chez Picard pour prendre des ris de veau, puisqu’elle les aime, a pris un quart d’heure pour trouver chez une prostituée ce que Marion ne lui concède (presque) plus – Oui, il est un homme et il veut baiser - a crevé en route, s’est blessé à un doigt… Ça l’a mis en retard et il n’a rien su, en son absence, du premier passage d’un homme dans le hameau, dont Christine s’est immédiatement méfiée. Il veut prétendument visiter la maison laissée libre, dont tous, ici, savent que personne ne l’a mise en vente. C’est Christophe, obséquieux dans son discours et son sourire, qui prépare le terrain ; arrivera le Bègue, le jeune frère, qui réglera la question du chien dans un passage terrible où le crime se mêle à la pâtisserie, sur fond des suites de Bach par Gastinel, que Christine écoute à fort volume, ce qui ne lui permet pas d’entendre les bruits, de les reconnaître comme chacun a appris à le faire, ici. Ils vont prendre en otage la peintre et l’enfant, le père quand il arrive enfin, se dispatchent sur les deux lieux – d’une maison l’autre, le Bègue dans l’atelier avec Christine, les autres dans la maison, à préparer l’arrivée de Marion. À partir de là, les chapitres sont alternés, on a le récit de la relation Le Bègue – qui sort d’un centre spécialisé pour attardés – Christine, l’évolution d’un syndrome de Stockholm inversé, et celui de la maison d’à côté, dans laquelle arrive Denis, le plus âgé des frères. Le meneur d’hommes, quand il est là, parce que pendant dix ans, il a payé pour des fautes qu’il va incomber à Marion… Qui, alors qu’elle passe le seuil de sa maison – avec bannière, table dressée et champagne au frais – est rattrapée par son passé. T’as vraiment cru qu’on t’oublierait ? lâche Denis, qui jubile de la situation, reçoit les deux amies de Marion (Nathalie et Lydie, invitées pour le dessert, avec Christine, censée le fournir) avec courtoisie, si bien qu’elles ne se rendent compte de rien, estiment qu’il compense l’attitude renfermée de Bergogne et Marion, dont elles vantent pourtant les mérites, puisqu’elle les a sauvées, dans l’après-midi, d’une faute professionnelle dont on voulait les accabler. La scène de captivité – passée par la sidération, les pulsions de violence, l’accablement – est vue, via un narrateur omniscient, par Bergogne, par Marion, par Ida et son regard d’enfant, qui voit son livre de chevet – Histoires de la nuit – toucher une réalité sur laquelle ses parents, elle le comprend maintenant, n’ont qu’un pouvoir restreint. Dans les deux lieux de l’action, la question est la même : Qu’est-ce qu’ils veulent ? Combien de temps cela va-t-il durer ?, prend toutes les formes de sa verbalisation silencieuse. On cesse de respirer quand Christine échappe à la surveillance du simplet de service, veut appeler la police – ils n’ont pas répondu– on retient son souffle quand Bergogne se dit qu’en décrochant son fusil de chasse, en saisissant le couteau de cuisine, il pourrait inverser le rapport de force, on se demande si Marion va dévoiler son vrai visage, on se questionne même, avec Denis, pour savoir si les vrais salauds, dans cette histoire, sont vraiment ceux qui en jouent le rôle. Quel serait, à nous, notre propre poids d’histoires à taire. Il faut gagner du temps, mais du temps sur quoi et pour en faire quoi ? Que fait-on, humainement, d’un mélange de fête et de terreur suspendues, d’un acte qui en appelle d’autres, surtout quand on laisse la surveillance d’un otage – peut-être s’il n’avait pas vu la terreur dans ses yeux, il n’aurait pas frappé - à un taré. Les images d’Oradour-sur-Glane, un village pas si lointain, surgissent sans qu’on le nomme, sorties des histoires entendues enfant, qui prennent corps, quand le drame se tend, que les armes sont sorties. Avant que Marion lâche un – D’accord, ça suffit, ça suffit, avant ce qu’enfin Marion va dire. Ou du moins ce qu’on entendra dire d’elle, dans les 90 dernières pages. Des histoires de premier train pour n’importe où de de furieux coups de pied de l’intérieur de son ventre… Et de digues qui se passent, de cercles concentriques qui se recoupent, comme toujours chez Mauvignier. Pour finir par sept coups de feu, comme dans les contes, ou presque, dont quatre toucheront leur cible, répète-t-il, pour maintenir le lecteur jusqu’au bout. Littéralement, jusqu’à la dernière ligne.
Histoires de la nuit est un roman asphyxiant, qui a tous les codes du roman noir mais ne se défait jamais de sa mécanique métaphysique : toutes les pensées sont décodées, les secrets se libèrent de l’intérieur des protagonistes, qui considèrent tant ce qu’ils pourraient dire ou faire qu’ils n’ont plus besoin de le dire ou de le faire. Le dénouement – ses rebondissements - est à la hauteur du temps que le roman a suspendu et laisse un lecteur exsangue se dire que s’il ne s’est rien passé en 635 pages, ce rien-là n’aura jamais été aussi exhaustif dans ce qu’on peut imaginer de la comédie humaine et des misérables petites sommes de non-dits que nous sommes tous, finalement. Un page turner, conclut-on dans les milieux avertis.
Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, les Éditions de Minuit, 2020
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
17:27 Publié dans Blog | Lien permanent
26/06/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (9)
 J’avais une petite appréhension en extirpant mon Dans la foule de ma pile à lire : les livres qui vous ont profondément marqué sont rares, et parfois, les reprendre vous amène à vous demander pourquoi vous leur avez consacré tant d’attention, toutes ces années. Un livre qu’on a aimé, c’est comme une histoire qu’on a vécue, on a toujours un peu peur d’en avoir enjolivé le souvenir. Mais là, c’est un nouveau coup de poing reçu à l’estomac, la (re)lecture de ce roman qui avait déjà l’immense nouveauté de traiter d’un événement par un angle inattendu, indirect. Par derrière, ai-je déjà écrit à propos de Mauvignier, puisqu’il y a souvent parenté avec l’héritage sartrien.
J’avais une petite appréhension en extirpant mon Dans la foule de ma pile à lire : les livres qui vous ont profondément marqué sont rares, et parfois, les reprendre vous amène à vous demander pourquoi vous leur avez consacré tant d’attention, toutes ces années. Un livre qu’on a aimé, c’est comme une histoire qu’on a vécue, on a toujours un peu peur d’en avoir enjolivé le souvenir. Mais là, c’est un nouveau coup de poing reçu à l’estomac, la (re)lecture de ce roman qui avait déjà l’immense nouveauté de traiter d’un événement par un angle inattendu, indirect. Par derrière, ai-je déjà écrit à propos de Mauvignier, puisqu’il y a souvent parenté avec l’héritage sartrien.
L’événement, c’est la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions, le 29 mai 1985, le choc entre la Juventus de Turin – l’Italie des riches, la réussite insolente de Fiat – et des Reds de Liverpool, ville sinistrée et soumise au chômage de masse – deux belles écuries, dit-on dans le milieu, dont l’une, l’italienne, est menée par Michel Platini – pour une fois que les Français ont un joueur qui est Dieu – 30 ans à l’époque et 70 aujourd’hui même, qui dira au retour, dans l’avion, qu’il arrête le football. Non pas parce qu’il a tout gagné, y compris ce match-là, mais parce qu’il l’a gagné – et qu’il a célébré son but – alors que les deux équipes et la moitié du stade du Heysel ignoraient que les bagarres du virage Z, la charge des Anglais, la panique qui a suivi, ont provoqué 39 victimes, au final. On parle d’une dizaine de morts, entend-on dans les travées autour du stade, tout au début, puisque c’est là que l’action du roman se passe et qu’elle trouve sa genèse : la veille, Tonino & Jeff – un français de la Bassée, toujours – sont venus tenter leur chance – 11000 supporters de Liverpool, 60000 de toute l’Europe (dont beaucoup d’Italiens qui auront acheté des places belges), 400000 demandes – tant les sésames sont rares et Gabriel, tout à sa joie du poste qu’il vient de décrocher, ne se méfie pas quand il invite les deux hommes à boire un verre avec eux ; il se méfiera davantage du regard que Tonino porte à Virginie, sa compagne, mais ne verra rien du moment où il dérobe les billets dans le sac de la jeune fille. Furieux, une fois rentrés chez eux, du subterfuge commis, il se jure de les retrouver le lendemain – j’attendrai et guetterai le moindre Teddy avec Chicago inscrit au dos – et part à leur recherche, autour du stade. Là où l’Europe a rendez-vous. C’est de là qu’il vivra ce chahut et ce mouvement qui soulève les gens quand ils sont à plusieurs et que déjà ils ont bu, cette ivresse au-delà de l’alcool qui fait que les Anglais vont mettre la capitale belge sur le pied de guerre. Il ne sait rien de Francesco & Tana, que ses voleurs – un grand aux allures squelettiques (…) et l’autre, l’Italien, plus petit et bouclé – ont rencontrés dans le métro, juste avant d’aller au match : eux viennent de se marier, voyagent à destination d’Amsterdam avec arrêt à Bruxelles pour assister au match, puisqu’on leur a offert le Graal. On ne meurt pas pendant son voyage de noces, se répètera Tana, hébétée, après que son homme l’aura sauvée de la horde – cours, Tana– quand lui périra étouffée par une foule bloquée, en bas des tribunes, par des barrières de béton – désormais interdites – qui ne céderont pas et provoqueront l’étouffement de nombreux spectateurs. C’est une scène qui ressemble à la porte des Enfers, et les supplications de Tana – Francesco, ne me protège pas- résonneront longtemps après, dans toute la narration, en fait. Aucun d’entre eux, ni Tonino, ni Jeff – et les livres qu’il écrirait – ni Francesco, ni Tana, ni Gabriel, ni Virginie ne savent (encore) rien des frères Andrewson, dont Geoff, le benjamin - parti avec Doug et Hugie sans doute parce qu’ils n’ont pas réussi à convaincre leur père de prendre la 3e place – découvre l’effet de masse, les faces rouges et rondes pour la plupart, à moins, au contraire, qu’elles soient maigres et cassées, les hectolitres de bière consommés et les England ! England ! qui fusent. C’est par Geoff, qui se demande s’il est vraiment en train de faire ça, qu’on remontera l’écheveau de la misère sociale, la mère qui les défendra à distance et jusqu’au bout, avec cet aveu terrible, dans le roman : il parait que c’est une croyance très anglaise et très optimiste, au final, de penser que si l’on ne dit rien des choses terribles, elles ont d’elles-mêmes la faculté de s’estomper et de se dissoudre dans les brumes du Midland. C’est par Geoff qu’on comprendre les mécanismes de la sauvagerie, sa fatalité, aussi, la honte et la disgrâce, dira Margaret Thatcher, tombées sur (leur) pays. Tu veux croire qu’on t’aimera en faisant comme ils font, lâche Elsie, sa petite amie, à Geoff, à son retour : elle est infirmière, lit Rimbaud dans le texte, elle le sauvera sans doute quand ses frères et leurs amis sont déjà damnés avant d’être condamnés.
C’est par le biais de ces narrateurs divers, Jeff, Gabriel, Tana, Geoff, par leurs positions (dedans/dehors) que les cercles concentriques se rapprochent, qu’on aborde l’événement par ses frontières narratives. Par des actions secondaires, anodines – la jalousie qui fait que Gabriel, retrouvant Tonino inanimé, va effacer le numéro de téléphone de Virginie qu’il avait laissé inscrit sur sa main – qu’on aborde l’essentiel, cette chose que l’Europe entière a vue en croyant ne pas la voir. Par le dérisoire des objets – rien de plus insurmontable que l’existence de deux brosses à dents et d’un gobelet en plastique - que Tana prend conscience de la perte à venir. Se dire que ça ne tenait qu’à un grillage et à un mur de béton. La troisième et dernière partie porte sur le deuil insurmontable – reprendre le dessus, tu parles d’une expression à la con ! – et des répercussions qu’aura le procès (de 26 visages, de 24 meurtriers), trois ans et quelques mois après le drame. C’est la ouate, entre temps, a trusté les charts en France, mais la chanson est à prendre au sens premier, tant Tana n’a aucune intention de s’en sortir, puisque s’en sortir, c’est accepter le pire. Il faudra un voyage en Italie et en Sardaigne pour que les cercles se bousculent d’eux-mêmes, encore, et qu’un après se dessine, peut-être. Qu’on aille au-delà de l’étourdissement.
Les clubs anglais seront interdits de compétition en Europe pendant cinq ans, les mesures de sécurité prises seront drastiques, les condamnations ont été lourdes – même le secrétaire général de l'UEFA a écopé de trois mois de prison avec sursis et 30 000 francs belges d'amende – mais il faudra du temps pour que le You’ll never walk alonereprenne ses lettres de noblesse autour des stades. Qu’on se souvienne que Liverpool, c’est d’abord Paul, John, Georges et Ringo. Et que chacun comprenne que la sauvagerie, quand elle est motivée par des pulsions identitaires, n’a pas de Nation.
Laurent Mauvignier, Dans la foule, les Éditions de Minuit, 2006
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
20:04 Publié dans Blog | Lien permanent
18/06/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (6)
 Je n’ai pas beaucoup mémoire d’avoir été parcouru d’un tel frisson à la toute fin d’un roman. Peut-être s’explique-t-il par la part de culpabilité de ne l’avoir pas lu avant, d’avoir connu une époque où je ne lisais plus les livres d’un auteur que j’ai pourtant toujours trouvé essentiel ? Qu’importe, la fin, renversée, de Continuer, 10e roman de Laurent Mauvignier, paru en 2016, m’a tellement bouleversé après que le roman m’a tenu en haleine que j’ai eu de la peine à quitter ces personnages. Samuel et Sibylle, le fils et la mère, qu’on trouve, directement, confrontés à des possibles voleurs de chevaux, une culture au Kirghizistan, ce pays montagneux d’Asie Centrale dans lequel mère et fils se sont exilés pour trois mois, en solitaire et à cheval, donc, puisque c’est tout ce qu’ils ont partagé en 16 ans, marqués par une séparation, un déménagement (à Bordeaux) et un décrochage, à tous les niveaux. Sibylle veut sauver son fils de la perte, rattraper sa vie à elle qui part à vau-l’eau (on saura plus tard pourquoi) : est-ce qu’elle va finir de tomber, comme elle voit que son fils est en train de tomber ? l’acte fondateur (décider) est là, elle vend la maison paternelle à laquelle elle semblait tant tenir, prend une disponibilité de son travail d’infirmière – quand tout la destinait à devenir chirurgien – va contre les moqueries de son ex, Benoit, le père de Samuel, qui n’a de cesse de la ramener – ma pauvre chérie – à tous ses échecs précédents, au sens des réalités qu’elle n’a jamais eu, selon lui. Quand elle le fait venir, chez elle, alors qu’elle s’était juré qu’il n'y mettrait jamais les pieds, il tourne tout en dérision, se moque du robinet qui fuit (ploc)comme s’il était l’incarnation de sa propre nécessité conjugale, se dit qu’un bon pensionnat réglerait tout, comme ça l’a fait pour lui. Mais si Sibylle s’accroche à son idée folle, c’est qu’elle sait que c’est le seul moyen de sortir de sa dépression, de retrouver l’essentiel en renonçant aux fausses valeurs occidentales. Au pays des Chevaux Célestes, elle attend que Starman & Sidious, les montures qu’elle a achetées et que Samuel a nommées – pour Bowie & Star Wars – montrent à son fils qu’elles sont plus que des chevaux, enfin, qu’elles sont devenues des chevaux, qu’il faut comprendre, gérer, bichonner. Elle veut qu’il comprenne la valeur d’une simple bouteille d’eau, de quelques feuilles de papier-toilette, il faut que tu prennes, dit-elle, le moins de place possible dans le monde qui va t’accueillir. L’adolescent taciturne, skinhead en perdition, va regimber, s’enfermer dans ses écouteurs, mais suivre le rythme, dense, vivre les soirées chez les nomades qui accueillent, toujours, parce que c’est la coutume : il y a toujours un homme pour expliquer qu’on doit aider celui qui passe devant la porte de notre maison : si les portes des yourtes ne se ferment pas, c’est uniquement pour respecter cette règle. Sa mère leur parle russe – la langue de ses grands-parents – il en a les bases mais ne dit rien, s’agace de ce que Sibylle pût être populaire, voire plaire à un des randonneurs (français) qu’ils croisent, deux fois. Au fur et à mesure qu’ils avancent dans le périple, qu’ils tombent dans le piège facilement, sans se rendre compte qu’il se renferme sur eux et qu’ils ne pourront pas faire machine arrière, Mauvignier, par analepses, éclaire le passé de Sibylle, quand elle espérait encore en la vie, qu’elle aimait éperdument Gaël, ce motard rencontré sur fond de station essence ExxonMobil, avec le cheval ailé comme symbole qui peuple encore ses cauchemars, récurrents, qu’elle se destinait à la chirurgie et qu’elle avait même écrit un roman, accepté par les éditeurs, comme Beckett – d’où le prénom de son fils – ou Modiano, sans en croire ses oreilles. Il raconte l’histoire d’une vie ancienne, d’une vie morte, dont ne subsistent que la honte, le dégoût, le mépris de soi. Il use de l’anaphore – pourtant, X3 – pour dire à quel point elle était bien partie, dans la vie, et que tout s’est écroulé. À coup d’attentat à la station RER B à Saint-Michel - le 25 juillet 1995, revendiqué par le Groupe islamique armé algérien – une faille dans ses valeurs humanistes qu’elle a tu mais qui ressurgira un soir où Samuel, qui a trop bu, lâchera - sans rien savoir de ce qui s’est passé dans la vie de sa mum’- une diatribe anti-musulmans (les Arabes) stupide et confuse : il a peur des images qu’il voit des banlieues, lui qui n’y est jamais allé. C’est le point de rupture dans le voyage, la séparation brutale, un dénouement violent. Les vies secrètes de deux voyageurs ont pourtant un point commun, qui agira comme un révélateur dans une chute dramatiquement belle : le Heroes de David Bowie, une chanson qui parle de se maintenir debout même si c’est pour un jour, d’être ensemble, des héros pour un jour.
Je n’ai pas beaucoup mémoire d’avoir été parcouru d’un tel frisson à la toute fin d’un roman. Peut-être s’explique-t-il par la part de culpabilité de ne l’avoir pas lu avant, d’avoir connu une époque où je ne lisais plus les livres d’un auteur que j’ai pourtant toujours trouvé essentiel ? Qu’importe, la fin, renversée, de Continuer, 10e roman de Laurent Mauvignier, paru en 2016, m’a tellement bouleversé après que le roman m’a tenu en haleine que j’ai eu de la peine à quitter ces personnages. Samuel et Sibylle, le fils et la mère, qu’on trouve, directement, confrontés à des possibles voleurs de chevaux, une culture au Kirghizistan, ce pays montagneux d’Asie Centrale dans lequel mère et fils se sont exilés pour trois mois, en solitaire et à cheval, donc, puisque c’est tout ce qu’ils ont partagé en 16 ans, marqués par une séparation, un déménagement (à Bordeaux) et un décrochage, à tous les niveaux. Sibylle veut sauver son fils de la perte, rattraper sa vie à elle qui part à vau-l’eau (on saura plus tard pourquoi) : est-ce qu’elle va finir de tomber, comme elle voit que son fils est en train de tomber ? l’acte fondateur (décider) est là, elle vend la maison paternelle à laquelle elle semblait tant tenir, prend une disponibilité de son travail d’infirmière – quand tout la destinait à devenir chirurgien – va contre les moqueries de son ex, Benoit, le père de Samuel, qui n’a de cesse de la ramener – ma pauvre chérie – à tous ses échecs précédents, au sens des réalités qu’elle n’a jamais eu, selon lui. Quand elle le fait venir, chez elle, alors qu’elle s’était juré qu’il n'y mettrait jamais les pieds, il tourne tout en dérision, se moque du robinet qui fuit (ploc)comme s’il était l’incarnation de sa propre nécessité conjugale, se dit qu’un bon pensionnat réglerait tout, comme ça l’a fait pour lui. Mais si Sibylle s’accroche à son idée folle, c’est qu’elle sait que c’est le seul moyen de sortir de sa dépression, de retrouver l’essentiel en renonçant aux fausses valeurs occidentales. Au pays des Chevaux Célestes, elle attend que Starman & Sidious, les montures qu’elle a achetées et que Samuel a nommées – pour Bowie & Star Wars – montrent à son fils qu’elles sont plus que des chevaux, enfin, qu’elles sont devenues des chevaux, qu’il faut comprendre, gérer, bichonner. Elle veut qu’il comprenne la valeur d’une simple bouteille d’eau, de quelques feuilles de papier-toilette, il faut que tu prennes, dit-elle, le moins de place possible dans le monde qui va t’accueillir. L’adolescent taciturne, skinhead en perdition, va regimber, s’enfermer dans ses écouteurs, mais suivre le rythme, dense, vivre les soirées chez les nomades qui accueillent, toujours, parce que c’est la coutume : il y a toujours un homme pour expliquer qu’on doit aider celui qui passe devant la porte de notre maison : si les portes des yourtes ne se ferment pas, c’est uniquement pour respecter cette règle. Sa mère leur parle russe – la langue de ses grands-parents – il en a les bases mais ne dit rien, s’agace de ce que Sibylle pût être populaire, voire plaire à un des randonneurs (français) qu’ils croisent, deux fois. Au fur et à mesure qu’ils avancent dans le périple, qu’ils tombent dans le piège facilement, sans se rendre compte qu’il se renferme sur eux et qu’ils ne pourront pas faire machine arrière, Mauvignier, par analepses, éclaire le passé de Sibylle, quand elle espérait encore en la vie, qu’elle aimait éperdument Gaël, ce motard rencontré sur fond de station essence ExxonMobil, avec le cheval ailé comme symbole qui peuple encore ses cauchemars, récurrents, qu’elle se destinait à la chirurgie et qu’elle avait même écrit un roman, accepté par les éditeurs, comme Beckett – d’où le prénom de son fils – ou Modiano, sans en croire ses oreilles. Il raconte l’histoire d’une vie ancienne, d’une vie morte, dont ne subsistent que la honte, le dégoût, le mépris de soi. Il use de l’anaphore – pourtant, X3 – pour dire à quel point elle était bien partie, dans la vie, et que tout s’est écroulé. À coup d’attentat à la station RER B à Saint-Michel - le 25 juillet 1995, revendiqué par le Groupe islamique armé algérien – une faille dans ses valeurs humanistes qu’elle a tu mais qui ressurgira un soir où Samuel, qui a trop bu, lâchera - sans rien savoir de ce qui s’est passé dans la vie de sa mum’- une diatribe anti-musulmans (les Arabes) stupide et confuse : il a peur des images qu’il voit des banlieues, lui qui n’y est jamais allé. C’est le point de rupture dans le voyage, la séparation brutale, un dénouement violent. Les vies secrètes de deux voyageurs ont pourtant un point commun, qui agira comme un révélateur dans une chute dramatiquement belle : le Heroes de David Bowie, une chanson qui parle de se maintenir debout même si c’est pour un jour, d’être ensemble, des héros pour un jour.
Mauvignier excelle dans la façon de reconstituer, par petites touches, les éléments qui ont fait une vie avant la vie qu’il narre, et se sert d’un roman d’aventures* - paysages et cultures à l’appui - pour écrire sur l’élément fondateur de toute création, l’amour infini d’une mère pour son fils. À ce titre, le renversement final, que Benoît, le père, qui se croyait imbattable, sur tous les terrains, perçoit via une partie de oulak-tartych, ce jeu où les jeunes s’affrontent (à cheval) autour d’un mouton décapité, est éloquent. Sans un mot, comme toujours, chez Mauvignier.
*idée venue de la lecture d’un article du Monde en 2014
Laurent Mauvignier, Continuer, les Éditions de Minuit, 2016
18:45 Publié dans Blog | Lien permanent
14/06/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (4)
 Autour du monde, paru en 2014, a reçu le Prix Amerigo-Vespucci, décerné au festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, qui récompense des ouvrages portant sur le thème de l'aventure et du voyage. Ça tombe bien, parce que le 10e roman de Laurent Mauvignier porte parfaitement son titre, et s’appuie sur un événement majeur de l’histoire de la géographie (et ses corollaires), le tsunami du 11 mars 2011 au Japon, un séisme de magnitude 9,1 survenu dans les profondeurs de l'océan Pacifique, qui déclencha une vague meurtrière qui fit 20 000 morts et laissa derrière elle un demi-million de personnes sans-abris. C’est d’abord via Guillermo, un Mexicain en visite au Japon – un départ subit, comme il les aime – qu’on va assister, sur place, à la genèse de la catastrophe : il est avec Yûko, rencontrée depuis peu, ils forment depuis 72h un couple bukowskien à base d’alcool, de drogues, de sexe sauvage et de bagarres, ils partent sur un coup de tête pour le Sud du pays – elle l’invite sans vraiment lui demander de venir, simplement en ne lui interdisant pas de le faire – il est tout à ses pensées sur le corps tatoué de la jeune fille – à l’énergie d’une bête marine et secrète - quand ça arrive lentement, un frissonnement. Deux minutes de tremblement avant la vague. Sur la première phase, Yûko sait ce qu’il faut faire : on l’a appris à l’école. Guillermo, lui, doit sa vie – ironie – au séisme de Mexico, en 1985, mais dans sa stupéfaction, il ira là où il ne fallait surtout pas aller ; Yûko n’a pas la force de le prévenir, elle sait au fond d’elle-même que des milliers de gens vont mourir ici. On ne trouvera trace d’elle que dans les autres récits dans le récit, enchâssés ; Mauvignier, c’est sa marque de fabrique, passe d’une histoire à une autre au sein d’une même phrase ; c’est Frantz, qu’on retrouve en croisière, à bord de l’OdysseeA, en pleine Mer du Nord. Il est seul à bord, ne s’accommode pas de la compagnie des autres, surtout ceux qui, comme lui, ont gagné le voyage – les Heureux Gagnants – au supermarché, comme dans Loin d’eux, tiens. Tout juste ouvre-t-il un œil sur le mystérieux Dimitri Khrenov, parce qu’il trouve sa fille Véra à son goût. C’est par l’information reçue de la catastrophe au Japon que le lien se fait, puisque Dimitri est un sismologue rompu à la tectonique des plaques qui tient conférence (improvisée) dans un salon, s’émerveillant d’un monstre à 800 km/h devant des croisiéristes qui ne goûtent guère le catastrophisme. Pas moi qui suis responsable s’ils construisent des villes entières là où leurs ancêtres savaient qu’il ne fallait pas le faire, maugrée-t-il. Avant que Frantz, dans le récit, lui sauve la vie puisque, frappé d’Alzheimer, il s’est aventuré quasi-nu sur les pontons, en pleine nuit… On bascule une fois de plus, devant des images des Bahamas et de République Dominicaine, avec l’histoire de Taha et Yasemin, venus d’Istanbul ; Taha est un professeur de sport qui a peur de l’eau – la peur dans tout le corps – mais il la surmontera en compagnie des dauphins. Mauvignier compose un puzzle fait de grandes et de petites pièces, puisqu’on passe sans prévenir à l’aéroport de Tel-Aviv, avec Salma qui arrive le 10 mars – veille de la catastrophe – et se fait arracher son sac par un voleur profitant de la panique liée à un attentat raté, dans l’aéroport. On est dans l’actualité du Printemps arabe, elle vient se confronter, à 46 ans, à l’origine de ses grands-parents, à une histoire familiale faite de secrets et de non-dits. Elle prend un taxi pour Jérusalem, la ville trois fois sacrée, ses six millions d’arbres qui la cernent à la mémoire des six millions de déportés, rencontre Luli, avec qui elle va s’entendre, confronter leur vision du passé qui détermine le présent, elles iront à Yad Vashem, le mémorial des victimes de la Shoah, entre deux monologues intérieurs – son grand-père était-il nazi, est-ce pour ça qu’il s’est retrouvé au Chili, là où sa mère et elle sont nées ? – ou débats enflammés (comment voulez-vous que sept millions de Juifs entourés par une centaine de millions d’Arabes ne soient pas perpétuellement inquiets ?) sur ce qui fait les origines et l’identité. Puis on passe à Moscou, dans le froid, avec Syafiq, de Kuala Lumpur, qui regarde à la télé les images du Japon, s’intéresse à cette miraculée sauvée par sa doudoune qui lui a servi de bouée (Yûko). Il veut faire du tourisme, sans conviction, termine chez Mc Donald’s pour bien souligner l’absurde que la mondialisation a créé, retrouve Stas qui prétexte l’accouchement de sa femme pour l’éviter pour, finalement, se noyer dans un épisode de sexe sauvage, qui clôture une histoire d’amour née à Rio – le bracelet brésilien en est témoin – qui ne dépassera pas la nuit. L’énonciation s’accélère, chez Mauvignier, qui écrit au futur simple et use du On pour mieux souligner l’antiphrase puisqu’aucun avenir n’est possible entre eux et que leur union n’est qu’une chimère. On n’en saura pas plus puisque c’est Monsieur Arroyo qui a pris le relais du récit : il est Philippin, préposé aux serviettes dans un hôtel de luxe à Dubaï. Il ne se plaint pas, dans ce décorum où l’eau, le sable, les palmiers ont été construits, il a embarqué, jeune, pour changer de vie, très loin de la misère, il est maintenant à l’ombre de la richesse, c’est déjà, considère-t-il, être presque riche soi-même. Que la Française fortunée, qu’il attirait quand elle était seule, fasse semblant de ne plus le connaître une fois son mari arrivé, n’a aucune espèce d’importance pour lui : de toute façon, Monsieur Arroyo ne pose pas de questions. Coïncidence, on enchaîne avec Dorothée et Denis, des jeunes mariés en partance pour le pays qu’il a fui – mais dans lequel il retournera mourir – les Philippines ; juste le temps, dans l’avion, de percevoir l’envers du décor de l’idylle, les tromperies qu’on n’a pas pardonnées et on débarque dans le cratère du Ngorongoro, en Tanzanie, avec Stephen et Stuart et leurs épouses Jennifer et Maureen, interchangeables dans leur fonction de working girls uper-class australienne. L’Afrique, elles connaissent, mais ça n’empêche pas Stuart de descendre du 4X4, à la grande surprise de tous, pour s’avancer vers les lions, seul avec son appareil photo. Un geste – le luxe de l’adrénaline, l’apparence du danger - qui fera ressortir les vieilles histoires, les coucheries, la rivalité et des secrets plus lourds encore. Il fallait mettre en scène sa supériorité sur le reste de ses concurrents : la photo – les siennes sont toutes ratées- prise par sa femme trônera au-dessus de son bureau, à Sydney. Peter, lui, est noir, mais ne connaît rien à l’Afrique, c’est à Rome qu’on le retrouve, une ville qu’il connaît par cœur, lui, le Londonien, mais c’est la première fois qu’il s’y retrouve au bras d’une jolie jeune fille, Fancy, qu’il a ravie à Owen… son propre fils. Peter veut garder Rome comme sa ville éternelle, il est loin des préoccupations humanitaires de son fils – mon père est un putain de Noir qui méprise tous les Noirs – se heurte psychanalytiquement au Moïse de Michel-Ange (dans le Rione Monti, dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens) quand Fancy, elle, découvre à la télévision, aussi, les ravages d’un séisme d’une magnitude de 8,9, les mêmes images d’une Japonaise miraculée qui fait le lien entre les histoires. Le monde entier est reconstitué autour d’une même articulation, qui l’a secoué. Juan et Paula passe le Golfe d’Aden, en Somalie, quand des pirates attaquent leur catamaran : leur tour du monde s’arrêtera là, parce que le vieux flic en retraite n’a pas voulu s’avouer vaincu. On passe vite à Giorgio et Ernesto, les Italiens, qui se sont liés quand la femme du premier est partie et celle du second est décédée ; ils vivotent, se chamaillent un peu quand le premier convainc le second de partir à la frontière slovène, à Nova Garica, dans le plus grand casino d’Europe ; la veille du départ, les deux sont pris de scrupules et les rôles s’inversent, il est question de la peur de gagner pour l’un, de réhabiliter son image pour l’autre – en aidant son ex-femme à mourir dignement – de Géronimo, le chien, qui s’est échappé, de ce court voyage qu’ils feront quand même avec ceux qui ont payé une misère ce qui va leur coûter une fortune. Alec et Jaycee partent eux pour la Thaïlande avec Samran et Lisbeth : c’est dans ce pays que Jaycee va, petit à petit, se laisser habiter par les esprits, elle, l’Occidentale qui se désole qu’on ne puisse pas parler de ces choses-là chez elle sans passer pour une cinglée. Elle disparait une nuit, et le lecteur remonte l’écheveau de ses failles, de son enfance, de sa maternité, avant de basculer sur une scène d’autostop et de Mc Donald’s, de nouveau, entre Bill et Mojito – un gros lard de Portoricain - destination la Floride ; c’est au comptoir du diner que les images de CNN leur montrent tout le Nord-Est du Japon rayé en rouge, mais les deux hommes n’y font pas attention ; il y aura l’histoire des deux frères Mitch– l’écrivain qui n’a pas écrit une ligne depuis cinq ans - et Vince, d’un parricide évité de justesse, un conducteur raciste et acariâtre qui n’aime pas Obama, Deanna, la banalité de l’Amérique qui a renoncé, il y a à la télé, dans les brumes de l’explosion de Fukushima, l’idée que le Japon, si lointain, va les emmener ailleurs. Je peux te dire que j’en ai rien à foutre, si tu veux, rétorque Vince. Il y a Disneyland le lendemain pour réconcilier la famille – moins le frère reparti sans un mot – il y a Fumi et ses parents en voyage à Paris, Fumi, qui veut téléphoner à ses grands-parents…au Japon, Autour du monde, c’est l’histoire de tous ces gens qui ne se rencontreront jamais liés par un instant, un seul, celui qui a fait basculer le monde sans que ceux qui n’ont pas été directement touchés lui accordent la moindre importance. C’est l’histoire d’un monde global mais fragmenté, isolé dans chacune des solitudes qu’incarnent la farandole de personnages que décrit Mauvignier, un kaléidoscope de cultures restreint, parfois, au pire de chacune d’entre elles. Quand un événement – un vrai, celui déterminé par son immédiateté, son intensité et son historicité – se déroule dans le monde, chacun se souvient, des années après, ce qu’il faisait à cet instant précis. Laurent Mauvignier s’est une fois de plus servi de ses cercles concentriques narratifs pour se souvenir de ce qui a précédé – juste avant – le 11 mars 2011, ce qui a suivi également : les répliques ne sont pas toujours que sismiques quand le monde a bougé.
Autour du monde, paru en 2014, a reçu le Prix Amerigo-Vespucci, décerné au festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, qui récompense des ouvrages portant sur le thème de l'aventure et du voyage. Ça tombe bien, parce que le 10e roman de Laurent Mauvignier porte parfaitement son titre, et s’appuie sur un événement majeur de l’histoire de la géographie (et ses corollaires), le tsunami du 11 mars 2011 au Japon, un séisme de magnitude 9,1 survenu dans les profondeurs de l'océan Pacifique, qui déclencha une vague meurtrière qui fit 20 000 morts et laissa derrière elle un demi-million de personnes sans-abris. C’est d’abord via Guillermo, un Mexicain en visite au Japon – un départ subit, comme il les aime – qu’on va assister, sur place, à la genèse de la catastrophe : il est avec Yûko, rencontrée depuis peu, ils forment depuis 72h un couple bukowskien à base d’alcool, de drogues, de sexe sauvage et de bagarres, ils partent sur un coup de tête pour le Sud du pays – elle l’invite sans vraiment lui demander de venir, simplement en ne lui interdisant pas de le faire – il est tout à ses pensées sur le corps tatoué de la jeune fille – à l’énergie d’une bête marine et secrète - quand ça arrive lentement, un frissonnement. Deux minutes de tremblement avant la vague. Sur la première phase, Yûko sait ce qu’il faut faire : on l’a appris à l’école. Guillermo, lui, doit sa vie – ironie – au séisme de Mexico, en 1985, mais dans sa stupéfaction, il ira là où il ne fallait surtout pas aller ; Yûko n’a pas la force de le prévenir, elle sait au fond d’elle-même que des milliers de gens vont mourir ici. On ne trouvera trace d’elle que dans les autres récits dans le récit, enchâssés ; Mauvignier, c’est sa marque de fabrique, passe d’une histoire à une autre au sein d’une même phrase ; c’est Frantz, qu’on retrouve en croisière, à bord de l’OdysseeA, en pleine Mer du Nord. Il est seul à bord, ne s’accommode pas de la compagnie des autres, surtout ceux qui, comme lui, ont gagné le voyage – les Heureux Gagnants – au supermarché, comme dans Loin d’eux, tiens. Tout juste ouvre-t-il un œil sur le mystérieux Dimitri Khrenov, parce qu’il trouve sa fille Véra à son goût. C’est par l’information reçue de la catastrophe au Japon que le lien se fait, puisque Dimitri est un sismologue rompu à la tectonique des plaques qui tient conférence (improvisée) dans un salon, s’émerveillant d’un monstre à 800 km/h devant des croisiéristes qui ne goûtent guère le catastrophisme. Pas moi qui suis responsable s’ils construisent des villes entières là où leurs ancêtres savaient qu’il ne fallait pas le faire, maugrée-t-il. Avant que Frantz, dans le récit, lui sauve la vie puisque, frappé d’Alzheimer, il s’est aventuré quasi-nu sur les pontons, en pleine nuit… On bascule une fois de plus, devant des images des Bahamas et de République Dominicaine, avec l’histoire de Taha et Yasemin, venus d’Istanbul ; Taha est un professeur de sport qui a peur de l’eau – la peur dans tout le corps – mais il la surmontera en compagnie des dauphins. Mauvignier compose un puzzle fait de grandes et de petites pièces, puisqu’on passe sans prévenir à l’aéroport de Tel-Aviv, avec Salma qui arrive le 10 mars – veille de la catastrophe – et se fait arracher son sac par un voleur profitant de la panique liée à un attentat raté, dans l’aéroport. On est dans l’actualité du Printemps arabe, elle vient se confronter, à 46 ans, à l’origine de ses grands-parents, à une histoire familiale faite de secrets et de non-dits. Elle prend un taxi pour Jérusalem, la ville trois fois sacrée, ses six millions d’arbres qui la cernent à la mémoire des six millions de déportés, rencontre Luli, avec qui elle va s’entendre, confronter leur vision du passé qui détermine le présent, elles iront à Yad Vashem, le mémorial des victimes de la Shoah, entre deux monologues intérieurs – son grand-père était-il nazi, est-ce pour ça qu’il s’est retrouvé au Chili, là où sa mère et elle sont nées ? – ou débats enflammés (comment voulez-vous que sept millions de Juifs entourés par une centaine de millions d’Arabes ne soient pas perpétuellement inquiets ?) sur ce qui fait les origines et l’identité. Puis on passe à Moscou, dans le froid, avec Syafiq, de Kuala Lumpur, qui regarde à la télé les images du Japon, s’intéresse à cette miraculée sauvée par sa doudoune qui lui a servi de bouée (Yûko). Il veut faire du tourisme, sans conviction, termine chez Mc Donald’s pour bien souligner l’absurde que la mondialisation a créé, retrouve Stas qui prétexte l’accouchement de sa femme pour l’éviter pour, finalement, se noyer dans un épisode de sexe sauvage, qui clôture une histoire d’amour née à Rio – le bracelet brésilien en est témoin – qui ne dépassera pas la nuit. L’énonciation s’accélère, chez Mauvignier, qui écrit au futur simple et use du On pour mieux souligner l’antiphrase puisqu’aucun avenir n’est possible entre eux et que leur union n’est qu’une chimère. On n’en saura pas plus puisque c’est Monsieur Arroyo qui a pris le relais du récit : il est Philippin, préposé aux serviettes dans un hôtel de luxe à Dubaï. Il ne se plaint pas, dans ce décorum où l’eau, le sable, les palmiers ont été construits, il a embarqué, jeune, pour changer de vie, très loin de la misère, il est maintenant à l’ombre de la richesse, c’est déjà, considère-t-il, être presque riche soi-même. Que la Française fortunée, qu’il attirait quand elle était seule, fasse semblant de ne plus le connaître une fois son mari arrivé, n’a aucune espèce d’importance pour lui : de toute façon, Monsieur Arroyo ne pose pas de questions. Coïncidence, on enchaîne avec Dorothée et Denis, des jeunes mariés en partance pour le pays qu’il a fui – mais dans lequel il retournera mourir – les Philippines ; juste le temps, dans l’avion, de percevoir l’envers du décor de l’idylle, les tromperies qu’on n’a pas pardonnées et on débarque dans le cratère du Ngorongoro, en Tanzanie, avec Stephen et Stuart et leurs épouses Jennifer et Maureen, interchangeables dans leur fonction de working girls uper-class australienne. L’Afrique, elles connaissent, mais ça n’empêche pas Stuart de descendre du 4X4, à la grande surprise de tous, pour s’avancer vers les lions, seul avec son appareil photo. Un geste – le luxe de l’adrénaline, l’apparence du danger - qui fera ressortir les vieilles histoires, les coucheries, la rivalité et des secrets plus lourds encore. Il fallait mettre en scène sa supériorité sur le reste de ses concurrents : la photo – les siennes sont toutes ratées- prise par sa femme trônera au-dessus de son bureau, à Sydney. Peter, lui, est noir, mais ne connaît rien à l’Afrique, c’est à Rome qu’on le retrouve, une ville qu’il connaît par cœur, lui, le Londonien, mais c’est la première fois qu’il s’y retrouve au bras d’une jolie jeune fille, Fancy, qu’il a ravie à Owen… son propre fils. Peter veut garder Rome comme sa ville éternelle, il est loin des préoccupations humanitaires de son fils – mon père est un putain de Noir qui méprise tous les Noirs – se heurte psychanalytiquement au Moïse de Michel-Ange (dans le Rione Monti, dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens) quand Fancy, elle, découvre à la télévision, aussi, les ravages d’un séisme d’une magnitude de 8,9, les mêmes images d’une Japonaise miraculée qui fait le lien entre les histoires. Le monde entier est reconstitué autour d’une même articulation, qui l’a secoué. Juan et Paula passe le Golfe d’Aden, en Somalie, quand des pirates attaquent leur catamaran : leur tour du monde s’arrêtera là, parce que le vieux flic en retraite n’a pas voulu s’avouer vaincu. On passe vite à Giorgio et Ernesto, les Italiens, qui se sont liés quand la femme du premier est partie et celle du second est décédée ; ils vivotent, se chamaillent un peu quand le premier convainc le second de partir à la frontière slovène, à Nova Garica, dans le plus grand casino d’Europe ; la veille du départ, les deux sont pris de scrupules et les rôles s’inversent, il est question de la peur de gagner pour l’un, de réhabiliter son image pour l’autre – en aidant son ex-femme à mourir dignement – de Géronimo, le chien, qui s’est échappé, de ce court voyage qu’ils feront quand même avec ceux qui ont payé une misère ce qui va leur coûter une fortune. Alec et Jaycee partent eux pour la Thaïlande avec Samran et Lisbeth : c’est dans ce pays que Jaycee va, petit à petit, se laisser habiter par les esprits, elle, l’Occidentale qui se désole qu’on ne puisse pas parler de ces choses-là chez elle sans passer pour une cinglée. Elle disparait une nuit, et le lecteur remonte l’écheveau de ses failles, de son enfance, de sa maternité, avant de basculer sur une scène d’autostop et de Mc Donald’s, de nouveau, entre Bill et Mojito – un gros lard de Portoricain - destination la Floride ; c’est au comptoir du diner que les images de CNN leur montrent tout le Nord-Est du Japon rayé en rouge, mais les deux hommes n’y font pas attention ; il y aura l’histoire des deux frères Mitch– l’écrivain qui n’a pas écrit une ligne depuis cinq ans - et Vince, d’un parricide évité de justesse, un conducteur raciste et acariâtre qui n’aime pas Obama, Deanna, la banalité de l’Amérique qui a renoncé, il y a à la télé, dans les brumes de l’explosion de Fukushima, l’idée que le Japon, si lointain, va les emmener ailleurs. Je peux te dire que j’en ai rien à foutre, si tu veux, rétorque Vince. Il y a Disneyland le lendemain pour réconcilier la famille – moins le frère reparti sans un mot – il y a Fumi et ses parents en voyage à Paris, Fumi, qui veut téléphoner à ses grands-parents…au Japon, Autour du monde, c’est l’histoire de tous ces gens qui ne se rencontreront jamais liés par un instant, un seul, celui qui a fait basculer le monde sans que ceux qui n’ont pas été directement touchés lui accordent la moindre importance. C’est l’histoire d’un monde global mais fragmenté, isolé dans chacune des solitudes qu’incarnent la farandole de personnages que décrit Mauvignier, un kaléidoscope de cultures restreint, parfois, au pire de chacune d’entre elles. Quand un événement – un vrai, celui déterminé par son immédiateté, son intensité et son historicité – se déroule dans le monde, chacun se souvient, des années après, ce qu’il faisait à cet instant précis. Laurent Mauvignier s’est une fois de plus servi de ses cercles concentriques narratifs pour se souvenir de ce qui a précédé – juste avant – le 11 mars 2011, ce qui a suivi également : les répliques ne sont pas toujours que sismiques quand le monde a bougé.
Laurent Mauvignier, Autour du monde, les Éditions de Minuit, 2014
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
07:00 Publié dans Blog | Lien permanent
11/06/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (3)
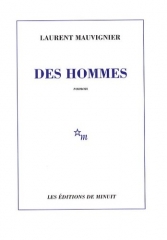 Et puisque l’Algérie – les événements – s’est inscrite en filigrane, disais-je, dans les deux premiers romans de Laurent Mauvignier, il est temps de me souvenir d’un ouvrage que j’ai eu le loisir de faire étudier à des classes de 2nde, c’est dire si ça n’est pas d’aujourd’hui. Non pas que je n’aie plus eu, entre-temps, à m’occuper de 2nde, mais parce que faire étudier un tel roman, désormais, est inenvisageable : pas parce qu’il est (trop) complexe, mais parce que le processus d’abrutissement, lancé à pleine allure, ne le permettrait plus ailleurs que dans des cercles privilégiés. Bref. Des hommes, paru en 2009, trois ans après Dans la foule, qui avait marqué les lecteurs par sa construction, là encore (chronique à paraître), c’est un roman sur la Guerre d’Algérie comme il en paraissait peu, encore – je citerais Le Dehors ou la migration des truites, d’Arno Bertina, Une guerre sans fin de Bertrand Leclair et, j’ose, ce petit roman, Tébessa, 1956, dont on parla un temps. Couplé dans ma mémoire à un film majeur, pas assez reconnu, la trahison, de Philippe Faucon, le dilemme des harkis, la porte qu’ils ouvrent dans leur conscience avant de la laisser ouverte aux sourires kabyles des fellaghas…
Et puisque l’Algérie – les événements – s’est inscrite en filigrane, disais-je, dans les deux premiers romans de Laurent Mauvignier, il est temps de me souvenir d’un ouvrage que j’ai eu le loisir de faire étudier à des classes de 2nde, c’est dire si ça n’est pas d’aujourd’hui. Non pas que je n’aie plus eu, entre-temps, à m’occuper de 2nde, mais parce que faire étudier un tel roman, désormais, est inenvisageable : pas parce qu’il est (trop) complexe, mais parce que le processus d’abrutissement, lancé à pleine allure, ne le permettrait plus ailleurs que dans des cercles privilégiés. Bref. Des hommes, paru en 2009, trois ans après Dans la foule, qui avait marqué les lecteurs par sa construction, là encore (chronique à paraître), c’est un roman sur la Guerre d’Algérie comme il en paraissait peu, encore – je citerais Le Dehors ou la migration des truites, d’Arno Bertina, Une guerre sans fin de Bertrand Leclair et, j’ose, ce petit roman, Tébessa, 1956, dont on parla un temps. Couplé dans ma mémoire à un film majeur, pas assez reconnu, la trahison, de Philippe Faucon, le dilemme des harkis, la porte qu’ils ouvrent dans leur conscience avant de la laisser ouverte aux sourires kabyles des fellaghas…
Pourtant, en reprenant Des hommes, c’est toujours The Deer Hunter, le film de Michael Cimino, qui revient en mémoire, tant la structure – et la volonté – sont les mêmes d’aborder LE sujet par derrière, une époque par celles qui ont suivi, qui les a déterminées sans que ses acteurs l’aient choisi. Des hommes commence dans la même semi-campagne (entre exode rurale et milieu industriel) que dans Loin d’eux, La Bassée. On entre, via le découpage d’une journée (après-midi, soir, nuit, matin) qui structure au roman, dans la salle des fêtes du village qui accueille la retraite de Solange, cantinière du collège, et ses 60 ans. Arrive Bernard, son frère ainé - qui ne voit plus qu’elle de la famille nombreuse dont ils proviennent. Un narrateur omniscient et tournant décrit une scène qui va glacer la fête quand Bernard, l’alcoolique (pour faire vite) que tout le monde ici appelle Feu-de-Bois, lui offre une grande broche en or nacré, de chez Buchet, qui surprend l’assemblée, Solange en tête, mais aussi tous les témoins, qui jasent : avec quel argent ? On le soupçonne de l’avoir volé à sa mère, qui ne voulait plus le voir, lui intériorise C’est à Solange, c’est pour Solange, ça ne regarde personne mais la broche va se faire déclencheur de tous les non-dits – le fonds Mauvignier – et les rancœurs accumulés. Ils ont toujours crevé de jalousie, pense-t-il. Et, comme si un ressort avait été cassé, va déclencher le mécanisme de la mémoire autant que ce que ce Bernard assène à Saïd (Chafraoui), l’un des convives. - Lui, le – Arrête – le bougnoule, les mots sont lâchés et comme toujours chez Mauvignier, c’est ce qu’ils ne disent pas qui compte. Rabut, le cousin, le bachelier, le pense en lui-même, néanmoins : impossible pour moi de porter la main sur Feu-de-bois ; il est membre du conseil municipal – le même qui a rejeté la candidature en son temps de Chafraoui – membre de l’Amicale des Anciens d’Afrique du Nord et à partir de là, toute la violence et le ressentiment contenus des décennies écoulées vont construire le récit. Parce que Feu-de-bois, chassé de la fête, part s’en prendre à la femme de Chafraoui, chez lui, dans une scène glaçante d’implicite dont le lecteur gardera longtemps le sourire mort, impossible de l’agresseur via la description, clinique, d’une mobylette au sol, dans la cour, avant l’arrivée du mari, qui le met en fuite.
Des hommes, le soir, c’est le conciliabule de ceux, importants, qui se réunissent chez Patou pour savoir quelle suite donner à l’affaire – il aurait pu faire pire, je veux dire – considérer la plainte qu’il faut porter ou pas. Ce sont les pensées du cousin Rabut qui voudrait dire Monsieur le Maire, vous vous souvenez la première fois que vous avez vu un Arabe ? mais qui ne le dit pas parce que ça n’est pas permis. Qui voudrait interpeller l’édile (est-ce qu’il y est allé, est-ce qu’il a vu ? Est-ce qu’il s’est ennuyé, est-ce qu’il a eu peur ?) mais sait qu’il est trop jeune pour ça. Il y a Solange, qui défend un idiot alcoolique, mais pas un idiot méchant. - Qu’est-ce qu’il vous a fait, Bernard, pour que vous le détestiez comme ça depuis toujours ? Il y a cette faille chez les Anciens d’Algérie, leur façon de ne pas en parler, du séjour au Club Bled, cette part d’eux-mêmes cachée ou calfeutrée (…) endormie. Il ne s’agirait pas qu’on remette sur Feu-de-bois toutes les haines et les rancoeurs qui trainent encore dans les familles. La mort de sa jeune sœur Rosie, qu’il a rejetée, sa façon, en catimini, de nous mépriser, pense Rabut, parce qu’il a vécu un temps, en banlieue parisienne. Quand, lorsque la quille est arrivée, il a envoyé un télégramme à ses parents, Bernard, pour dire qu’il ne rentrerait pas. Il a mis 15 ans pour le faire quand même, laissant Mireille, fille de colon, rencontrée à Oran et les deux enfants qu’il a eus d’elle sans un mot d’explication. Désireux de récupérer l’argent de la loterie que sa mère lui avait pris, puisque mineur, alors. Le reste, on n’en saura rien (quand il est revenu, pas un mot, à personne) parce que dans Mauvignier, les choses ne se dévoilent pas, elles se devinent et s’imbriquent entre elles. Et quand il est revenu, je veux dire, quand il est revenu, quinze ans après tout le monde, ça a été comme si pour lui la guerre venait de se terminer.
La guerre, on y retourne par analepse au tiers du roman, quand Bernard prend le train pour Marseille, en 1960, avec sa valise en bois et son missel ; il se jure de tenir les 28 mois réglementaires pour ensuite récupérer son dû, ne fait pas attention aux jeunes hommes comme lui qui s’entassent, en ricanant ou sans un mot. Il se dit, quai de la Joliette, que cette fois, il va voir la mer, même pour une nuit, sans savoir que toute sa vie sera perforée de ce coup de sirène qui annonce le départ. Qu’il la passerait sous les petits serments qu’on s’était faits à soi-même de ne rien dire de ce que c’était là-bas. Et le roman, dans sa nuit, d’ouvrir sur les expéditions punitives, villages rasés, bébés projetés au sol, le moindre suspect (de rien) abattu. Il y a Rabut, Bernard, Châtel le pacifiste, Nivelle – ironie ? - Poiret, les autres. Il y a les photos des chéries qui les attendent (ou pas) : ici, les femmes sont des souvenirs cachés dans le portefeuille, ou celles qu’on va voir en permission, sans que ça compte. Il y a la peur du guet, l’effroi du craquement de brindilles sous des pas, il y Fatiha, 8 ans, dont Bernard gardera la photo quand il aura oublié ses enfants, il y a Idir et son grand-père, héros de Verdun, mais ca ne compte pas, ces harkis, traîtres aux Algériens. Ils parlent des Arabes, comme si tous les Arabes, comme si. Il y a surtout l’absurde de l’expédition punitive d’une expédition punitive, le médecin de la caserne retrouvé muscles arrachés jusqu’au squelette, et les questions que Bernard – pas encore Feu-de-bois – se pose - ce qu’on ferait aussi, nous autres, si on nous privait de nos terres – et qu’il tait, sur la place d’armes. Tous savent déjà que quelque chose a changé. On ne sait pas quoi. Rien ne va changer. Et pourtant tout.
Des hommes, c’est un roman sur savoir se taire (…) mais plutôt se taire et ne pas savoir. On assiste au basculement de Bernard – dans l’alcool et la fureur - à la suite d’un rendez-vous amoureux manqué au Météore, quand il en était encore aux projets d’avenir et aux pensées humanistes (s’il était Algérien, sans doute serait-il fellaga), quand il se demande si des hommes font ça, des deux côtés. À l’essence de l’inimitié avec Rabut, aux vieilles histoires qui ressurgissent entre eux. Au cœur qui se vide, aux mains qui en viennent à elles, pour une bagarre qui va déterminer leur vie : parce qu’ils passeront la nuit en prison, qu’ils ne seront pas au rendez-vous de la caserne, que… C’est Février qui raconte un dénouement qui n’en est pas un, puisqu’il crée lui-même le nœud des existences et de leur récit. Cette idée ridicule (…) de penser qu’ils ne se sont pas réveillés… Avant que le matin soit laissé à Rabut, pour un finale époustouflant de beauté triste.
Mauvignier, en 2009, avait déjà laissé une trace importante, en une décennie de littérature ; là, en s’emparant d’un sujet – la guerre, la Grande pour les vieux – c’était pas Verdun, votre affaire – la corvée de bois et les lâchages en hélicoptère des plus jeunes partis sauver le pays dont lui (Bernard) n’avait pas vraiment compris qu’il était en danger – qu’on pouvait à peine évoquer (Benjamin Stora a toujours établi qu’il fallait 50 ans pour parler d’une guerre, on y était), il devient un auteur majeur dans sa façon de laisser les choses se dire d’elles-mêmes, une fois de plus. Pas sur les photos, qui ne laissent rien savoir de la peur au ventre. Mais dans les correspondances des événements et de leur conséquence sur la vie qu’ont vécue les personnages – si Mireille n’a pas été au rendez-vous du Météore, c’est que les pieds de vigne de son père ont été saccagés, Tous des communistes, tous d’accord avec des terroristes. Même dans l’Histoire, la phénoménologie joue son rôle. Surtout dans l’Histoire.
Laurent Mauvignier, Des hommes, les Éditions de Minuit, 2009
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
22:50 Publié dans Blog | Lien permanent
08/06/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (2)
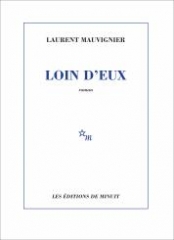 L’année d’avant Apprendre à finir, quand on était encore, pour un an, dans le siècle de Sartre et de Claude Simon, Laurent Mauvignier sortait, à 32 ans, son premier roman, dense, volontairement irrespirable dans la mise en page, Loin d’eux. Une histoire de deuil(s) dans une famille modeste, une histoire jamais dite. Ou bien à mi-texte, dans une généalogie dont il faut sortir le père (Jean), la mère (Marthe), mais aussi l’oncle Gilbert, la tante Geneviève, Luc, le fils, Céline, sa cousine. Autant de personnages qui deviennent narrateurs, directement ou indirectement, dans cette famille – ceux d’ici – où on espère et on attend que le bonheur vienne à nous. Luc a quelque chose en lui qui ne veut pas grandir, pensent ses parents, qui s’agacent de son inaction – les heures passées dans sa chambre, cette zone de rêves aux affiches de vieux films de cinéma – mais prennent de plein fouet son départ pour Paris, son travail de serveur (sartrien), dans un bar. Le constat que ce sont les choses irritantes qui manquent le plus, malgré les lettres qu’il envoie, qui rassurent en peu de mots, lesquels ne trompent personne. Parce chacun de ceux qui restent a sa propre vision de ce qui a généré l’absence, et le non-dit : la mère - qui s’est enfermée dans des intonations qui ne manquaient pas d’avoir été prélevées dans la voix de (mon) père, souvent – s’est protégée d’un Luc il pense à autre chose bien pratique ; le père – qui a connu l’Algérie, un filigrane dans le travail de Mauvignier - aux mains qui se sont fondues dans la peinture bleue de l’usine, qui aurait voulu qu’il vienne au moins une fois pour voir là où la vie m’écrasait mais n’a jamais su lui dire autre chose qu’il le comprenait quand il ne le comprenait pas. Lui, il vaut mieux que ce qu’on a eu, ça a été leur seul credo, qui ne tiendra pas quand l’absence se fera plus marquée, plus définitive. Parce que la famille est frappée par la mort, doublement, une première fois quand le mari – courageux, ce qui vaut toutes les valeurs, dans ce milieu – de Céline se tue en voiture. On n’a jamais bien su dire les choses, lâche Gilbert, quand Luc voit dans le cérémonial des funérailles une mise en scène patraque : une dégringolade des mots sur le malheur. Il exhorte sa jeune cousine à ne pas se laisser déterminer par ceux qui la restreignent à ça, désormais (Ils ne veulent pas que je vive), quand lui est pris par ses propres démons – son invisibilité, ses bruits dans sa tête – qui l’emporteront, ne laissant qu’un Post-It jaune griffonné au stylo Bic, ouvert sur deux points qui ne démontrent rien. J’aurais jamais cru comment ça tournerait, la vie : les propos qu’il a tenus à la mort du mari de sa cousine se retournent contre ou sur lui, quand dans le même temps, en Hamlet moderne, il sait que mourir c’est pareil que dormir. On sent qu’ils taisent ce qu’ils portent, dit-on de ces gens simples : peut-être qu’un homme ça vit les choses dans le silence, avance-t-on comme explication, quand Geneviève lâche, elle, un Qu’est-ce qu’on n’a pas su ? qui ne dit rien de l’acrimonie – inavouable – qu’elle voue à son neveu, lequel a perverti le deuil de sa fille.
L’année d’avant Apprendre à finir, quand on était encore, pour un an, dans le siècle de Sartre et de Claude Simon, Laurent Mauvignier sortait, à 32 ans, son premier roman, dense, volontairement irrespirable dans la mise en page, Loin d’eux. Une histoire de deuil(s) dans une famille modeste, une histoire jamais dite. Ou bien à mi-texte, dans une généalogie dont il faut sortir le père (Jean), la mère (Marthe), mais aussi l’oncle Gilbert, la tante Geneviève, Luc, le fils, Céline, sa cousine. Autant de personnages qui deviennent narrateurs, directement ou indirectement, dans cette famille – ceux d’ici – où on espère et on attend que le bonheur vienne à nous. Luc a quelque chose en lui qui ne veut pas grandir, pensent ses parents, qui s’agacent de son inaction – les heures passées dans sa chambre, cette zone de rêves aux affiches de vieux films de cinéma – mais prennent de plein fouet son départ pour Paris, son travail de serveur (sartrien), dans un bar. Le constat que ce sont les choses irritantes qui manquent le plus, malgré les lettres qu’il envoie, qui rassurent en peu de mots, lesquels ne trompent personne. Parce chacun de ceux qui restent a sa propre vision de ce qui a généré l’absence, et le non-dit : la mère - qui s’est enfermée dans des intonations qui ne manquaient pas d’avoir été prélevées dans la voix de (mon) père, souvent – s’est protégée d’un Luc il pense à autre chose bien pratique ; le père – qui a connu l’Algérie, un filigrane dans le travail de Mauvignier - aux mains qui se sont fondues dans la peinture bleue de l’usine, qui aurait voulu qu’il vienne au moins une fois pour voir là où la vie m’écrasait mais n’a jamais su lui dire autre chose qu’il le comprenait quand il ne le comprenait pas. Lui, il vaut mieux que ce qu’on a eu, ça a été leur seul credo, qui ne tiendra pas quand l’absence se fera plus marquée, plus définitive. Parce que la famille est frappée par la mort, doublement, une première fois quand le mari – courageux, ce qui vaut toutes les valeurs, dans ce milieu – de Céline se tue en voiture. On n’a jamais bien su dire les choses, lâche Gilbert, quand Luc voit dans le cérémonial des funérailles une mise en scène patraque : une dégringolade des mots sur le malheur. Il exhorte sa jeune cousine à ne pas se laisser déterminer par ceux qui la restreignent à ça, désormais (Ils ne veulent pas que je vive), quand lui est pris par ses propres démons – son invisibilité, ses bruits dans sa tête – qui l’emporteront, ne laissant qu’un Post-It jaune griffonné au stylo Bic, ouvert sur deux points qui ne démontrent rien. J’aurais jamais cru comment ça tournerait, la vie : les propos qu’il a tenus à la mort du mari de sa cousine se retournent contre ou sur lui, quand dans le même temps, en Hamlet moderne, il sait que mourir c’est pareil que dormir. On sent qu’ils taisent ce qu’ils portent, dit-on de ces gens simples : peut-être qu’un homme ça vit les choses dans le silence, avance-t-on comme explication, quand Geneviève lâche, elle, un Qu’est-ce qu’on n’a pas su ? qui ne dit rien de l’acrimonie – inavouable – qu’elle voue à son neveu, lequel a perverti le deuil de sa fille.
On est à quelques heures de Paris, en pleine campagne, dans les années 80, à la louche. Il y a une belle relation entre les deux cousins – depuis l’enfance nous gardons nos secrets, moi et Céline – mais elle ne sera pas le sujet du récit d’un éloignement culturel avant d’être géographique. C’est un roman sur le conflit des générations, diraient les sociologues d’aujourd’hui, mais c’est surtout un récit sur le non-dit, le silence et les non-dits qui bouffent tout, à une époque où parler ne se faisait pas, dans ces milieux. C’est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi, un secret, lit-on en incipit. Un roman sur le conditionnel passé – le mode du regret – quand le père, dépassé, se dit peut-être, on aurait pu, se rappelant que Luc, profitant de l’absence momentanée de sa mère, a concédé une fois les bruits, ces choses sans nom qui vous tordent le ventre. Le drame – le sien, le leur – tient lieu de conséquence d’un indicible trop écrasant : peut-être il était mort, Luc, des mots enfouis.
En en parlant, je ne dévoile pas l’action, que le roman intègre par strates de narrations, par la structure même du récit, en deux parties, dont la 2e en comprend deux ; l’écriture, disais-je, est très dense, s’interrompt, parfois, pour passer à la ligne, dans un rejet abrupt. Les narrateurs sont rappelés dans le récit pour que l’énonciation soit fluide, on veut savoir ce qu’il adviendra de ces hommes frappés par le sort comme s’ils étaient programmés pour ça. On lit des scènes de village qu’on lirait dans Flaubert et pourtant le récit est contemporain, c’est dire, en soi, l’anachronisme qui pèse sur ceux qui y habitent. Ceux d’ici, en opposition à ceux qui rêvent d’ailleurs ; un ailleurs qui ternit tellement les affiches de cinéma – Jean Seberg, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Gary Cooper, par-dessus tout – que les acteurs semblent se parodier eux-mêmes et perdent toute forme de conviction dans l’illusion. C’est un roman sur l’effacement, de soi, des autres, de ce qui est censé faire la vie.
Laurent Mauvignier, Loin d’eux, les Éditions de Minuit, 1999
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
08:47 Publié dans Blog | Lien permanent
















































