20/07/2025
Dis-leur (que le portrait est un art littéraire).
 Alain Rollat a une qualité énorme, c'est qu'il a beau avoir été directeur-adjoint du Monde, participant en cela à sa marche active, il est resté humble, d'abord, et éminemment curieux, de toutes les formes de littérature. Qu'il consacre un (long) article au genre du Portrait et qu'il accorde une place conséquente à mes Figures Singulières me remplit de joie et de fierté. C'est ICI.
Alain Rollat a une qualité énorme, c'est qu'il a beau avoir été directeur-adjoint du Monde, participant en cela à sa marche active, il est resté humble, d'abord, et éminemment curieux, de toutes les formes de littérature. Qu'il consacre un (long) article au genre du Portrait et qu'il accorde une place conséquente à mes Figures Singulières me remplit de joie et de fierté. C'est ICI.
Et ça se commande LÀ.
07:30 Publié dans Blog | Lien permanent
05/07/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (11)
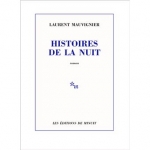 Concrètement, il se passe peu de choses, lit-on à la page… 359 d’un roman qui en fait 635 et c’est une des plus belles antiphrases de la littérature moderne, tant Histoires de la nuit tient son lecteur en haleine, l’obligeant, toujours, à un chapitre supplémentaire pour savoir ce qu’il va (enfin) advenir de ces quatre protagonistes du hameau qu’occupent Bergogne, sa femme Marion (dont c’est le 40e anniversaire, le jour du récit) et leur petite fille Ida, qui a l’âge d’aller à l’école du bourg, de regarder des dessins animés à la télé et d’attendre que sa maman rentre du bureau, que Papa ait rentré les vaches, à la Bassée (toujours), au lieu-dit Écart des trois filles seules (la voisine, la femme et l’enfant ?) ; il y a Christine, aussi, dans la ferme à côté, une artiste-peintre (exubérante et barrée) qui a renoncé à la ville pour venir habiter ici, dix ans auparavant : c’est ici et pas ailleurs qu’elle voulait vivre, vieillir, mourir . Ida adore Christine, son chien Radjah, va prendre son goûter chez elle quand l’école est terminée, ne s’étonne plus des peintures étranges et dénudées dans l’atelier – tout l’intérêt c’était que l’atelier soit dans la maison. La vie s’écoulait simple et tranquille, jusqu’à ce jour-anniversaire pour lequel Christine s’est engagée à faire des gâteaux – elle n’aime pas beaucoup Marion, qu’elle juge prétentieuse : une pétasse tatouée (au ras du cou) qui fait tout pour rentrer tard – mais garde ça pour elle : dans Histoires de la nuit, plus encore que dans tout Mauvignier, on dit peu mais on disserte sur ce qu’on ne dit pas. Ce sont les pensées qui prédominent, pas le discours, toujours restreint. Christine ne dit rien parce qu’elle aime beaucoup Bergogne, qu’elle a toujours appelé comme ça, comme on appelait son père, avant que l’agriculture intensive le tue, avant que ses deux autres fils se fassent la malle et laissent Patrice à ses dettes, à ses bêtes et à ses insatisfactions, que la rencontre – via Internet – avec Marion n’a pas comblées. Il est aux petits oignons pour elle, pourtant, s’apprête à mettre les petits plats dans les grands pour lui faire la surprise : il est allé à la ville lui acheter un ordinateur, est passé chez Picard pour prendre des ris de veau, puisqu’elle les aime, a pris un quart d’heure pour trouver chez une prostituée ce que Marion ne lui concède (presque) plus – Oui, il est un homme et il veut baiser - a crevé en route, s’est blessé à un doigt… Ça l’a mis en retard et il n’a rien su, en son absence, du premier passage d’un homme dans le hameau, dont Christine s’est immédiatement méfiée. Il veut prétendument visiter la maison laissée libre, dont tous, ici, savent que personne ne l’a mise en vente. C’est Christophe, obséquieux dans son discours et son sourire, qui prépare le terrain ; arrivera le Bègue, le jeune frère, qui réglera la question du chien dans un passage terrible où le crime se mêle à la pâtisserie, sur fond des suites de Bach par Gastinel, que Christine écoute à fort volume, ce qui ne lui permet pas d’entendre les bruits, de les reconnaître comme chacun a appris à le faire, ici. Ils vont prendre en otage la peintre et l’enfant, le père quand il arrive enfin, se dispatchent sur les deux lieux – d’une maison l’autre, le Bègue dans l’atelier avec Christine, les autres dans la maison, à préparer l’arrivée de Marion. À partir de là, les chapitres sont alternés, on a le récit de la relation Le Bègue – qui sort d’un centre spécialisé pour attardés – Christine, l’évolution d’un syndrome de Stockholm inversé, et celui de la maison d’à côté, dans laquelle arrive Denis, le plus âgé des frères. Le meneur d’hommes, quand il est là, parce que pendant dix ans, il a payé pour des fautes qu’il va incomber à Marion… Qui, alors qu’elle passe le seuil de sa maison – avec bannière, table dressée et champagne au frais – est rattrapée par son passé. T’as vraiment cru qu’on t’oublierait ? lâche Denis, qui jubile de la situation, reçoit les deux amies de Marion (Nathalie et Lydie, invitées pour le dessert, avec Christine, censée le fournir) avec courtoisie, si bien qu’elles ne se rendent compte de rien, estiment qu’il compense l’attitude renfermée de Bergogne et Marion, dont elles vantent pourtant les mérites, puisqu’elle les a sauvées, dans l’après-midi, d’une faute professionnelle dont on voulait les accabler. La scène de captivité – passée par la sidération, les pulsions de violence, l’accablement – est vue, via un narrateur omniscient, par Bergogne, par Marion, par Ida et son regard d’enfant, qui voit son livre de chevet – Histoires de la nuit – toucher une réalité sur laquelle ses parents, elle le comprend maintenant, n’ont qu’un pouvoir restreint. Dans les deux lieux de l’action, la question est la même : Qu’est-ce qu’ils veulent ? Combien de temps cela va-t-il durer ?, prend toutes les formes de sa verbalisation silencieuse. On cesse de respirer quand Christine échappe à la surveillance du simplet de service, veut appeler la police – ils n’ont pas répondu– on retient son souffle quand Bergogne se dit qu’en décrochant son fusil de chasse, en saisissant le couteau de cuisine, il pourrait inverser le rapport de force, on se demande si Marion va dévoiler son vrai visage, on se questionne même, avec Denis, pour savoir si les vrais salauds, dans cette histoire, sont vraiment ceux qui en jouent le rôle. Quel serait, à nous, notre propre poids d’histoires à taire. Il faut gagner du temps, mais du temps sur quoi et pour en faire quoi ? Que fait-on, humainement, d’un mélange de fête et de terreur suspendues, d’un acte qui en appelle d’autres, surtout quand on laisse la surveillance d’un otage – peut-être s’il n’avait pas vu la terreur dans ses yeux, il n’aurait pas frappé - à un taré. Les images d’Oradour-sur-Glane, un village pas si lointain, surgissent sans qu’on le nomme, sorties des histoires entendues enfant, qui prennent corps, quand le drame se tend, que les armes sont sorties. Avant que Marion lâche un – D’accord, ça suffit, ça suffit, avant ce qu’enfin Marion va dire. Ou du moins ce qu’on entendra dire d’elle, dans les 90 dernières pages. Des histoires de premier train pour n’importe où de de furieux coups de pied de l’intérieur de son ventre… Et de digues qui se passent, de cercles concentriques qui se recoupent, comme toujours chez Mauvignier. Pour finir par sept coups de feu, comme dans les contes, ou presque, dont quatre toucheront leur cible, répète-t-il, pour maintenir le lecteur jusqu’au bout. Littéralement, jusqu’à la dernière ligne.
Concrètement, il se passe peu de choses, lit-on à la page… 359 d’un roman qui en fait 635 et c’est une des plus belles antiphrases de la littérature moderne, tant Histoires de la nuit tient son lecteur en haleine, l’obligeant, toujours, à un chapitre supplémentaire pour savoir ce qu’il va (enfin) advenir de ces quatre protagonistes du hameau qu’occupent Bergogne, sa femme Marion (dont c’est le 40e anniversaire, le jour du récit) et leur petite fille Ida, qui a l’âge d’aller à l’école du bourg, de regarder des dessins animés à la télé et d’attendre que sa maman rentre du bureau, que Papa ait rentré les vaches, à la Bassée (toujours), au lieu-dit Écart des trois filles seules (la voisine, la femme et l’enfant ?) ; il y a Christine, aussi, dans la ferme à côté, une artiste-peintre (exubérante et barrée) qui a renoncé à la ville pour venir habiter ici, dix ans auparavant : c’est ici et pas ailleurs qu’elle voulait vivre, vieillir, mourir . Ida adore Christine, son chien Radjah, va prendre son goûter chez elle quand l’école est terminée, ne s’étonne plus des peintures étranges et dénudées dans l’atelier – tout l’intérêt c’était que l’atelier soit dans la maison. La vie s’écoulait simple et tranquille, jusqu’à ce jour-anniversaire pour lequel Christine s’est engagée à faire des gâteaux – elle n’aime pas beaucoup Marion, qu’elle juge prétentieuse : une pétasse tatouée (au ras du cou) qui fait tout pour rentrer tard – mais garde ça pour elle : dans Histoires de la nuit, plus encore que dans tout Mauvignier, on dit peu mais on disserte sur ce qu’on ne dit pas. Ce sont les pensées qui prédominent, pas le discours, toujours restreint. Christine ne dit rien parce qu’elle aime beaucoup Bergogne, qu’elle a toujours appelé comme ça, comme on appelait son père, avant que l’agriculture intensive le tue, avant que ses deux autres fils se fassent la malle et laissent Patrice à ses dettes, à ses bêtes et à ses insatisfactions, que la rencontre – via Internet – avec Marion n’a pas comblées. Il est aux petits oignons pour elle, pourtant, s’apprête à mettre les petits plats dans les grands pour lui faire la surprise : il est allé à la ville lui acheter un ordinateur, est passé chez Picard pour prendre des ris de veau, puisqu’elle les aime, a pris un quart d’heure pour trouver chez une prostituée ce que Marion ne lui concède (presque) plus – Oui, il est un homme et il veut baiser - a crevé en route, s’est blessé à un doigt… Ça l’a mis en retard et il n’a rien su, en son absence, du premier passage d’un homme dans le hameau, dont Christine s’est immédiatement méfiée. Il veut prétendument visiter la maison laissée libre, dont tous, ici, savent que personne ne l’a mise en vente. C’est Christophe, obséquieux dans son discours et son sourire, qui prépare le terrain ; arrivera le Bègue, le jeune frère, qui réglera la question du chien dans un passage terrible où le crime se mêle à la pâtisserie, sur fond des suites de Bach par Gastinel, que Christine écoute à fort volume, ce qui ne lui permet pas d’entendre les bruits, de les reconnaître comme chacun a appris à le faire, ici. Ils vont prendre en otage la peintre et l’enfant, le père quand il arrive enfin, se dispatchent sur les deux lieux – d’une maison l’autre, le Bègue dans l’atelier avec Christine, les autres dans la maison, à préparer l’arrivée de Marion. À partir de là, les chapitres sont alternés, on a le récit de la relation Le Bègue – qui sort d’un centre spécialisé pour attardés – Christine, l’évolution d’un syndrome de Stockholm inversé, et celui de la maison d’à côté, dans laquelle arrive Denis, le plus âgé des frères. Le meneur d’hommes, quand il est là, parce que pendant dix ans, il a payé pour des fautes qu’il va incomber à Marion… Qui, alors qu’elle passe le seuil de sa maison – avec bannière, table dressée et champagne au frais – est rattrapée par son passé. T’as vraiment cru qu’on t’oublierait ? lâche Denis, qui jubile de la situation, reçoit les deux amies de Marion (Nathalie et Lydie, invitées pour le dessert, avec Christine, censée le fournir) avec courtoisie, si bien qu’elles ne se rendent compte de rien, estiment qu’il compense l’attitude renfermée de Bergogne et Marion, dont elles vantent pourtant les mérites, puisqu’elle les a sauvées, dans l’après-midi, d’une faute professionnelle dont on voulait les accabler. La scène de captivité – passée par la sidération, les pulsions de violence, l’accablement – est vue, via un narrateur omniscient, par Bergogne, par Marion, par Ida et son regard d’enfant, qui voit son livre de chevet – Histoires de la nuit – toucher une réalité sur laquelle ses parents, elle le comprend maintenant, n’ont qu’un pouvoir restreint. Dans les deux lieux de l’action, la question est la même : Qu’est-ce qu’ils veulent ? Combien de temps cela va-t-il durer ?, prend toutes les formes de sa verbalisation silencieuse. On cesse de respirer quand Christine échappe à la surveillance du simplet de service, veut appeler la police – ils n’ont pas répondu– on retient son souffle quand Bergogne se dit qu’en décrochant son fusil de chasse, en saisissant le couteau de cuisine, il pourrait inverser le rapport de force, on se demande si Marion va dévoiler son vrai visage, on se questionne même, avec Denis, pour savoir si les vrais salauds, dans cette histoire, sont vraiment ceux qui en jouent le rôle. Quel serait, à nous, notre propre poids d’histoires à taire. Il faut gagner du temps, mais du temps sur quoi et pour en faire quoi ? Que fait-on, humainement, d’un mélange de fête et de terreur suspendues, d’un acte qui en appelle d’autres, surtout quand on laisse la surveillance d’un otage – peut-être s’il n’avait pas vu la terreur dans ses yeux, il n’aurait pas frappé - à un taré. Les images d’Oradour-sur-Glane, un village pas si lointain, surgissent sans qu’on le nomme, sorties des histoires entendues enfant, qui prennent corps, quand le drame se tend, que les armes sont sorties. Avant que Marion lâche un – D’accord, ça suffit, ça suffit, avant ce qu’enfin Marion va dire. Ou du moins ce qu’on entendra dire d’elle, dans les 90 dernières pages. Des histoires de premier train pour n’importe où de de furieux coups de pied de l’intérieur de son ventre… Et de digues qui se passent, de cercles concentriques qui se recoupent, comme toujours chez Mauvignier. Pour finir par sept coups de feu, comme dans les contes, ou presque, dont quatre toucheront leur cible, répète-t-il, pour maintenir le lecteur jusqu’au bout. Littéralement, jusqu’à la dernière ligne.
Histoires de la nuit est un roman asphyxiant, qui a tous les codes du roman noir mais ne se défait jamais de sa mécanique métaphysique : toutes les pensées sont décodées, les secrets se libèrent de l’intérieur des protagonistes, qui considèrent tant ce qu’ils pourraient dire ou faire qu’ils n’ont plus besoin de le dire ou de le faire. Le dénouement – ses rebondissements - est à la hauteur du temps que le roman a suspendu et laisse un lecteur exsangue se dire que s’il ne s’est rien passé en 635 pages, ce rien-là n’aura jamais été aussi exhaustif dans ce qu’on peut imaginer de la comédie humaine et des misérables petites sommes de non-dits que nous sommes tous, finalement. Un page turner, conclut-on dans les milieux avertis.
Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, les Éditions de Minuit, 2020
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
17:27 Publié dans Blog | Lien permanent
02/07/2025
TRISKAÏDÉCALOGUE MAUVIGNIER (10) - SHORTS
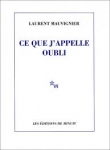 On devrait pouvoir mesurer la qualité et l’importance d’un auteur à sa façon de réagir à un sujet d’actualité anodin, un fait-divers comme on l’appelle. En 2009, à Lyon, des vigiles ont battu à mort un SDF, sans autre raison valable que le droit qu’ils se donnent et la force qu’ils y trouvent, dira Mauvignier, deux ans après, dans un récit d’une phrase, sans majuscule initiale, sans point final non plus, d’une cinquantaine de pages. C’est un narrateur omniscient qui s’adresse - alors que le procès a eu lieu et que le procureur lâche, d’entrée, un homme ne doit pas mourir pour si peu – au jeune frère de la victime, dont le crime est de s’être arrêté au rayon bière du supermarché – les moins chères, en bas du rayon – et d’en avoir dégoupillé une, parce qu’à un moment, ça suffit de continuer poches cousues. C’est sans compter sur les quatre vigiles qui, l’ayant repéré – T’as de l’argent pour payer ça ? – l’emmènent à l’écart, dans un recoin, et vont déchainer leur violence (je ne sais pas de quelle humiliation ils veulent se venger, dira le narrateur) et le laisser pour mort sur le froid de la dalle de ciment, dans la réserve. Lui, qui n’a pas fait d’histoire quand ils l’ont arrêté – parce qu’il n’a pas de mots – se sera dit que tout allait s’arrêter bientôt, replié dans une position de fœtus, il aura vu la mort venir, hébété, comme une bulle qui remonte à la surface et finit par péter. Il ne savait pas qu’il mourrait, ce jour-là, contrairement aux films dans lesquels les héros savent qu’ils vont mourir : c’est une scène qui est pourtant, elle aussi, hors du réel, qui inversera le jeu ouvert de la peur puisque le narrateur, sans que ça ne rattrape rien, les montre au jeune frère de la victime – obligé de porter encore son grand frère, en annonçant sa perte à leur mère – comme assoiffés à leur tour, ayant peur la nuit. Ils se sont fait plaisir, voilà le fond, mais cette jouissance aura un coût, une fois les prétextes – la crise cardiaque d’entrée, le couteau imaginaire, la responsabilité rejetée sur l’un des quatre – évacués. La victime reste(ra) morte, la damnation portée autant sur sa famille que sur celle de ses assassins ; cette lacération, dans la vie de celui qui reste (tu devras vieillir pour deux), Mauvignier la recrée dans un souffle, une phrase, des questions lancinantes : au bout de combien de coups est-il tombé ? Combien de bières vaut une vie ? Et cette sentence, qui tombe, plus importante encore que celle des Assises : ce qui est triste dans ma vie c’est ce monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur.
On devrait pouvoir mesurer la qualité et l’importance d’un auteur à sa façon de réagir à un sujet d’actualité anodin, un fait-divers comme on l’appelle. En 2009, à Lyon, des vigiles ont battu à mort un SDF, sans autre raison valable que le droit qu’ils se donnent et la force qu’ils y trouvent, dira Mauvignier, deux ans après, dans un récit d’une phrase, sans majuscule initiale, sans point final non plus, d’une cinquantaine de pages. C’est un narrateur omniscient qui s’adresse - alors que le procès a eu lieu et que le procureur lâche, d’entrée, un homme ne doit pas mourir pour si peu – au jeune frère de la victime, dont le crime est de s’être arrêté au rayon bière du supermarché – les moins chères, en bas du rayon – et d’en avoir dégoupillé une, parce qu’à un moment, ça suffit de continuer poches cousues. C’est sans compter sur les quatre vigiles qui, l’ayant repéré – T’as de l’argent pour payer ça ? – l’emmènent à l’écart, dans un recoin, et vont déchainer leur violence (je ne sais pas de quelle humiliation ils veulent se venger, dira le narrateur) et le laisser pour mort sur le froid de la dalle de ciment, dans la réserve. Lui, qui n’a pas fait d’histoire quand ils l’ont arrêté – parce qu’il n’a pas de mots – se sera dit que tout allait s’arrêter bientôt, replié dans une position de fœtus, il aura vu la mort venir, hébété, comme une bulle qui remonte à la surface et finit par péter. Il ne savait pas qu’il mourrait, ce jour-là, contrairement aux films dans lesquels les héros savent qu’ils vont mourir : c’est une scène qui est pourtant, elle aussi, hors du réel, qui inversera le jeu ouvert de la peur puisque le narrateur, sans que ça ne rattrape rien, les montre au jeune frère de la victime – obligé de porter encore son grand frère, en annonçant sa perte à leur mère – comme assoiffés à leur tour, ayant peur la nuit. Ils se sont fait plaisir, voilà le fond, mais cette jouissance aura un coût, une fois les prétextes – la crise cardiaque d’entrée, le couteau imaginaire, la responsabilité rejetée sur l’un des quatre – évacués. La victime reste(ra) morte, la damnation portée autant sur sa famille que sur celle de ses assassins ; cette lacération, dans la vie de celui qui reste (tu devras vieillir pour deux), Mauvignier la recrée dans un souffle, une phrase, des questions lancinantes : au bout de combien de coups est-il tombé ? Combien de bières vaut une vie ? Et cette sentence, qui tombe, plus importante encore que celle des Assises : ce qui est triste dans ma vie c’est ce monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur.
Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, les Éditions de Minuit, 2011
 Il faut respecter la volonté de Laurent Mauvignier de ne pas faire entrer Le lien dans le genre théâtral – sous-titre à l’appui – même si ce court ouvrage se construit sur un dialogue entre Elle & Lui, dans l’universalité de l’appellation. Les mirages de la futilité (météorologique) vite passés, on comprend que dans cette maison qu’ils ont partagée il y a longtemps – tout ça est si vieux – il est revenu depuis peu et qu’elle est y restée, à l’attendre, trente années durant, dans sa vanité de jouer la veuve et la gardienne ; mais elle va mourir, dans cette maison, sous peu, ça n’est pas le moment de changer quoi que ce soit dans la (vieille) décoration – on peut tout bouger, tout renverser mais… non, pas la chambre – elle aura besoin, dit-elle, de toutes ces vieilleries et de tous ces bruits – jusqu’au robinet qui fuit – pour profiter de tout, et de Lui, en premier lieu, jusqu’au bout. Lui, c’est un photographe de guerre, passé par tous les pays dangereux du monde, qui a vécu une vie à fuir (dans l’alcool et les femmes) l’idée qu’il avait quitté une femme qu’il aimait, éperdument, à échapper à tout ce qui (le) retenait à (eux) et (le) ramenait ici, toujours. Il a envoyé des lettres, n’a jamais brisé le lien qui fait qu’elle l’a attendu. Il est trop tard pour faire comme si je n’étais jamais parti, lui dit-il. Et pourtant, à ta façon, tu n’as jamais été aussi présent ici, avec moi, que pendant toutes ces années où tu n’étais pas là, lui répond-elle, dans un dialogue qui se construit autour de la faille originelle de l’Algérie – une permanence, chez Mauvignier – une forme de fascination pour la terreur qu’il est allé poursuivre dans les yeux des chevaux menés à l’abattoir, ou auprès de ceux dont la vie n’a aucune valeur, comme cette prostituée à Mexico dont la conversation lui rappelait le bruit des hirondelles, chez lui… Elle l’interroge sur ce qui animera son regard quand elle passera ad patres, s’il saura reconnaître la même expression que celle qu’il a cherchée partout, autour du monde ; il élude, dit que les images et les mots ne sont rien, déférence gardée envers le livre qu’il leur reste à écrire. Qui ne le sera sans doute pas, parce que ce qu’ils avaient à écrire entre eux, ils l’ont fait, même si le cours n’a jamais été tranquille. Il peut s’accabler, parfois – je suis passé dans ma vie comme les étrangers dans les grandes villes – on peut se demander s’il est rentré parce qu’elle était malade, elle va mourir heureuse, assène-t-elle. Le lien (jamais défait), c’est la radioscopie d’un amour sans regrets, sans mélodrame, que l’imminence de la mort et du temps qui a passé ramène à son essence, d’une pureté sans nom.
Il faut respecter la volonté de Laurent Mauvignier de ne pas faire entrer Le lien dans le genre théâtral – sous-titre à l’appui – même si ce court ouvrage se construit sur un dialogue entre Elle & Lui, dans l’universalité de l’appellation. Les mirages de la futilité (météorologique) vite passés, on comprend que dans cette maison qu’ils ont partagée il y a longtemps – tout ça est si vieux – il est revenu depuis peu et qu’elle est y restée, à l’attendre, trente années durant, dans sa vanité de jouer la veuve et la gardienne ; mais elle va mourir, dans cette maison, sous peu, ça n’est pas le moment de changer quoi que ce soit dans la (vieille) décoration – on peut tout bouger, tout renverser mais… non, pas la chambre – elle aura besoin, dit-elle, de toutes ces vieilleries et de tous ces bruits – jusqu’au robinet qui fuit – pour profiter de tout, et de Lui, en premier lieu, jusqu’au bout. Lui, c’est un photographe de guerre, passé par tous les pays dangereux du monde, qui a vécu une vie à fuir (dans l’alcool et les femmes) l’idée qu’il avait quitté une femme qu’il aimait, éperdument, à échapper à tout ce qui (le) retenait à (eux) et (le) ramenait ici, toujours. Il a envoyé des lettres, n’a jamais brisé le lien qui fait qu’elle l’a attendu. Il est trop tard pour faire comme si je n’étais jamais parti, lui dit-il. Et pourtant, à ta façon, tu n’as jamais été aussi présent ici, avec moi, que pendant toutes ces années où tu n’étais pas là, lui répond-elle, dans un dialogue qui se construit autour de la faille originelle de l’Algérie – une permanence, chez Mauvignier – une forme de fascination pour la terreur qu’il est allé poursuivre dans les yeux des chevaux menés à l’abattoir, ou auprès de ceux dont la vie n’a aucune valeur, comme cette prostituée à Mexico dont la conversation lui rappelait le bruit des hirondelles, chez lui… Elle l’interroge sur ce qui animera son regard quand elle passera ad patres, s’il saura reconnaître la même expression que celle qu’il a cherchée partout, autour du monde ; il élude, dit que les images et les mots ne sont rien, déférence gardée envers le livre qu’il leur reste à écrire. Qui ne le sera sans doute pas, parce que ce qu’ils avaient à écrire entre eux, ils l’ont fait, même si le cours n’a jamais été tranquille. Il peut s’accabler, parfois – je suis passé dans ma vie comme les étrangers dans les grandes villes – on peut se demander s’il est rentré parce qu’elle était malade, elle va mourir heureuse, assène-t-elle. Le lien (jamais défait), c’est la radioscopie d’un amour sans regrets, sans mélodrame, que l’imminence de la mort et du temps qui a passé ramène à son essence, d’une pureté sans nom.
Laurent Mauvignier, Le lien, les Éditions de Minuit, 2005
 Il est désarmant, Mauvignier, capable de s’arrêter 400 pages sur des désarrois métaphysiques et d’expédier un Voyage à New Delhi – au cœur d’un pays d’1,43 Milliard d’habitants – en 70 pages. Parce que le titre est un leurre, et que l’histoire de Carole aurait dû intégrer les récits concentriques de Autour du Monde et que Carole, dit-il en aparté, est l’embryon du personnage de Sibylle, la femme de Continuer : celle qui part au Kirghizstan pour se retrouver et sauver son fils de la chute. Carole, elle, en apparence, est une femme comblée, quand elle embarque pour New Delhi – dans le même avion que David Lynch – elle est l’héritière d’une entreprise familiale que gère son mari, Pascal ; lui, c’est le patron, pour lui, le monde, c’est d’abord son lieu de travail. Ils sont mariés depuis douze ans, ont des enfants, elle ne manque de rien sauf peut-être de considération. Elle ne s’en offusque que quand son mari la prend pour une imbécile dans des petits rituels humiliants – deux doigts qu’il posait sur le haut de sa nuque en la grattant du bout des ongles, deux ou trois petits très brefs, secs – ou qu’il la limite au rôle de potiche dans ses repas d’affaire, pourvu qu’elle porte les boucles d’oreille qu’il lui a achetées. À peine arrivés à New-Delhi, il la confie à Agnès, la femme de Mercier, son collaborateur, mais elle la fuit dès le lendemain, lassée d’entendre la complainte des femmes d’expatrié, l’ennui, l’hyperactivité pour compenser. Elle part seule dans les rues de la ville, qu’elle assimile au Caire, à Istanbul, des lieux qu’elle a déjà fréquentés, un monde de funambules, pour elle. Jusqu’à ce que sa route – et son destin – croise Grégoire Vasset, qui s’intéressera à elle, l’écoutera, lui fera visiter la mosquée Jama Masjid, le vieux quartier d’Hazrat Nizamuddin, ils vont boire du vin, manger chinois, pour en rire, écouter du jazz, elle aura juste le temps – Cendrillon mature – de rentrer à l’hôtel avant que son mari le fasse, qu’elle n’ait rien à justifier d’une jalousie qu’elle sait inévitable. Il écrit des livres, lui demande si elle a vu les images du Japon (pour renvoyer à Autour du monde), c’est lui qui agira comme le révélateur d’une vie dont elle ne veut plus. Quelque chose qui vacille, se dira Pascal, quand il la ramène dans sa chambre, après un dîner empli de conventions grotesques (jusqu’au poète local qu’on a mis là pour que les femmes ne s’ennuient pas trop). Jusque-là, il savait, Pascal, que sa femme allait s’ennuyer à mourir, mais que s’ennuyer à mourir, ça (n’était) pas mourir, se rassurait-il. Il n’est plus temps de fuir encore, se convainc-t-elle, en allant acheter un paquet de cigarettes et se remettre à fumer, enfin. Et de passer le cap, dans une chambre (823) qui n’est pas la sienne, pour une vie (à venir) qui ne sera plus celle qui l’a menée ici.
Il est désarmant, Mauvignier, capable de s’arrêter 400 pages sur des désarrois métaphysiques et d’expédier un Voyage à New Delhi – au cœur d’un pays d’1,43 Milliard d’habitants – en 70 pages. Parce que le titre est un leurre, et que l’histoire de Carole aurait dû intégrer les récits concentriques de Autour du Monde et que Carole, dit-il en aparté, est l’embryon du personnage de Sibylle, la femme de Continuer : celle qui part au Kirghizstan pour se retrouver et sauver son fils de la chute. Carole, elle, en apparence, est une femme comblée, quand elle embarque pour New Delhi – dans le même avion que David Lynch – elle est l’héritière d’une entreprise familiale que gère son mari, Pascal ; lui, c’est le patron, pour lui, le monde, c’est d’abord son lieu de travail. Ils sont mariés depuis douze ans, ont des enfants, elle ne manque de rien sauf peut-être de considération. Elle ne s’en offusque que quand son mari la prend pour une imbécile dans des petits rituels humiliants – deux doigts qu’il posait sur le haut de sa nuque en la grattant du bout des ongles, deux ou trois petits très brefs, secs – ou qu’il la limite au rôle de potiche dans ses repas d’affaire, pourvu qu’elle porte les boucles d’oreille qu’il lui a achetées. À peine arrivés à New-Delhi, il la confie à Agnès, la femme de Mercier, son collaborateur, mais elle la fuit dès le lendemain, lassée d’entendre la complainte des femmes d’expatrié, l’ennui, l’hyperactivité pour compenser. Elle part seule dans les rues de la ville, qu’elle assimile au Caire, à Istanbul, des lieux qu’elle a déjà fréquentés, un monde de funambules, pour elle. Jusqu’à ce que sa route – et son destin – croise Grégoire Vasset, qui s’intéressera à elle, l’écoutera, lui fera visiter la mosquée Jama Masjid, le vieux quartier d’Hazrat Nizamuddin, ils vont boire du vin, manger chinois, pour en rire, écouter du jazz, elle aura juste le temps – Cendrillon mature – de rentrer à l’hôtel avant que son mari le fasse, qu’elle n’ait rien à justifier d’une jalousie qu’elle sait inévitable. Il écrit des livres, lui demande si elle a vu les images du Japon (pour renvoyer à Autour du monde), c’est lui qui agira comme le révélateur d’une vie dont elle ne veut plus. Quelque chose qui vacille, se dira Pascal, quand il la ramène dans sa chambre, après un dîner empli de conventions grotesques (jusqu’au poète local qu’on a mis là pour que les femmes ne s’ennuient pas trop). Jusque-là, il savait, Pascal, que sa femme allait s’ennuyer à mourir, mais que s’ennuyer à mourir, ça (n’était) pas mourir, se rassurait-il. Il n’est plus temps de fuir encore, se convainc-t-elle, en allant acheter un paquet de cigarettes et se remettre à fumer, enfin. Et de passer le cap, dans une chambre (823) qui n’est pas la sienne, pour une vie (à venir) qui ne sera plus celle qui l’a menée ici.
Laurent Mauvignier, Voyage à New Delhi, les Éditions de Minuit, 2018
Laurent Mauvignier sera l’invité du Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 (informations à venir).
10:46 | Lien permanent
















































