03/12/2014
Pratique.
Je cède à tous mes caprices.
17:14 Publié dans Blog | Lien permanent
02/12/2014
Portrait de femme.
 C'est un peu comme si elle devait en permanence s'excuser d'être là. Enfant non attendu d'un couple vite orienté sur les intérêts communs plus que sur le partage, la petite Hajime a dû s'élever seule, dans l'indifférence de sa mère et dans la consolation d'un père qui ne la laissa s'accrocher à ses basques que douze petites années. Quand il mourut, sa mère lui accorda une courte accolade puis passa à autre chose. Elle, qui s'était habituée à combler elle-même sa solitude, ne broncha pas. Comme quand, en vacances, sa Folcoche la laissait à l'hôtel pendant qu'elle traînait son mari dans les casinos de la Côte d'Azur. Que ça l'ait déterminée dans son rapport aux autres, ce n'est rien de le dire. Quand "Maman", devenue vieille, lui demanda de l'aider administrativement, elle lui rappela qu'elle l'avait laissée s'inscrire seule au lycée, que c'était son tour, maintenant, de se débrouiller. Des études sérieuses, de fortes dispositions pour les matières littéraires et des études de Droit pour la rationalité de ceux qui savent qu'ils devront tout aller chercher eux-mêmes, Hajime expérimente les chemins de l'existence avec de solides appréhensions: la confiance qu'on n'a pas en soi rejaillit forcément sur celle qu'on porte aux autres... Il y a chez elle une forme de dureté qu'elle maquille par l'ironie, par des répliques cinglantes qui font qu'on peut la craindre, dans certains milieux. Un des surnoms qu'une de ses amies lui a donné, c'est "Fée Carabosse", en décalage avec son joli minois mais explicite, suffisamment, quant aux barrières qu'elle peut mettre sur ce qu'elle donne à voir d'elle. Jusqu'à ce que, comme toutes les citadelles, la sienne finît par céder: une rencontre, une acmé amoureuse sans doute mal placée, la déception, la douleur et, ensuite, la décision irrévocable de ne plus jamais souffrir, quitte à renoncer. De faux départs en vrais retours, d'ascèses en ivresses, Hajime mène son chemin périlleux en laissant croire que tout va bien: de beaux et brillants enfants auxquels elle donne tout ce qu'elle n'a pas eu, un pacte marital petit-bourgeois qui lui apporte tout ce qu'elle a peur de manquer et, comme partout, les petits accommodements qu'on fait avec ce qui manque réellement. Elle a l'habitude de sortir seule, d'aller voir des concerts, de dîner avec des amis. À plusieurs, ils diront qu'elle est drôle, percutante, qu'elle anime la soirée. En face-à-face, pour peu qu'il y ait écoute, les lignes de faille se montrent davantage : les meilleures sentinelles sont celles qui savent relâcher. C'est, encore, un peu de la Princesse de Clèves qui se joue chez cette femme: ne pas aimer de peur de s'en trouver déçu... Sa mère lui assénait que "la Beauté ne se mange pas en salade", elle sait qu'elle séduit mais refuse qu'on l'envisage disponible. Procrastine, se dit qu'elle a le temps de penser à autre chose avant que vienne le temps où elle devra avant tout penser à elle. C'est le chiasme amoureux: cette femme qui a été aimée mais pas choisie a été choisie mais mal(adroitement) aimée. On voudrait pouvoir postuler, l'emmener là où sa belle personne mérite d'aller, lui faire redécouvrir les plaisirs possibles d'un vrai recommencement. Mais un enfant sauvage ne donne pas sa confiance du premier coup: il faut du temps, la patience qu'elle n'a pas, une force de conviction qui montre que l 'évidence est là. Pas là où l'on pensait qu'elle fût. C'est la Beauté cruelle des vraies histoires, celles qui méritent qu'on s'y attarde.
C'est un peu comme si elle devait en permanence s'excuser d'être là. Enfant non attendu d'un couple vite orienté sur les intérêts communs plus que sur le partage, la petite Hajime a dû s'élever seule, dans l'indifférence de sa mère et dans la consolation d'un père qui ne la laissa s'accrocher à ses basques que douze petites années. Quand il mourut, sa mère lui accorda une courte accolade puis passa à autre chose. Elle, qui s'était habituée à combler elle-même sa solitude, ne broncha pas. Comme quand, en vacances, sa Folcoche la laissait à l'hôtel pendant qu'elle traînait son mari dans les casinos de la Côte d'Azur. Que ça l'ait déterminée dans son rapport aux autres, ce n'est rien de le dire. Quand "Maman", devenue vieille, lui demanda de l'aider administrativement, elle lui rappela qu'elle l'avait laissée s'inscrire seule au lycée, que c'était son tour, maintenant, de se débrouiller. Des études sérieuses, de fortes dispositions pour les matières littéraires et des études de Droit pour la rationalité de ceux qui savent qu'ils devront tout aller chercher eux-mêmes, Hajime expérimente les chemins de l'existence avec de solides appréhensions: la confiance qu'on n'a pas en soi rejaillit forcément sur celle qu'on porte aux autres... Il y a chez elle une forme de dureté qu'elle maquille par l'ironie, par des répliques cinglantes qui font qu'on peut la craindre, dans certains milieux. Un des surnoms qu'une de ses amies lui a donné, c'est "Fée Carabosse", en décalage avec son joli minois mais explicite, suffisamment, quant aux barrières qu'elle peut mettre sur ce qu'elle donne à voir d'elle. Jusqu'à ce que, comme toutes les citadelles, la sienne finît par céder: une rencontre, une acmé amoureuse sans doute mal placée, la déception, la douleur et, ensuite, la décision irrévocable de ne plus jamais souffrir, quitte à renoncer. De faux départs en vrais retours, d'ascèses en ivresses, Hajime mène son chemin périlleux en laissant croire que tout va bien: de beaux et brillants enfants auxquels elle donne tout ce qu'elle n'a pas eu, un pacte marital petit-bourgeois qui lui apporte tout ce qu'elle a peur de manquer et, comme partout, les petits accommodements qu'on fait avec ce qui manque réellement. Elle a l'habitude de sortir seule, d'aller voir des concerts, de dîner avec des amis. À plusieurs, ils diront qu'elle est drôle, percutante, qu'elle anime la soirée. En face-à-face, pour peu qu'il y ait écoute, les lignes de faille se montrent davantage : les meilleures sentinelles sont celles qui savent relâcher. C'est, encore, un peu de la Princesse de Clèves qui se joue chez cette femme: ne pas aimer de peur de s'en trouver déçu... Sa mère lui assénait que "la Beauté ne se mange pas en salade", elle sait qu'elle séduit mais refuse qu'on l'envisage disponible. Procrastine, se dit qu'elle a le temps de penser à autre chose avant que vienne le temps où elle devra avant tout penser à elle. C'est le chiasme amoureux: cette femme qui a été aimée mais pas choisie a été choisie mais mal(adroitement) aimée. On voudrait pouvoir postuler, l'emmener là où sa belle personne mérite d'aller, lui faire redécouvrir les plaisirs possibles d'un vrai recommencement. Mais un enfant sauvage ne donne pas sa confiance du premier coup: il faut du temps, la patience qu'elle n'a pas, une force de conviction qui montre que l 'évidence est là. Pas là où l'on pensait qu'elle fût. C'est la Beauté cruelle des vraies histoires, celles qui méritent qu'on s'y attarde.
Peinture: Franck Gervaise.
16:42 Publié dans Blog | Lien permanent
01/12/2014
Ecrire son territoire.
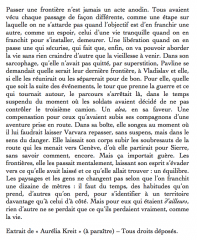 J'ai souvent parlé, ici, de ces réminiscences de mes journées d'auteur, quand, sélectionné par le prestigieux jury Lettres Frontière, pour Tébessa, j'étais invité, de part et d'autres de la ligne de démarcation, pour parler de ce premier roman édité. Je ne sais pas si c'est ce livre ou l'auteur que les organisateurs ont gardé en mémoire, mais ils m'ont invité, dès l'été dernier, à construire un cycle d'ateliers d'écriture, avec Nicolas Couchepin, un auteur Suisse. Après bien des tracasseries administratives qui ne nous regardaient pas, nous nous sommes enfin mis au travail, Nicolas et moi, avec l'excitation liée au fait de ne rien maîtriser en amont des représentations des membres des ateliers, mais d'avoir à leur proposer un cadre dans lequel ils leur donneront cours. Bien des inconnues demeurent, mais l'envie de travailler ensemble sur un sujet, l'identité, l'appartenance, qui nous échappe individuellement, est bien réelle. Le hasard choisit bien les auteurs avec qui je travaille: pas de rivalité, ni de haussement de col. Juste l'envie de mettre deux expériences d'écriture au service de personnes qui veulent mener un projet à bout. Ça commence le 10 janvier à Lausanne, pile entre les deux lieux des ateliers qui suivront, histoire que l'exercice soit collectif et distinct, à la fois.
J'ai souvent parlé, ici, de ces réminiscences de mes journées d'auteur, quand, sélectionné par le prestigieux jury Lettres Frontière, pour Tébessa, j'étais invité, de part et d'autres de la ligne de démarcation, pour parler de ce premier roman édité. Je ne sais pas si c'est ce livre ou l'auteur que les organisateurs ont gardé en mémoire, mais ils m'ont invité, dès l'été dernier, à construire un cycle d'ateliers d'écriture, avec Nicolas Couchepin, un auteur Suisse. Après bien des tracasseries administratives qui ne nous regardaient pas, nous nous sommes enfin mis au travail, Nicolas et moi, avec l'excitation liée au fait de ne rien maîtriser en amont des représentations des membres des ateliers, mais d'avoir à leur proposer un cadre dans lequel ils leur donneront cours. Bien des inconnues demeurent, mais l'envie de travailler ensemble sur un sujet, l'identité, l'appartenance, qui nous échappe individuellement, est bien réelle. Le hasard choisit bien les auteurs avec qui je travaille: pas de rivalité, ni de haussement de col. Juste l'envie de mettre deux expériences d'écriture au service de personnes qui veulent mener un projet à bout. Ça commence le 10 janvier à Lausanne, pile entre les deux lieux des ateliers qui suivront, histoire que l'exercice soit collectif et distinct, à la fois.
Ci-joint un extrait de mon "Aurélia Kreit", rendu public lors de ma conférence de septembre, sur le même thème. Un Aurélia à propos duquel les deux derniers lecteurs m'ont confié leur enthousiasme. Enfin. Des avis lambda mais qui font fait du bien.
20:08 Publié dans Blog | Lien permanent
30/11/2014
La question de la place.
Il en est donc du sentiment comme de l’origami : c’est au fur et à mesure qu’on le soumet à l’épreuve du temps qu’il se dévoile, protéiforme. Ce qu’on ne peut expliquer s’éclaircit, ce qu’on ne pouvait deviner intervient. La cristallisation se fait, on la sait contraire du jugement, on s’y attend, on peut sourire, parfois, de l’abêtissement qu’elle provoque. On voit l’amour comme une servilité, tout ce que l’on a déjà éprouvé est réduit à néant. Il n’existe pas de crédit dans ce domaine-là, on ne demande pas à quelqu’un qu’on rencontre de repartir avec soi au point où il ou elle a laissé sa vie. Deux menaces, alors, interviennent : la reproduction et l’hébétude. L’amour est prétentieux, les romantiques aussi, dans leur égotisme : ils croient que ce qu’ils ressentent est infini et éternel. Ils accolent les sentiments à des ailleurs, des lieux, des îles, des monuments. Ils définissent une mécanique des places, ressentent les serments que d’autres ont formulés avant eux au même endroit, s’en imprègnent, repartent convaincus de leur dépassement. On est tous des romantiques, alors, même si, pour beaucoup, il est plus simple de ne jamais se confronter à son inquiétude. C’est la question de la place, celle qui, jamais ne doit devenir posture : être acteur de son existence, écrivain de sa partition. Les mots servent à cela, les métaphores aussi, même si de la métaphore au cliché, il n’y a qu’un pas. Et la place, également, c’est celle que l’on peut se faire auprès de l’être qu’on s’apprête à aborder : il convient de savoir si les terrains sont disponibles, s’ils sont glissants, s’ils sont fertiles. On ne sait jamais ça tout de suite non plus et les terrains sont comme les vies, plus ou moins accidentés. On aborde une personne en toute inconscience de la phénoménologie qu’elle risque d’entraîner, des premières coïncidences aux choix qui se dessinent et en génèreront d’autres. C’est ainsi que le termes de Noces regroupe plusieurs acceptions : elles peuvent désigner le serment de mariage comme la réunion de deux âmes dans une même communauté. On peut dès lors se retrouver rapidement face au dilemme de reconnaître quelqu’un tout en étant soi-même uni, ou l’inverse. C’est un dilemme moral, une impossibilité supplémentaire, une place qui, dès lors, se dérobe : on ne fait que la visualiser mais elle se refuse à l’évidence, puisque sa seule réalité la pervertirait. La conquête éphémère ne vainc en fait que le désir que le désir que l’on éprouve pour l’autre, et ramène les empêchements à la surface. Dom Juan, par exemple, fait l’éloge de l’inconstance et du libertinage parce qu’il souffre de ne pas aimer assez, certes, mais aussi parce que l’amour qu’il porte l’est à une hauteur à laquelle l’autre, souvent, ne peut accéder.
- Vous avez aimé, Jim. Pour de bon, Jim. Cela se sent.*
Donc, on a aimé, on croit qu’on aime mais on ne sait pas à quoi la phase de l’abordage va conduire. On ne sait rien, en fait, sinon qu’on croit savoir et que le désordre amoureux est forcément incompatible avec l’ordre humain, moral, sociétal, qu’on s’est fixé. « Ça ne s’est pas fait. », répond Jim, justement, quand on lui demande pourquoi il n’a pas épousé celle qu’il a si bien aimée. Ou pourquoi, parfois, on peut ne pas aimer suffisamment bien celui ou celle qu’on a épousé. La théorie de la moitié manquante est bonne pour les poètes : en amour, tout commence par des chansons, tout finit par du chagrin, dit le poète. Et la rencontre, n’oublions pas, peut n’être que chimères, sur les places qu’elle libèrerait comme sur le reste. Les réalités simples et évidentes ne sont pas perceptibles par tous à la même échelle ; elles doivent être saines pour être pérennes, et le prix à payer pour, disons, créer dans les conditions requises, ne va pas dans ce sens, puisqu’il agît au pire en illusion contraire, au mieux en réalisation de soi sans forcément de don altruiste. Il est des nébuleuses qui découragent parfois, les mêmes qui ont pu attirer. L’astre et les ténèbres, les deux faces d’une même personne qui se refuse à ne vivre que moyennement quand tout ferait pourtant qu’il vivrait mieux.
16:55 Publié dans Blog | Lien permanent
29/11/2014
Ma banquière (ter).
Ma banquière, désormais, me donne des rendez-vous cinq minutes avant la fermeture de l’agence, quand il n’y a plus, dans la place, que la femme de ménage, elle et moi. Elle vient à ma rencontre, aujourd’hui, elle a de formidables collants couleur chair à gros poids rouges. Un ensemble impeccable, taillé sur ses grandes mesures. Elle me prie de rentrer, je n’en ferais rien, bref, je passe devant, puis je la laisse passer. Il y a entre nous un manège de séduction tel que même la Banque de France ne pourrait pas s’interposer. D’un coup, sa vie devient signifiante, nous déambulons, main dans la main, sur les berges du Rhône, elle est en week-end, pense à une année de disponibilité pour que nous fassions, ensemble, le tour du monde… Monsieur Cachard? MONSIEUR CACHARD? Vous n’avez pas stipulé « lu et approuvé », au recto de votre « clé en mains ».
13:47 Publié dans Blog | Lien permanent
28/11/2014
La haine des absents.
Comment est-ce qu’on vit avec les absents, ceux dont on nous a annoncé brutalement, en une seconde, qu’on ne les verrait plus jamais et qu’il faudrait se contenter, pour le restant de nos jours à nous, de ce qu’ils nous ont laissé comme souvenirs, comme traces, comme marques de permanence ? Déjà, toutes nos vies nous ont habitué à ça, en moins pire : les deuils amoureux, les amitiés qui se perdent, sans explications, les portes qu’on ferme sur des moments qui nous avaient semblé indélébiles. Comment est-ce qu’on fait ça quand, en plus, celui qui est parti a pris soin d’ancrer des mots qu’on lui a confiés dans une forme d’éternité, revendiquée à l’aune de nos post-adolescences d’alors ? Comment est-ce qu’on peut s’accommoder de ces « Ouessant » à partir desquels on a accumulé les années, sans toujours leur trouver du sens, quand lui les a inscrits dans une mythologie qu’on consulte avec mélancolie ? Je vis avec cet homme depuis douze ans, après les deux petites années qu’on a passées ensemble. Même si je n’ai pas tenu tous mes engagements, auprès des siens, par crainte, par paresse, par peur de l’effet-miroir, même si j’ai gagné en fatalité sur ce qu’on a fait, si j’ai accepté qu’on ne puisse pas, techniquement, remplacer son aléatoire jeu de guitare, son très mauvais harmoniciste, même s’il m’arrive, souvent, de penser qu’il vaut mieux être vivant que mort, quelles que soient les difficultés de la vie, je vis avec lui, et n’oublie pas que son dernier 28 novembre, il l’a passé dans les studios d’Eloise, pour une première, pour la première session de ce morceau de 16’40, qui ne colle pas beaucoup avec les formats radios, cette histoire d’un homme de trente ans qui va passer une nuit à Ouessant pour se convaincre qu’un cap n’est jamais infranchissable, et que l’important, ce n’est pas d’y avoir été, mais d’y être allé. Un sentiment que j’ai encore éprouvé en Ukraine, il y a peu. Ce 28.11 là, nous avions le monde pour lui, nous étions heureux, à l’avance, de le conquérir. Il aura passé sans nous, avec un peu plus, quand même, de moi que de lui. Mais il est en exergue de Tébessa, avec ce « Nocturne » qui m’étourdit à chaque écoute, il est dans mon présent puisque je n’ai jamais accepté qu’il fasse mon passé. J’ai beaucoup écrit sur lui, aussi, il me l’aurait reproché, ce sentimentalisme, l’aurait évacué d’un rire sonore et d’une vanne bien sentie. Ou d’une de ses formules, que je n’ai pas oubliée (litote) : Ce fut, et ce fut bien. C’est fini, c’est très bien (antiphrase).
Ouessant (Laurent Cachard/Fred Vanneyre) - NADA... par cachardl
12:11 Publié dans Blog | Lien permanent
27/11/2014
S'ouvrir au mouvement.
 Dans la démarche artistique, le plus difficile n’est pas de créer, mais d’assurer, juste derrière, le travail de promotion et de diffusion: la plupart du temps, s’il est fourni par l’artiste lui-même, ce travail-là devient contre-productif, parce que s’il ne sait pas se vendre, il ne parviendra à rien, et s’il sait le faire, l’essence même de son travail paraît douteuse. S’il n’est pas suivi, si on ne prend pas en charge la diffusion de son (vrai) travail, le peintre, l’écrivain, le musicien fera le tour de ses cercles de connaissances et, s’il est populaire en amont, s’il a beaucoup d’amis, se réjouira d’un succès d’estime en trompe-l’oeil. C’est le cercle vicié, en amont, celui que tout le monde connaît, un jour. Celui auquel je me confronte moi-même quand des maisons d’édition nationales refusent des manuscrits qui, une fois devenus livres, me valent des mêmes le reproche de ne pas l’avoir mieux édité. Pour autant, rien ne dédouane l’artiste du travail qui lui reste à faire une fois qu’il croit l’avoir terminé, c’est une chose dont je suis convaincu. Alors, puisque ce texte a été validé par deux éditeurs, puisqu’il est paru à la fois dans mon recueil de nouvelles et en tirage à part aux Editions du Réalgar, même s’il a déjà un an et demi, même si, même si, puisqu’on approche du 150ème anniversaire de la naissance de Camille Claudel et puisqu’elle a - au-delà du raisonnable - marqué mon existence, je viens d’envoyer un exemplaire de « Valse, Claudel » et du « Camille » qui va avec, à la commissaire de l’exposition qui lui sera consacrée, très vite, à la Piscine de Roubaix. Je ne l'ai jamais fait avant, alors que les occasions et les expositions se sont multipliées, ces dernières années. Au pire, je ne récolterai qu’un peu d’indifférence supplémentaire, au mieux, je provoquerai quelque chose. Avec deux ans de retard, mais qui s’arrêtera à ça, face aux 150 qu’elle nous rend aujourd’hui? Et si je peux restituer un peu de ce que Jean-Jacques Coulon et Stéphane Pétrier m’ont apporté dans cette aventure, eh bien, ça n’aura pas été vain. Ça l’est déjà moins que ce qu’on a fait d’elle, de son vivant.
Dans la démarche artistique, le plus difficile n’est pas de créer, mais d’assurer, juste derrière, le travail de promotion et de diffusion: la plupart du temps, s’il est fourni par l’artiste lui-même, ce travail-là devient contre-productif, parce que s’il ne sait pas se vendre, il ne parviendra à rien, et s’il sait le faire, l’essence même de son travail paraît douteuse. S’il n’est pas suivi, si on ne prend pas en charge la diffusion de son (vrai) travail, le peintre, l’écrivain, le musicien fera le tour de ses cercles de connaissances et, s’il est populaire en amont, s’il a beaucoup d’amis, se réjouira d’un succès d’estime en trompe-l’oeil. C’est le cercle vicié, en amont, celui que tout le monde connaît, un jour. Celui auquel je me confronte moi-même quand des maisons d’édition nationales refusent des manuscrits qui, une fois devenus livres, me valent des mêmes le reproche de ne pas l’avoir mieux édité. Pour autant, rien ne dédouane l’artiste du travail qui lui reste à faire une fois qu’il croit l’avoir terminé, c’est une chose dont je suis convaincu. Alors, puisque ce texte a été validé par deux éditeurs, puisqu’il est paru à la fois dans mon recueil de nouvelles et en tirage à part aux Editions du Réalgar, même s’il a déjà un an et demi, même si, même si, puisqu’on approche du 150ème anniversaire de la naissance de Camille Claudel et puisqu’elle a - au-delà du raisonnable - marqué mon existence, je viens d’envoyer un exemplaire de « Valse, Claudel » et du « Camille » qui va avec, à la commissaire de l’exposition qui lui sera consacrée, très vite, à la Piscine de Roubaix. Je ne l'ai jamais fait avant, alors que les occasions et les expositions se sont multipliées, ces dernières années. Au pire, je ne récolterai qu’un peu d’indifférence supplémentaire, au mieux, je provoquerai quelque chose. Avec deux ans de retard, mais qui s’arrêtera à ça, face aux 150 qu’elle nous rend aujourd’hui? Et si je peux restituer un peu de ce que Jean-Jacques Coulon et Stéphane Pétrier m’ont apporté dans cette aventure, eh bien, ça n’aura pas été vain. Ça l’est déjà moins que ce qu’on a fait d’elle, de son vivant.
15:49 Publié dans Blog | Lien permanent
26/11/2014
Ultra-moderne paranoïa.
Bon, j'aimerais bien que tous ceux qui sont censés se manifester le fassent, et ne me laissent pas dans cette gêne qui prend des allures d'hydre à multiples têtes, qui m'enferme dans des absolus qui n'ont rien d'inspirant.
17:22 Publié dans Blog | Lien permanent

















































