14/10/2024
Jourde & I.
15:44 Publié dans Blog | Lien permanent
27/09/2024
Le Bleu du lac - Jean Mattern
 Le Bleu du lac, un roman de 2018, est une tragédie grecque. Du moins en a-t-il les apparences, et même les personnages, puisque Viviane Craig, la narratrice, fait le trajet de métro londonien qu’elle a toujours connu pour se rendre chez son amant, James Fletcher, mais elle le fait dans une sorte d’hébétude, en petite robe noire qui la gratte, pour assister à ses obsèques et jouer pour lui, dans l’église de St Anselme et de Ste Cécile – deux martys, dont la patronne des musiciens - à la demande intrigante de son exécuteur testamentaire, l’Intermezzo de Brahms qu’il a toujours aimé, qui l’a toujours fait bander. Ce pourrait être tristement anodin, mais Viviane et James ont été des amants que rien ne prédestinait, surtout pas la vie maritale et heureuse qu’elle mène avec Sebastian. Qui l’a sortie un jour de son statut de Mme Bovary du piano – un seul disque enregistré vingt ans auparavant - pour la convaincre de remplacer un jour au pied levé le prodige croate Pogorelich à Wigmore, comme, se dit la narratrice, Anthony Hopkins a triomphé en substitute de Sir Laurence Olivier, ou Pavarotti, dans la Bohème. Cette amante ardente de Brahms connaît la gloire soudaine, les sollicitations, et accepte l’invitation à dîner de cet homme atypique, grand vulgarisateur télévisuel de la musique classique à la BBC. Ils deviendront des amants comme seule l’acception classique peut définir : des êtres qui aiment et qui sont aimés en retour. Connaîtront la plénitude dans le secret, jamais la culpabilité. Viviane, dans ce train de la District line, se dit qu’ils incarnaient, puisque c’est le mot, le mythe d’Aristophane – je n’étais plus rien d’autre que sa partie manquante, et lui la mienne – mais elle ne peut rien en dire, à personne, doit se convaincre qu’elle fait le trajet pour un enterrement à la place d’une étreinte, un cercueil à la place de son lit, qu’elle aura passé sa vie à vouloir échapper à un amour trop grand pour eux pour finir emmurée, comme une nouvelle Antigone : je me sens comme une héroïne de tragédie grecque sans avoir l’étoffe pour le rôle. Elle remonte leurs étreintes, son emprise, s’apprête à croiser ceux et celles à qui il aura brisé le cœur ou le nez – il pratiquait la boxe – par sa gueule d’ange et sa candeur, son uppercut impeccable et son sexe majestueux. Mais elle ne les verra pas, et s’en réjouit : faute de place dans le chœur, le piano a été placé à côté de l’orgue, en haut. On ne la verra pas non plus, elle n'aura qu’à laisser la musique ruisseler.
Le Bleu du lac, un roman de 2018, est une tragédie grecque. Du moins en a-t-il les apparences, et même les personnages, puisque Viviane Craig, la narratrice, fait le trajet de métro londonien qu’elle a toujours connu pour se rendre chez son amant, James Fletcher, mais elle le fait dans une sorte d’hébétude, en petite robe noire qui la gratte, pour assister à ses obsèques et jouer pour lui, dans l’église de St Anselme et de Ste Cécile – deux martys, dont la patronne des musiciens - à la demande intrigante de son exécuteur testamentaire, l’Intermezzo de Brahms qu’il a toujours aimé, qui l’a toujours fait bander. Ce pourrait être tristement anodin, mais Viviane et James ont été des amants que rien ne prédestinait, surtout pas la vie maritale et heureuse qu’elle mène avec Sebastian. Qui l’a sortie un jour de son statut de Mme Bovary du piano – un seul disque enregistré vingt ans auparavant - pour la convaincre de remplacer un jour au pied levé le prodige croate Pogorelich à Wigmore, comme, se dit la narratrice, Anthony Hopkins a triomphé en substitute de Sir Laurence Olivier, ou Pavarotti, dans la Bohème. Cette amante ardente de Brahms connaît la gloire soudaine, les sollicitations, et accepte l’invitation à dîner de cet homme atypique, grand vulgarisateur télévisuel de la musique classique à la BBC. Ils deviendront des amants comme seule l’acception classique peut définir : des êtres qui aiment et qui sont aimés en retour. Connaîtront la plénitude dans le secret, jamais la culpabilité. Viviane, dans ce train de la District line, se dit qu’ils incarnaient, puisque c’est le mot, le mythe d’Aristophane – je n’étais plus rien d’autre que sa partie manquante, et lui la mienne – mais elle ne peut rien en dire, à personne, doit se convaincre qu’elle fait le trajet pour un enterrement à la place d’une étreinte, un cercueil à la place de son lit, qu’elle aura passé sa vie à vouloir échapper à un amour trop grand pour eux pour finir emmurée, comme une nouvelle Antigone : je me sens comme une héroïne de tragédie grecque sans avoir l’étoffe pour le rôle. Elle remonte leurs étreintes, son emprise, s’apprête à croiser ceux et celles à qui il aura brisé le cœur ou le nez – il pratiquait la boxe – par sa gueule d’ange et sa candeur, son uppercut impeccable et son sexe majestueux. Mais elle ne les verra pas, et s’en réjouit : faute de place dans le chœur, le piano a été placé à côté de l’orgue, en haut. On ne la verra pas non plus, elle n'aura qu’à laisser la musique ruisseler.
Viviane doit vivre la brutalité – j’ai laissé la bombe éclater en moi – d’un deuil qu’elle ne peut dire à personne, qui fait écho à celui qu’elle a vécu dix mois avant, quand sa fille Laura s’est tuée bêtement, en glissant dans sa douche, le 11 septembre 2001, laissant les images se confondre avec une autre tragédie. Elle doit faire face, également, à la honte – l’addition de nos fautes fait aussi le prix d’une vie - quand l’un des drames prend le pli sur l’autre, inconsciemment. Quel sens a le deuil d’une femme mûre pour son amant, quand elle a vécu la plus absolue des tragédies ? La voix de Laura s’efface petit à petit de sa mémoire, concède-t-elle ; si celle de James devait s’éloigner elle aussi, alors je saurai que la vie ne vaut pas d’être vécue. James est mort en provoquant le diable, en n’écoutant pas les apnées du sommeil qui se multipliaient, refusant de masquer son beau visage d’un appareil respiratoire. Combien de temps faut-il pour mourir ainsi, se demande celle qu’on affubla du surnom détesté de Greta Garbo du piano – qui pourtant puisa la force de son jeu et de son mystère dans ses amours clandestines ? Moins longtemps que l’Intermezzo en Si bémol qu’elle doit jouer pour lui. Dire que nos vies se jouent ainsi, en quelques secondes…
Comme toujours chez Mattern, les récits s’entremêlent sans qu’il ait besoin de les traiter tous. Au pire, il en fera un autre livre, lui qui aime jongler avec les similitudes, dans les prénoms – Gabriel, le gendre français, qui repart avec Simon, son fils, une fois sa femme disparue – comme dans le jeu des origines, ici l’identité populaires de James, la façon dont il a dû s’en défaire. On note celui in abstentia de Sebastian, son documentaire sur le Septembre noir, ses voyages à Munich et en Israël, dont il est rentré différent, sans qu’on en sache plus. La façon dont il intervient in fine - je n’en dirai rien ici - pour une chute qui redéfinit tout ce qui a été dit auparavant. Cette femme en robe noire, condamnée à un deuil clandestin, se jure qu’elle ira une fois par an là où son amant se recueillait, sur les rives du Lac d’Annecy, retrouver les reflets du Lac bleu de Cézanne, cette toile qu’il chérissait. Qui lui revient quand elle voit celui entre Wimbledon Park et Southfields, dernier aperçu de la nature avant de traverser la Tamise. Et cette question, lancinante : puisque son corps disparaît, son esprit, en suis-je (encore) la gardienne ou n’existe-t-il simplement plus ?
15:53 Publié dans Blog | Lien permanent
26/09/2024
Pierre Jourde, le Réservoir, le 26.09.2024
 Une heure et demie avec Pierre Jourde, c’est très frustrant – surtout quand on apprend rétroactivement qu’il aurait pu en tenir trois – mais c’est assez pour rentrer chez soi avec le plaisir d’avoir présenté un auteur essentiel, à l’œuvre foisonnante, dans ses trois veines (dit-il lui-même), le romancier, l’essayiste, le philosophe, au sens de contemporain capital qu’il n’aurait jamais dû quitter. J’ai « attaqué » Jourde par son texte le plus complexe, peut-être, Littérature & Authenticité, le réel, le neutre, la fiction, accélérant ma première question au risque de perdre l’auditoire, dans une version du Dasein mêlé de St Nectaire. Mais l’avantage avec Jourde, s’est-on dit sur le chemin vers le Réservoir, c’est qu’on n’est pas à l’abri d’un moment de franche rigolade, et ça n’a pas manqué, dans cette belle rencontre que j’ai voulue comme couvrant l’essentiel de ses œuvres, moins celles que je n’ai pas retenues, la tautologie est là. Puisqu’il dit lui-même que son essai philosophique s’appuie sur des passages entiers de Pays perdu - le roman pour lequel, à son corps défendant, tout le monde l’a connu - on arrive vite à cette œuvre de 2003, qu’il a voulue ode à la paysannerie et pour laquelle on a voulu attenter à sa vie, à celle de sa femme et à celle de ses trois enfants, dont le plus petit, un an, a fini blessé. Moins que celui qu’il a étendu pour le compte – réflexe de boxer – et pour lequel on l’a assigné en justice, ce qu’il a fait en retour. L’exégèse de cette histoire, il la raconte dans la première pierre, dont il lit un extrait, montrant que ce livre-là, les gens du coin ne l’ont pas lu, qu’ils en ont juste entendu parler, nourrissant la légende que les campagnes se construisent sur du récit du récit.
Une heure et demie avec Pierre Jourde, c’est très frustrant – surtout quand on apprend rétroactivement qu’il aurait pu en tenir trois – mais c’est assez pour rentrer chez soi avec le plaisir d’avoir présenté un auteur essentiel, à l’œuvre foisonnante, dans ses trois veines (dit-il lui-même), le romancier, l’essayiste, le philosophe, au sens de contemporain capital qu’il n’aurait jamais dû quitter. J’ai « attaqué » Jourde par son texte le plus complexe, peut-être, Littérature & Authenticité, le réel, le neutre, la fiction, accélérant ma première question au risque de perdre l’auditoire, dans une version du Dasein mêlé de St Nectaire. Mais l’avantage avec Jourde, s’est-on dit sur le chemin vers le Réservoir, c’est qu’on n’est pas à l’abri d’un moment de franche rigolade, et ça n’a pas manqué, dans cette belle rencontre que j’ai voulue comme couvrant l’essentiel de ses œuvres, moins celles que je n’ai pas retenues, la tautologie est là. Puisqu’il dit lui-même que son essai philosophique s’appuie sur des passages entiers de Pays perdu - le roman pour lequel, à son corps défendant, tout le monde l’a connu - on arrive vite à cette œuvre de 2003, qu’il a voulue ode à la paysannerie et pour laquelle on a voulu attenter à sa vie, à celle de sa femme et à celle de ses trois enfants, dont le plus petit, un an, a fini blessé. Moins que celui qu’il a étendu pour le compte – réflexe de boxer – et pour lequel on l’a assigné en justice, ce qu’il a fait en retour. L’exégèse de cette histoire, il la raconte dans la première pierre, dont il lit un extrait, montrant que ce livre-là, les gens du coin ne l’ont pas lu, qu’ils en ont juste entendu parler, nourrissant la légende que les campagnes se construisent sur du récit du récit.
Jourde, en Alceste de la critique, s’énerve souvent de l’habitude qui consiste à parler « autour » des textes et non pas « des » textes. Aussi ai-je essayé, après mon décalogue critique, de parler de ses textes, arrivant vite à cet absolu de beauté qu’est Winter is coming, un livre sur le deuil de son fils de 20 ans, l’ange Gabriel, foudroyé par une maladie rare. J’en lis – puisqu’il ne peut pas le faire, et je le comprends – l’extrait sublime dans lequel il porte sur son dos son fils de 20 ans redevenu son bébé, retiens les larmes que j’ai eues à la lecture, enchaîne sur autre chose, allez tiens, pourquoi pas Dieu, puisqu’il a écrit pour les Tracts de Gallimard un Croire en Dieu, pourquoi ? qui n’a rien d’anodin puisqu’il pose en soi la problématique de l’utilité dans un domaine supposé immanent, au-dessus même de toute question. Y répondant en six points, qui vont de la Création à sa bizarrerie, de l’autorité des textes sacrés au choix d’un Dieu (plutôt qu’un autre), des prescriptions divines au concept de morale. Il confesse un agnosticisme provoqué par son éducation religieuse, relie les nouveaux catéchismes – de gauche, souvent - à ceux qu’on énonçait chez les abbés au XIX°. À peine le temps de lui faire évoquer ses brûlots récurrents sur la culture - de C'est la culture qu'on assassine en 2011 à La culture bouge encore en 2015, jusqu’à On achève bien la culture -, le temps de lier ça à l’inculture qu’a permis la destruction organisée du système scolaire, il est malheureusement l’heure de plier, le Réservoir n’étant pas extensible sur les horaires. Il faut qu’il signe ses livres, Jourde, mais pas avant de nous réserver une belle surprise, la lecture de quelques pages de son roman à venir, la marchande d’oublies - Voilà l’plaisir, mesdames, voilà l’plaisir ! - un roman monstrueux dans sa forme, dans son sujet et dans le personnage central. À entendre le silence du public, ses réactions, à la fin, nul doute que le dernier Jourde sera de la même eau que ceux pour lesquels on l’a fait venir. Même pas le temps d’aborder – ouvertement – son amitié avec Chevillard, de dire un mot sur Alexandre Jardin autrement que par l’alexandrin que l’auteur de l’Autofictif a sublimé (Alexandre Jardin a terminé un livre), il est temps de clore et se dire que Jourde aux Automn’Halles, c’est déjà du passé. Mais il y a du passé qui dure, et c’est heureux. Inoubliable, même.
Photo: Pierre Ech-Ardour
23:15 | Lien permanent
22/09/2024
Les bains de Kiraly - Jean Mattern
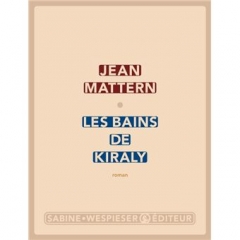 On retrouve dans les bains de Kiraly – rétroactivement, c’est un roman de 2008 – ce qui fait la force et l’originalité des romans de Jean Mattern : contenir des pans entiers de l’Histoire (et son pendant, l’histoire familiale) en 120 pages, chez Sabine Wespieser. En suivant les révélations de Gabriel, le narrateur – on n’en connaît le prénom qu’au mitant du roman – dans une synagogue de Londres, qui lancent une construction cyclique du roman, l’emmène à présenter l’histoire d’amour absolue et évidente – deux êtres humains peuvent-ils reposer l’un dans l’autre ? – qu’il a vécue avec Laura, ses rires, ses passions, leur voyage à Amsterdam, son enthousiasme à elle devant les Tournesols de Van Gogh, son sang à lui qui se glace devant la ronde de nuit de Rembrandt, le souvenir du père à l’annonce de la mort accidentelle de sa fille. Sa sœur, Marianne. Il avait 10 ans, et l’incipit renvoie à la mécanique du corps, aux pas hébétés posés dans le cimetière en suivant le convoi, qu’il voudrait pouvoir revivre en pleine conscience. Laura lui a permis, dit-il, de sortir de la salle d’attente de sa propre vie, du moins le croit-il. Jusqu’à ce que son parcours – études brillantes (pour deux ?), fuite déguisée en Angleterre – le ramène à ses propres démons, la langue que chuchotaient ses parents, le fatum – Dieu a donné, Dieu a repris, les préceptes du père – que Léo, qu’il rencontre dans un cercle de lecture, va opposer à Mr Porree, spécialiste du Roi Lear. Les deux se lient d’une amitié indéfectible, et c’est dans la confession – par lettres, un temps où ils éraient éloignés l’un de l’autre – que Léo va trouver les mots que lui n’a jamais sus, traitant de la mort de Charlotte, sa sœur à lui, par méningite quand il avait 10 ans, également. Des lettres qui vont faire écho, dans le deuil impossible et l’isolement qu’il provoque, des confidences qui étaient autant de révélations sur (m)a propre histoire. Avec, pour mise en abyme, un film au ciné-club, vu ensemble, l’histoire d’une fratrie anéantie par la mort brutale du grand frère. Les répliques de cette mutation – ces changements soudains définis par Virilio – seront brutales, provoqueront la nécessité d’en savoir plus sur son identité réelle, à peine entraperçue par sa visite, un été, à l’oncle Jozsef (le même que dans les rives du Danube ?) - excentrique professeur d’histoire au Lycée Foch de Montpellier, qu’il n’aura pas eu le temps de vraiment connaître – son enfance en Hongrie, la tache aveugle de notre géographie familiale, souligne Gabriel. Lui-même est devenu un linguiste redoutable, habitué à ses grammaires intimes, qui trouvera chez M.Stobetzky, le libraire de Bar-sur-Aude (le village parental) les réponses qu’il comptait trouver dans la Bible, (mal)traduite de l’hébreu. C’est sur Thomas Mann que le libraire orientera ce gamin de 13-14 ans qui dévore 5 livres par semaine, en fera le futur traducteur de Tonio Krüger, du même auteur. Ce qui le mènera à Budapest, pour un colloque sur l’écrivain. Et là, au hasard d’une visite dans le cimetière Kerepesi, dans les allées, son regard se porte sur une tombe, celle de Kareth Roth, son grand-père. Lequel a bien été Juif pendant quelques semaines. Gabriel, dont les cauchemars récurrents le ramènent au trou béant avec, au fond, le cercueil de Marianne, vivra cette succession de révélations comme une libération doublée d’une damnation. Ira nager à chaque fois qu’on le mettra en face de ses choix ou de la paternité qui s’annonce à lui. Pour oublier que les bruits du cœur de son enfant, à l’échographie, se confondent avec l’écho des pelletées de terre qu’on a jetées sur le cercueil de sa sœur. Remontera l’écheveau jusqu’à cette impression, dans la synagogue de Budapest, de ne pas être là par hasard, d’être de retour.
On retrouve dans les bains de Kiraly – rétroactivement, c’est un roman de 2008 – ce qui fait la force et l’originalité des romans de Jean Mattern : contenir des pans entiers de l’Histoire (et son pendant, l’histoire familiale) en 120 pages, chez Sabine Wespieser. En suivant les révélations de Gabriel, le narrateur – on n’en connaît le prénom qu’au mitant du roman – dans une synagogue de Londres, qui lancent une construction cyclique du roman, l’emmène à présenter l’histoire d’amour absolue et évidente – deux êtres humains peuvent-ils reposer l’un dans l’autre ? – qu’il a vécue avec Laura, ses rires, ses passions, leur voyage à Amsterdam, son enthousiasme à elle devant les Tournesols de Van Gogh, son sang à lui qui se glace devant la ronde de nuit de Rembrandt, le souvenir du père à l’annonce de la mort accidentelle de sa fille. Sa sœur, Marianne. Il avait 10 ans, et l’incipit renvoie à la mécanique du corps, aux pas hébétés posés dans le cimetière en suivant le convoi, qu’il voudrait pouvoir revivre en pleine conscience. Laura lui a permis, dit-il, de sortir de la salle d’attente de sa propre vie, du moins le croit-il. Jusqu’à ce que son parcours – études brillantes (pour deux ?), fuite déguisée en Angleterre – le ramène à ses propres démons, la langue que chuchotaient ses parents, le fatum – Dieu a donné, Dieu a repris, les préceptes du père – que Léo, qu’il rencontre dans un cercle de lecture, va opposer à Mr Porree, spécialiste du Roi Lear. Les deux se lient d’une amitié indéfectible, et c’est dans la confession – par lettres, un temps où ils éraient éloignés l’un de l’autre – que Léo va trouver les mots que lui n’a jamais sus, traitant de la mort de Charlotte, sa sœur à lui, par méningite quand il avait 10 ans, également. Des lettres qui vont faire écho, dans le deuil impossible et l’isolement qu’il provoque, des confidences qui étaient autant de révélations sur (m)a propre histoire. Avec, pour mise en abyme, un film au ciné-club, vu ensemble, l’histoire d’une fratrie anéantie par la mort brutale du grand frère. Les répliques de cette mutation – ces changements soudains définis par Virilio – seront brutales, provoqueront la nécessité d’en savoir plus sur son identité réelle, à peine entraperçue par sa visite, un été, à l’oncle Jozsef (le même que dans les rives du Danube ?) - excentrique professeur d’histoire au Lycée Foch de Montpellier, qu’il n’aura pas eu le temps de vraiment connaître – son enfance en Hongrie, la tache aveugle de notre géographie familiale, souligne Gabriel. Lui-même est devenu un linguiste redoutable, habitué à ses grammaires intimes, qui trouvera chez M.Stobetzky, le libraire de Bar-sur-Aude (le village parental) les réponses qu’il comptait trouver dans la Bible, (mal)traduite de l’hébreu. C’est sur Thomas Mann que le libraire orientera ce gamin de 13-14 ans qui dévore 5 livres par semaine, en fera le futur traducteur de Tonio Krüger, du même auteur. Ce qui le mènera à Budapest, pour un colloque sur l’écrivain. Et là, au hasard d’une visite dans le cimetière Kerepesi, dans les allées, son regard se porte sur une tombe, celle de Kareth Roth, son grand-père. Lequel a bien été Juif pendant quelques semaines. Gabriel, dont les cauchemars récurrents le ramènent au trou béant avec, au fond, le cercueil de Marianne, vivra cette succession de révélations comme une libération doublée d’une damnation. Ira nager à chaque fois qu’on le mettra en face de ses choix ou de la paternité qui s’annonce à lui. Pour oublier que les bruits du cœur de son enfant, à l’échographie, se confondent avec l’écho des pelletées de terre qu’on a jetées sur le cercueil de sa sœur. Remontera l’écheveau jusqu’à cette impression, dans la synagogue de Budapest, de ne pas être là par hasard, d’être de retour.
La narration se croise entre cette nécessité du passé et l’urgence du présent, leur incompatibilité, ces mensonges faits de silence et d’absence, dans son dictionnaireland de bureau. Il écrit à Léo, officiellement pour lui dire sa joie d’être bientôt père, mais lui avoue, dans le même temps – le courriel est reproduit in extenso dans le roman – que c’est lui, Léo, qui a trouvé dans les courriers qu’il lui envoyait, les mots pour dire comment on meurt, et, plus grave, qu’il ne sait pas dans quelle langue il lui faudra parler à son enfant. Il est devenu un spécialiste des mots, oui, mais des mots des autres, et l’aveu qu’il fait de ceux qu’il a volés à Léo –qui ont sans doute séduit sa femme, à distance – est un aveu terrible. Inextricable pour quelqu’un dont la quête – la voie/la voix – ne conduira qu’à la demande du Grand Pardon –même à Yom Kippour, un Juif n’est pas seul devant Dieu - pour ceux qu’il a abandonnés au nom de ceux qui l’ont laissé. C’est incroyable comme c’est facile de partir, se dit-il dans les bains turcs du grand hôtel Gellert, à Budapest. C’est sans doute beaucoup plus complexe de rester, oui. Encore faut-il avoir la notion du temps.
NB : ce très beau roman est écrit sous l’égide de Jérémie, le livre de Franz Werfel que son oncle Jozsef lui a offert pour ses 13 ans. Une histoire qui fait lien entre le présent et la crise que traverse Clayton Jeeve, un jeune écrivain anglais dont la mort de sa femme, Leonora, a provoqué une dépression qui a tari sa créativité. Écoutons ce qu’en dit Bernard Bach, dans sa critique roman de la protestation ou le courage de la confiance (Germanica, 2002) :« Mais le mal dont souffre Clayton Jeeves n’est pas seulement conjoncturel, il est plus profond, il est existentiel : C’est l’angoisse du vide et de l’absurde qui paralyse son affirmation créatrice. Cela provoque chez lui un sentiment de séparation de lui-même d’avec l’ensemble de la réalité, un sentiment d’isolement du soi comme individu. Clayton Jeeves a comme l’impression d’avoir été attiré à Jérusalem contre son gré, en ce lieu mystérieux qu’il éprouve comme le centre du monde). Ce qu’il est venu chercher ou redécouvrir en ce lieu, même s’il n’en pas immédiatement conscience, c’est ce centre spirituel qu’il est en train de perdre et qui donnait une réponse, symbolique, à la question de la signification de l’existence et sur lequel peut s’appuyer l’affirmation créatrice de soi. Le voyage à Jérusalem exprime symboliquement la quête de ce centre essentiel susceptible de guérir Clayton de son mal existentiel ».
18:30 Publié dans Blog | Lien permanent
17/09/2024
KALACH MAMBO.
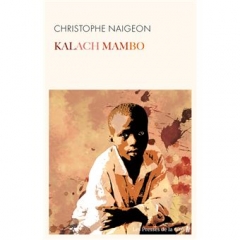 Avec Kalach Mambo, Christophe Naigeon clôt sa trilogie du Libéria en anamorphose, chacun des trois romans trouvant une répercussion dans les deux autres. Ici, il prend comme sujet l’histoire de Moses, Moe, devenu enfant-soldat suite au massacre de toute- du moins le croit-on – sa famille dans son village de Be Wani, par un commando de femmes au service de Charles Taylor, le dictateur en place. Il a 32 ans quand il raconte, il en avait 7 – le jour où je devenu le plus vieux de la famille - quand il a vu cette femme au sourire carnassier abattre son père, sa petite sœur, sa grand-mère, son grand-père aveugle et tous les autres sans une hésitation, cherchant jusqu’au bout quelqu’un – un rebelle ? Ils ne connaissaient même pas le terme – à tuer. Sans le voir lui, caché sous terre ou presque, à hauteur du pied de la Colonel, dont il ne verra que le collier de pied, en véritables dents humaines. Jusqu’à ce jour, j’ignorais la haine, confie-t-il, lui qui consacrera sa vie – en fait, 5 ans, à peine – à se venger. Entre temps, il est recueilli par le Colonel Mother-Blessing, celui qui épargne les mères, et deviendra un de ces smo’sodia (p’tits soldats), vite baptisé Hitler-Killer, un surnom auquel il ne comprend rien mais qu’il adopte : j’ai pris ça pour un encouragement. Il fait partie des 176 gamins dans l’escadron des Léopards, échappe, de par son très jeune âge, aux drogues que les plus âgés – 20 ans, sans avenir - enquillent pour trouver un sens. Un jour, il sauve la vie de son colonel, devient son homme de confiance, toujours accompagné de sa Sister Beretta, son M12. Des ennemis, on n’avait que ça, comprend-il, dans ces milieux corrompus où les diamants font monter les têtes. Lui ne sait pas ce que c’est, pas plus que les femmes, il veut devenir un super soldat invincible, suit une initiation, inachevée, d’homme-léopard, un sujet avec lequel Naigeon finissait Libéria, le 2e volume. Il apprendra à être invisible – j’ai fait ce que je savais faire- sera envoyé pour arracher le cœur de l’ennemi, pour que son Général, Pepper & Salt, puisse le manger : on le prône dans le Coran. La première fois qu’il voit une femme nue – du commando des Butt Naked – au bord de l’océan, lui qui n’a connu que la forêt ou presque, elle le braque de son AK-47, se déclare invincible, elle aussi, il la tue pourtant, simplement, dans cette guerre menée par des fous, entre des fous encouragés par des maîtres-fous. Ce sera sa 10e victime, il se jure que ce sera la dernière. Sauf la Femme, qu’il lui faudra retrouver pour assouvir sa vengeance. Il a deux objectifs, Moe : la trouver, 5 ans après, et savoir lire et écrire. Pour ça, il doit rejoindre Monrovia, se fondre parmi les Libériens ; il connaîtra les affres des repentis, tuera de nouveau pour s’en sortir, suivra son instruction non pas à Don Bosco, où il serait reconnu par d’autres enfants-soldats, mais à la Self Help School, où sa rencontre avec Mister Ghankay, l’instituteur, va changer sa vie. Ainsi que l’arrivée, dans la ville, de Julien, un journaliste, suivi de Jipé, son preneur de son et ami. Les énonciations sont croisées, dans la deuxième partie du roman, Julien est intrigué par ce gamin jeune-vieux, croit l’amadouer en l’emmenant au cinéma, pour la première fois de sa vie, en lui offrant ses premières baskets, son premier restaurant et le maillot du Milan AC, club de l’icône locale Georges Weah – qui deviendra en 2017 président de son pays ! – premier Africain Ballon d’Or FIFA. Il est d’une intelligence brute, sans cultures, pense Julien de lui, il veut faire un film sur les gens d’ici, dans ce pays au nom usurpé, où mourir ou vivre n’est qu’une question de chance. Dans son reportage, Julien va rencontrer une escort-girl, Ophélia, dont l’histoire est mêlée à celle de son pays, un tenancier de restau qui rêve de redonner à son établissement, le Black Frog, ses heures passées de club de jazz. Ça tombe bien, Jipé – un Iggy Pop en moins destroy - le preneur de son, est un pianiste hors-pair, et les soirées qu’il anime sur le quart de queue sont si marquantes que Cook, le patron, rêve de le voir rester et reconstruire. Entre temps, le roman remonte le récit chaotique du Libéria, en guerre civile depuis 1980 et le coup d’état de Samuel Doe qui a tué de ses mains le président Tolbert, entraînant 15 années de conflit avant un cessez-le-feu, et celle, plus récente, de Moe, des trois armées en uniforme, qui s’arrangent des pillages et des tueurs ivres en liberté, les laissant s’entretuer pour reprendre la main, après, entre ennemis. Parmi eux, une femme politique mondaine, ne jurant que par les séries télévisées américaines – K2000 ou Charlie’s Angel, son surnom – et couverte par l’ONU – N’est-ce pas qu’elle a reconnu que nous nous sommes bien comportés ? - redevient Général quand les choses se corsent, jubilant et caressant sa tenue militaire avec volupté. Elle sera évidemment le lien manquant entre les histoires croisées, mais le lecteur devra savoir comment Moe est remonté jusqu’à elle, comment il a découvert la musique via Jipé, qui le verra vibrer sur Akhenaton comme jamais il n’a vibré. Cet heureux lecteur verra également Julien et Sandra se tourner autour sur fond de Légende des Siècles, d’Amin Maalouf, de dédicaces perdues dans le vide – nous aurons été au moins poètes – et des femmes qu’on n’a pas su retenir. Il s’interrogera, lui aussi, sur le mobile, les explications, que l’histoire dans l’Histoire de Moe ne comble pas : retranscrire, traduite, révèle les lacunes d’un texte, écrit Naigeon, et le cinéma, la télévision, favorisent par le montage, la musique, les approximations, les mensonges par omission. On n’a rien, que des dingues et des menteurs !, s’énerve Julien. Le cinéma peut faire du encore plus vrai, mais n’est pas le monde réel, seulement celui en qui les enfants - qui n’ont vu de l’Amérique que ce qu’elle a de pire à montrer - croient comme ils croient en Dieu. C’est un roman qui pourrait être sans issue si Christophe Naigeon ne lui en offrait une, en finale, en remontant à l’origine même du pays, de son idée, par une subtile anamorphose, disais-je, renvoyant, à la fin du 3e volume, au 1er. À l’esclavage, à Julius Washington, à Jules Carnot – et à Josephine Baker, de fait - dans la maison de Mamba Point. C’est malin, et ça répond à une gageure lancée en amont, au Black Frog Club, quand l’un des convives - mise en abyme - propose de faire un roman de ce maelstrom. Il en aura fallu trois.
Avec Kalach Mambo, Christophe Naigeon clôt sa trilogie du Libéria en anamorphose, chacun des trois romans trouvant une répercussion dans les deux autres. Ici, il prend comme sujet l’histoire de Moses, Moe, devenu enfant-soldat suite au massacre de toute- du moins le croit-on – sa famille dans son village de Be Wani, par un commando de femmes au service de Charles Taylor, le dictateur en place. Il a 32 ans quand il raconte, il en avait 7 – le jour où je devenu le plus vieux de la famille - quand il a vu cette femme au sourire carnassier abattre son père, sa petite sœur, sa grand-mère, son grand-père aveugle et tous les autres sans une hésitation, cherchant jusqu’au bout quelqu’un – un rebelle ? Ils ne connaissaient même pas le terme – à tuer. Sans le voir lui, caché sous terre ou presque, à hauteur du pied de la Colonel, dont il ne verra que le collier de pied, en véritables dents humaines. Jusqu’à ce jour, j’ignorais la haine, confie-t-il, lui qui consacrera sa vie – en fait, 5 ans, à peine – à se venger. Entre temps, il est recueilli par le Colonel Mother-Blessing, celui qui épargne les mères, et deviendra un de ces smo’sodia (p’tits soldats), vite baptisé Hitler-Killer, un surnom auquel il ne comprend rien mais qu’il adopte : j’ai pris ça pour un encouragement. Il fait partie des 176 gamins dans l’escadron des Léopards, échappe, de par son très jeune âge, aux drogues que les plus âgés – 20 ans, sans avenir - enquillent pour trouver un sens. Un jour, il sauve la vie de son colonel, devient son homme de confiance, toujours accompagné de sa Sister Beretta, son M12. Des ennemis, on n’avait que ça, comprend-il, dans ces milieux corrompus où les diamants font monter les têtes. Lui ne sait pas ce que c’est, pas plus que les femmes, il veut devenir un super soldat invincible, suit une initiation, inachevée, d’homme-léopard, un sujet avec lequel Naigeon finissait Libéria, le 2e volume. Il apprendra à être invisible – j’ai fait ce que je savais faire- sera envoyé pour arracher le cœur de l’ennemi, pour que son Général, Pepper & Salt, puisse le manger : on le prône dans le Coran. La première fois qu’il voit une femme nue – du commando des Butt Naked – au bord de l’océan, lui qui n’a connu que la forêt ou presque, elle le braque de son AK-47, se déclare invincible, elle aussi, il la tue pourtant, simplement, dans cette guerre menée par des fous, entre des fous encouragés par des maîtres-fous. Ce sera sa 10e victime, il se jure que ce sera la dernière. Sauf la Femme, qu’il lui faudra retrouver pour assouvir sa vengeance. Il a deux objectifs, Moe : la trouver, 5 ans après, et savoir lire et écrire. Pour ça, il doit rejoindre Monrovia, se fondre parmi les Libériens ; il connaîtra les affres des repentis, tuera de nouveau pour s’en sortir, suivra son instruction non pas à Don Bosco, où il serait reconnu par d’autres enfants-soldats, mais à la Self Help School, où sa rencontre avec Mister Ghankay, l’instituteur, va changer sa vie. Ainsi que l’arrivée, dans la ville, de Julien, un journaliste, suivi de Jipé, son preneur de son et ami. Les énonciations sont croisées, dans la deuxième partie du roman, Julien est intrigué par ce gamin jeune-vieux, croit l’amadouer en l’emmenant au cinéma, pour la première fois de sa vie, en lui offrant ses premières baskets, son premier restaurant et le maillot du Milan AC, club de l’icône locale Georges Weah – qui deviendra en 2017 président de son pays ! – premier Africain Ballon d’Or FIFA. Il est d’une intelligence brute, sans cultures, pense Julien de lui, il veut faire un film sur les gens d’ici, dans ce pays au nom usurpé, où mourir ou vivre n’est qu’une question de chance. Dans son reportage, Julien va rencontrer une escort-girl, Ophélia, dont l’histoire est mêlée à celle de son pays, un tenancier de restau qui rêve de redonner à son établissement, le Black Frog, ses heures passées de club de jazz. Ça tombe bien, Jipé – un Iggy Pop en moins destroy - le preneur de son, est un pianiste hors-pair, et les soirées qu’il anime sur le quart de queue sont si marquantes que Cook, le patron, rêve de le voir rester et reconstruire. Entre temps, le roman remonte le récit chaotique du Libéria, en guerre civile depuis 1980 et le coup d’état de Samuel Doe qui a tué de ses mains le président Tolbert, entraînant 15 années de conflit avant un cessez-le-feu, et celle, plus récente, de Moe, des trois armées en uniforme, qui s’arrangent des pillages et des tueurs ivres en liberté, les laissant s’entretuer pour reprendre la main, après, entre ennemis. Parmi eux, une femme politique mondaine, ne jurant que par les séries télévisées américaines – K2000 ou Charlie’s Angel, son surnom – et couverte par l’ONU – N’est-ce pas qu’elle a reconnu que nous nous sommes bien comportés ? - redevient Général quand les choses se corsent, jubilant et caressant sa tenue militaire avec volupté. Elle sera évidemment le lien manquant entre les histoires croisées, mais le lecteur devra savoir comment Moe est remonté jusqu’à elle, comment il a découvert la musique via Jipé, qui le verra vibrer sur Akhenaton comme jamais il n’a vibré. Cet heureux lecteur verra également Julien et Sandra se tourner autour sur fond de Légende des Siècles, d’Amin Maalouf, de dédicaces perdues dans le vide – nous aurons été au moins poètes – et des femmes qu’on n’a pas su retenir. Il s’interrogera, lui aussi, sur le mobile, les explications, que l’histoire dans l’Histoire de Moe ne comble pas : retranscrire, traduite, révèle les lacunes d’un texte, écrit Naigeon, et le cinéma, la télévision, favorisent par le montage, la musique, les approximations, les mensonges par omission. On n’a rien, que des dingues et des menteurs !, s’énerve Julien. Le cinéma peut faire du encore plus vrai, mais n’est pas le monde réel, seulement celui en qui les enfants - qui n’ont vu de l’Amérique que ce qu’elle a de pire à montrer - croient comme ils croient en Dieu. C’est un roman qui pourrait être sans issue si Christophe Naigeon ne lui en offrait une, en finale, en remontant à l’origine même du pays, de son idée, par une subtile anamorphose, disais-je, renvoyant, à la fin du 3e volume, au 1er. À l’esclavage, à Julius Washington, à Jules Carnot – et à Josephine Baker, de fait - dans la maison de Mamba Point. C’est malin, et ça répond à une gageure lancée en amont, au Black Frog Club, quand l’un des convives - mise en abyme - propose de faire un roman de ce maelstrom. Il en aura fallu trois.
Christophe Naigeon, Kalach Mambo, les Presses de la Cité, 2024.
22:55 Publié dans Blog | Lien permanent
16/09/2024
Le Grand.
 L’ironie a voulu qu’on me prévienne au moment de l’exergue, quand on se demande à qui on va dédier le livre qu’on vient de boucler. En 50000 mots, petite coquetterie oulipienne. Auxquels il va falloir, à vie, ajouter les 27 qui disent ce que personne n’a encore dit publiquement, mais qui s’est transmis, dans la matinée, à la vitesse de l’éclair, parmi les amis qu’il comptait par milliers, ou plus, tant le Grand était un élément fédérateur de ce que tout Lyon recense dans le spectacle vivant. Un programmateur, un facilitateur, un gérant et un ami. Il a fallu, en plus de ça, qu’on m’apprenne qu’il était à Vaugneray, au Simplextival, vendredi, avec Lyne, qui en assurait le catering, mais qu’ils sont partis avant les concerts, avant que j’arrive, donc, moi qui me réjouissais de peut-être les voir, comme on les voit (un peu) partout quand Stéphane est par là. J’ai encore son message de la fin août, quand il comptait me mettre en relation avec Benjamin Biolay, parrain de la St Louis, comme ils en avaient convenu au Radiant, en février. Ça n’est jamais bon signe, quand on remonte les dates, ça pousserait presque à en parler au passé alors que l’actualité est tellement forte, chez lui, la Grèce, bientôt, la Corse, où deux maisons, dont une d’amis, les attendent, la Nouvelle-Calédonie, pour que Lyne se fasse faire les rougails-saucisses qu’elle n’a eu de cesse de faire pour les autres, à la Casa. Leur Casa. Je serai à vie le premier écrivain – sans trop de problèmes de vocabulaire – à utiliser le plus de fois ces trois mots, rougail-saucisse et Casa dans un recueil qu’il ne verra hélas pas, dont on aurait évidemment fêté la sortie là-bas, avant qu’ils vendent, avant qu’on en fasse un temps d’avant. C’était déjà dur de s’imaginer sans cet endroit qu’on a tellement fréquenté, pour eux comme pour ce qui s’y passait, c’est encore plus absurde d’imaginer qu’on ne le verra pas passer la tête pour surveiller si la prise de son s’y passe bien, que sa grande carcasse rassurante ne fera pas écho à la nôtre.
L’ironie a voulu qu’on me prévienne au moment de l’exergue, quand on se demande à qui on va dédier le livre qu’on vient de boucler. En 50000 mots, petite coquetterie oulipienne. Auxquels il va falloir, à vie, ajouter les 27 qui disent ce que personne n’a encore dit publiquement, mais qui s’est transmis, dans la matinée, à la vitesse de l’éclair, parmi les amis qu’il comptait par milliers, ou plus, tant le Grand était un élément fédérateur de ce que tout Lyon recense dans le spectacle vivant. Un programmateur, un facilitateur, un gérant et un ami. Il a fallu, en plus de ça, qu’on m’apprenne qu’il était à Vaugneray, au Simplextival, vendredi, avec Lyne, qui en assurait le catering, mais qu’ils sont partis avant les concerts, avant que j’arrive, donc, moi qui me réjouissais de peut-être les voir, comme on les voit (un peu) partout quand Stéphane est par là. J’ai encore son message de la fin août, quand il comptait me mettre en relation avec Benjamin Biolay, parrain de la St Louis, comme ils en avaient convenu au Radiant, en février. Ça n’est jamais bon signe, quand on remonte les dates, ça pousserait presque à en parler au passé alors que l’actualité est tellement forte, chez lui, la Grèce, bientôt, la Corse, où deux maisons, dont une d’amis, les attendent, la Nouvelle-Calédonie, pour que Lyne se fasse faire les rougails-saucisses qu’elle n’a eu de cesse de faire pour les autres, à la Casa. Leur Casa. Je serai à vie le premier écrivain – sans trop de problèmes de vocabulaire – à utiliser le plus de fois ces trois mots, rougail-saucisse et Casa dans un recueil qu’il ne verra hélas pas, dont on aurait évidemment fêté la sortie là-bas, avant qu’ils vendent, avant qu’on en fasse un temps d’avant. C’était déjà dur de s’imaginer sans cet endroit qu’on a tellement fréquenté, pour eux comme pour ce qui s’y passait, c’est encore plus absurde d’imaginer qu’on ne le verra pas passer la tête pour surveiller si la prise de son s’y passe bien, que sa grande carcasse rassurante ne fera pas écho à la nôtre.
J’ai aimé cet homme pour le calme qu’il dégageait, l’autorité qu’il savait manifester, quand il le fallait. Je l’ai vu fréquenter des gens (très) connus, d’autres non, sans aucune espèce de différence. Je crois pouvoir dire qu’il appréciait mon recul quant à ce système, qu’il comprenait pourquoi je disais non quand il me proposait d’aller voir l’artiste en loge, après son concert. Lui y allait parce qu’il ne faisait pas partie du décor, il l’était, le décor, par son flegme et le fait que l’artiste lui savait gré d’être là, de tout arranger pour que tout se passe bien. Il m’a envoyé vers son ami François Morel, à Sète, l’hiver dernier, je l’ai remercié pour les places, j’ai forcé ma nature pour aller saluer la vedette à la fin, j’ai aimé le sourire de cet homme quand je lui ai dit que je venais de sa part à lui, au Grand. Je ne suis pas de son premier cercle, mais on se retrouvait avec plaisir, je les revois chez moi – j’attendais qu’ils reviennent – ou, il n’y a pas longtemps, chez Jutard. Son grand ami Nilda est parti il y a bientôt cinq ans, ça n’était pas prévu qu’il le rejoigne si vite, qu’il nous laisse sans élément fédérateur, sans les dernières dates à la Casa dont la fin se reportait d’elle-même, faute d’avoir encore vendu la maison. Même sa chute dans une piscine sans eau – sans la mythologie rock’n’roll, il a toujours été dans le contrôle - les opérations du poignet qui ont suivi, ces dernières années, n’ont pas eu raison de son enthousiasme, l’ont peut-être poussé à lever le pied, à considérer autrement les années de retraite que Lyne et lui se sont patiemment fabriquées. Quoi de plus normal, finalement, que son trop gros cœur n’ait pas tenu ? Il y a beaucoup de tristesse chez ceux qu’il a laissé, les connus, les anonymes. Il faudra du temps et des artistes pour qu’elle se transforme. D’ici là, laissez-nous avec notre peine, et notre cœur à nous qui se serre.
15:00 Publié dans Blog | Lien permanent
14/09/2024
SIMPLEXSTIVAL.
 Ça aussi, c’est nouveau. Un éditeur de disques – à l’ancienne, vinyls, exclusivement, bandes oubliées et restaurées de groupes lyonnais (et alentours) qui ont eu leur heure de gloire – qui décide de faire une grande fête, d’inviter quelques-uns de ses poulains et, après tout, pourquoi pas, de donner son nom à ce nouveau festival en rase campagne, qui a avant tout l’avantage d’être…juste à côté de chez lui. Le 1er Simplextival - jusqu’aux programmes, on a cru à un canular – à Vaugneray, donc, compte trois groupes, dont un ne coûte pas cher en musiciens puisque Danilo – déjà vu au Tiki Vinyl Store – joue seul devant son rideau à lamelles argentées. Il est doué, Danilo[1], et ses chansonnettes, faussement légères, restent bien en tête, mériteraient de toucher plus qu’un VRP en goguette dans un hôtel de banlieue, histoire que lui aussi, comme il l’a fait il y a longtemps, se demande ce qu’il est en train de faire (ou de ne pas faire) de sa vie, en Méthadone ou ailleurs. Il a son très jeune fils qui fait le show dans la fosse, et ça tombe bien, ça libère des très nombreux photographes qui empêchent un peu le public d’avancer sur des morceaux aussi bons que Bienvenue en Enfer, ou de nouveaux titres, assez porteurs, un Qui aurait cru qu’une nuit blanche m’aurait guéri ? signifiant. Il terminera sur LMQR, la mélodie qui reste, en hommage à sa maman, aux chanteurs-crooners qu’elle écoutait et qu’il est devenu, pour elle. Danilo-Pétrier-(Fragments of) Factory, c’est une belle première affiche, sachant qu’on y va plutôt pour l’un que pour l’autre. On serait même en pleine battle de dinosaures, entre le Pétrier des Noz et ses 40 ans de scène et les encore plus vieux Puce et Matrat, leaders du groupe mythique de Givors Factory, alliés à la section rythmique du groupe lyonnais de power pop the Segments pour revisiter leur répertoire 1977-1980 et les titres de l’album L'Amérique à la casse, ressorti à l’occasion chez Simplex Records. Du rock dur comme l’aime l’Eddy Barclay valnégrien, qui dénote un peu avec la douceur des deux premiers impétrants, qui savent durcir le ton, néanmoins, quand il le faut. Et qui a, quand on parle de Pétrier, le matos pour, sur scène, avec sa session rythmique de l’homme coupé en deux (Simon/Habouzit, en relation visuelle permanente), le synthé et les choeurs de Mathieu Larue, les cuivres de Samuelle de Jesus Pires – quelle entrée trompette/batterie sur Houdini II ! - et le son cristallin de l’éternel acolyte Éric Clapot (et son nouvel ampli), celui qui lui a permis d’aller au bout d’un projet qu’il voulait tenir du début à la fin, à son idée. C’est toujours drôle de voir débarquer Pétrier, ses idées loufoques qu’il met en disque ou en romans, dans le monde du rock’n’roll dur, parce que la finalité n’est pas la même quand il faut faire bouger les popotins ou quand il s’agit de chercher l’équilibre entre le récit – LCED est là encore un roman musical – et la mélodie, l’abandon. Oh, à terme, il a l’habitude, et l’autorité, pour tenir sa place (bien souvent mieux que les autres), mais au départ, ça n’est jamais gagné. Comme tout, remarque. Le voilà qui débarque avec ses copains, sur une grande scène – Éric dira qu’il avait du mal à trouver Damien, pourtant imposant, du regard - il a la charge de passer après la belle prestation de Danilo, son aquoibonisme contagieux, et d’ouvrir pour un groupe dont le public aurait cloué ses Noz au pilori, il y a quarante ans. Sans doute se demande-t-il, comme à chaque fois, les raisons qui le poussent à se mettre en danger, mais le refrain est connu de tous ceux qui le suivent : un bonjour poli, la main dans les cheveux, le micro saisi à deux mains dans un angle des coudes parfaitement réglé, et c’est parti. Une heure pour raconter une histoire, la grande vie d’Houdini (Pétrier lui a consacré deux morceaux, pour épater sa fille, qui lui disait que Kaaris lui avait déjà dédié un titre, sans qu’aucun ne puisse présumer qu'Eminem en ferait, récemment, le single le plus écouté sur la toile…), le lien qu’il a développé avec son frère, les secrets de ses tours les plus célèbres, dont le titre du disque. Du livre-disque, comme ceux qu’on dévorait enfant dans le mange-disque familial. Il faudrait savoir la part des fantasmes enfantins dans la réalisation de ces projets d’adultes, dans le fait de développer autant d’énergie et d’application – au sens antique, les jeunes, quand le mot désignait qu’on allait prendre le temps, pas qu’on allait en gagner à tout prix – pour aller au bout de choses bien anachroniques qu’assez peu de gens, en somme, regardent d’un air poli. Et un poil consterné. Heureusement qu’il en reste des comme ça, des rêveurs, parce qu’on serait bien étriqué, dans nos vies bien calmes. Pas sûr que les rêveries de son Altesse soient du même acabit que celles des Factory, leur comédie musicale sur des textes de Manchette, leur reprise reggae de À la claire fontaine chez Drucker quand les Noz étaient en 4e, les deux morceaux qu’ils ont composés pour le film Le Bahut va craquer, puisqu’on en parle. Mais aussi, récemment, la parution des 11 titres inédits de L'Amérique à la casse, enregistré en 1977 et remasterisé par Simplex Records. Dont ce Flying From The Hairy Stars qui ne peut laisser indifférent les aficionados du mythique gang givordin et les amateurs de rock qui racle et roule, dit le maître des lieux lui-même. Qu’on peut croire mais pas forcément suivre, dans mon cas : litote inside. Moi je suis venu voir comment allait se comporter l’homme coupé en deux au milieu (c’est le mot) de ce cirque-là, pas forcément le sien. Avec un public pas nécessairement venu pour lui, de fait, qui reconnait peut-être Denis Simon parce qu’il a un jour pété les tympans de tout le public du Pez-ner lors d’un concert de rupture avec les Syoodj ou parce qu’il joue (aussi) avec les Slaughter & the dogs, qui leur correspond davantage, en amont, que l’éternel ado hirsute qui secoue sa crinière pour se donner du courage et entamer sa sérénade. L’histoire, une fois encore, de Johnny Eck, né sans jambes, avec une colonne vertébrale en miettes et un torse atrophié, condamné à autant de contorsions sociales que circassiennes et célèbre pour son numéro d’homme coupé en deux. Paradoxe, sur scène, dans un tel festival, celui qui chante cette histoire-là n’a pas de truc, pas de faux-fond dans la malle, il faut donner tout de suite pour que ça prenne. Pas d’illusion, dans le rock n’roll, sinon celle qui s’empare de vous quand on commence ou quand on ne sait pas suffisamment se juger, après le show. Son Je ne dors jamais intrigue les oreilles venues écouter autre chose, il est pêchu et interroge sur les mystères de la création, de l’imaginaire qu’on subit, quand le cerveau tourne à 3000 la nuit, toujours pour envisager le pire. LHCED déroule, Stéphane s’excuse auprès de son producteur et de son batteur d’avoir écrit St Etienne – le morceau – mais le joue avec force, s’excuse d’être parfois un peu déconnecté à l’autre bout du monde mais le défend musicalement via son avatar, les Beaux restes, en full band, confirme son titre de tube interplanétaire : une chanson écrite pour un ami qui est parti, et aussi pour ceux qui sont restés et qui ont la chance de continuer ce truc époustouflant, merveilleux, dramatique et ébouriffant qu’est la vie, annonce Pétrier. Il y a Nu dans la crevasse – pardon, sur le rond-point – au tambourin, un morceau inédit, l’anachronique et oulipesque pour un rien joué en acoustique, au tabouret et le groupe entier pour finir sur Besoin de personne, la plus belle contre-vérité jamais chantée, surtout quand on attend tout du public. Une trois-centaine de personnes, venues, je l’ai dit, pour des raisons différentes, qui auront supporté, dans la deuxième partie de soirée, l’absence de sièges ailleurs que dans la salle, l’évaporation ultra-rapide du blanc au bar et le fait que personne n’ait même touché l’album d’Aurelia Kreit, en vente avec les autres productions Simplex. Une belle soirée néanmoins, dans cette salle de l’Intervalle au son & lumière parfait, peut-être (encore) un peu grande pour autre chose que du très connu et très commun. Mais son atrium, pour finir, valait peut-être davantage que la salle, pour les visages connus, les histoires qui remontent, les promesses qu’on se fait – comme dans les enterrements, dira Guillaume. Évidemment, le froid glacial et l’attente de Jo – pas inintéressant – auront raison de mes derniers anticorps et me vaudront un rappel courroucé du producteur à l’oreillette, à 8h20. Il doit être content, on l’est pour lui : ça n’est pas tous les jours qu’on inaugure un festival, qu’on crée un rendez-vous.
Ça aussi, c’est nouveau. Un éditeur de disques – à l’ancienne, vinyls, exclusivement, bandes oubliées et restaurées de groupes lyonnais (et alentours) qui ont eu leur heure de gloire – qui décide de faire une grande fête, d’inviter quelques-uns de ses poulains et, après tout, pourquoi pas, de donner son nom à ce nouveau festival en rase campagne, qui a avant tout l’avantage d’être…juste à côté de chez lui. Le 1er Simplextival - jusqu’aux programmes, on a cru à un canular – à Vaugneray, donc, compte trois groupes, dont un ne coûte pas cher en musiciens puisque Danilo – déjà vu au Tiki Vinyl Store – joue seul devant son rideau à lamelles argentées. Il est doué, Danilo[1], et ses chansonnettes, faussement légères, restent bien en tête, mériteraient de toucher plus qu’un VRP en goguette dans un hôtel de banlieue, histoire que lui aussi, comme il l’a fait il y a longtemps, se demande ce qu’il est en train de faire (ou de ne pas faire) de sa vie, en Méthadone ou ailleurs. Il a son très jeune fils qui fait le show dans la fosse, et ça tombe bien, ça libère des très nombreux photographes qui empêchent un peu le public d’avancer sur des morceaux aussi bons que Bienvenue en Enfer, ou de nouveaux titres, assez porteurs, un Qui aurait cru qu’une nuit blanche m’aurait guéri ? signifiant. Il terminera sur LMQR, la mélodie qui reste, en hommage à sa maman, aux chanteurs-crooners qu’elle écoutait et qu’il est devenu, pour elle. Danilo-Pétrier-(Fragments of) Factory, c’est une belle première affiche, sachant qu’on y va plutôt pour l’un que pour l’autre. On serait même en pleine battle de dinosaures, entre le Pétrier des Noz et ses 40 ans de scène et les encore plus vieux Puce et Matrat, leaders du groupe mythique de Givors Factory, alliés à la section rythmique du groupe lyonnais de power pop the Segments pour revisiter leur répertoire 1977-1980 et les titres de l’album L'Amérique à la casse, ressorti à l’occasion chez Simplex Records. Du rock dur comme l’aime l’Eddy Barclay valnégrien, qui dénote un peu avec la douceur des deux premiers impétrants, qui savent durcir le ton, néanmoins, quand il le faut. Et qui a, quand on parle de Pétrier, le matos pour, sur scène, avec sa session rythmique de l’homme coupé en deux (Simon/Habouzit, en relation visuelle permanente), le synthé et les choeurs de Mathieu Larue, les cuivres de Samuelle de Jesus Pires – quelle entrée trompette/batterie sur Houdini II ! - et le son cristallin de l’éternel acolyte Éric Clapot (et son nouvel ampli), celui qui lui a permis d’aller au bout d’un projet qu’il voulait tenir du début à la fin, à son idée. C’est toujours drôle de voir débarquer Pétrier, ses idées loufoques qu’il met en disque ou en romans, dans le monde du rock’n’roll dur, parce que la finalité n’est pas la même quand il faut faire bouger les popotins ou quand il s’agit de chercher l’équilibre entre le récit – LCED est là encore un roman musical – et la mélodie, l’abandon. Oh, à terme, il a l’habitude, et l’autorité, pour tenir sa place (bien souvent mieux que les autres), mais au départ, ça n’est jamais gagné. Comme tout, remarque. Le voilà qui débarque avec ses copains, sur une grande scène – Éric dira qu’il avait du mal à trouver Damien, pourtant imposant, du regard - il a la charge de passer après la belle prestation de Danilo, son aquoibonisme contagieux, et d’ouvrir pour un groupe dont le public aurait cloué ses Noz au pilori, il y a quarante ans. Sans doute se demande-t-il, comme à chaque fois, les raisons qui le poussent à se mettre en danger, mais le refrain est connu de tous ceux qui le suivent : un bonjour poli, la main dans les cheveux, le micro saisi à deux mains dans un angle des coudes parfaitement réglé, et c’est parti. Une heure pour raconter une histoire, la grande vie d’Houdini (Pétrier lui a consacré deux morceaux, pour épater sa fille, qui lui disait que Kaaris lui avait déjà dédié un titre, sans qu’aucun ne puisse présumer qu'Eminem en ferait, récemment, le single le plus écouté sur la toile…), le lien qu’il a développé avec son frère, les secrets de ses tours les plus célèbres, dont le titre du disque. Du livre-disque, comme ceux qu’on dévorait enfant dans le mange-disque familial. Il faudrait savoir la part des fantasmes enfantins dans la réalisation de ces projets d’adultes, dans le fait de développer autant d’énergie et d’application – au sens antique, les jeunes, quand le mot désignait qu’on allait prendre le temps, pas qu’on allait en gagner à tout prix – pour aller au bout de choses bien anachroniques qu’assez peu de gens, en somme, regardent d’un air poli. Et un poil consterné. Heureusement qu’il en reste des comme ça, des rêveurs, parce qu’on serait bien étriqué, dans nos vies bien calmes. Pas sûr que les rêveries de son Altesse soient du même acabit que celles des Factory, leur comédie musicale sur des textes de Manchette, leur reprise reggae de À la claire fontaine chez Drucker quand les Noz étaient en 4e, les deux morceaux qu’ils ont composés pour le film Le Bahut va craquer, puisqu’on en parle. Mais aussi, récemment, la parution des 11 titres inédits de L'Amérique à la casse, enregistré en 1977 et remasterisé par Simplex Records. Dont ce Flying From The Hairy Stars qui ne peut laisser indifférent les aficionados du mythique gang givordin et les amateurs de rock qui racle et roule, dit le maître des lieux lui-même. Qu’on peut croire mais pas forcément suivre, dans mon cas : litote inside. Moi je suis venu voir comment allait se comporter l’homme coupé en deux au milieu (c’est le mot) de ce cirque-là, pas forcément le sien. Avec un public pas nécessairement venu pour lui, de fait, qui reconnait peut-être Denis Simon parce qu’il a un jour pété les tympans de tout le public du Pez-ner lors d’un concert de rupture avec les Syoodj ou parce qu’il joue (aussi) avec les Slaughter & the dogs, qui leur correspond davantage, en amont, que l’éternel ado hirsute qui secoue sa crinière pour se donner du courage et entamer sa sérénade. L’histoire, une fois encore, de Johnny Eck, né sans jambes, avec une colonne vertébrale en miettes et un torse atrophié, condamné à autant de contorsions sociales que circassiennes et célèbre pour son numéro d’homme coupé en deux. Paradoxe, sur scène, dans un tel festival, celui qui chante cette histoire-là n’a pas de truc, pas de faux-fond dans la malle, il faut donner tout de suite pour que ça prenne. Pas d’illusion, dans le rock n’roll, sinon celle qui s’empare de vous quand on commence ou quand on ne sait pas suffisamment se juger, après le show. Son Je ne dors jamais intrigue les oreilles venues écouter autre chose, il est pêchu et interroge sur les mystères de la création, de l’imaginaire qu’on subit, quand le cerveau tourne à 3000 la nuit, toujours pour envisager le pire. LHCED déroule, Stéphane s’excuse auprès de son producteur et de son batteur d’avoir écrit St Etienne – le morceau – mais le joue avec force, s’excuse d’être parfois un peu déconnecté à l’autre bout du monde mais le défend musicalement via son avatar, les Beaux restes, en full band, confirme son titre de tube interplanétaire : une chanson écrite pour un ami qui est parti, et aussi pour ceux qui sont restés et qui ont la chance de continuer ce truc époustouflant, merveilleux, dramatique et ébouriffant qu’est la vie, annonce Pétrier. Il y a Nu dans la crevasse – pardon, sur le rond-point – au tambourin, un morceau inédit, l’anachronique et oulipesque pour un rien joué en acoustique, au tabouret et le groupe entier pour finir sur Besoin de personne, la plus belle contre-vérité jamais chantée, surtout quand on attend tout du public. Une trois-centaine de personnes, venues, je l’ai dit, pour des raisons différentes, qui auront supporté, dans la deuxième partie de soirée, l’absence de sièges ailleurs que dans la salle, l’évaporation ultra-rapide du blanc au bar et le fait que personne n’ait même touché l’album d’Aurelia Kreit, en vente avec les autres productions Simplex. Une belle soirée néanmoins, dans cette salle de l’Intervalle au son & lumière parfait, peut-être (encore) un peu grande pour autre chose que du très connu et très commun. Mais son atrium, pour finir, valait peut-être davantage que la salle, pour les visages connus, les histoires qui remontent, les promesses qu’on se fait – comme dans les enterrements, dira Guillaume. Évidemment, le froid glacial et l’attente de Jo – pas inintéressant – auront raison de mes derniers anticorps et me vaudront un rappel courroucé du producteur à l’oreillette, à 8h20. Il doit être content, on l’est pour lui : ça n’est pas tous les jours qu’on inaugure un festival, qu’on crée un rendez-vous.
[1] Il les lâche, ses chansons, sur la route, sur les différents dépits que la vie propose au fur et à mesure qu’on s’y coltine. Dans Méthadone, il y a cette voix qui lui répond – c’est sans doute sa chérie, elle est dans la bonne cinquantaine de jeunes qui ont peuplé l’endroit : (tu reviendras) je ne reviendrai pas (tu reviendras) nan, il nique la panique, parmi les nombreuses interjections qui ponctuent son show, il se décrit lui-même quasi-ingénieur en quête de contrats se demandant ce qu’il fait là et s’imposant, pour survivre, sa première composition, Danilo, avec son look anachronique d’Elno ressurgi de nulle part s’étonne en permanence d’être là, d’avoir été signé, à l’ancienne, de pouvoir montrer ce qu’il sait faire et quand il aura définitivement cessé de le faire, ses chansons gagneront encore, comme sur disque, où la production et le spectre musical impressionnent. CDT 26.01.2024
09:55 Publié dans Blog | Lien permanent
10/09/2024
JOURDOTHÈQUE (10/10)
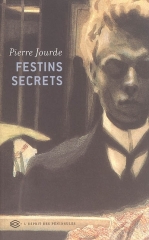 Dans Festins screts, sorti là aussi il y a bientôt vingt ans, Pierre Jourde entrecroise des histoires liées à un seul et même destin, celui d’un agrégé de Lettres stagiaire qui va connaître sa première affectation – à 1200€ - dans un collège prioritaire de Logres, dans le Nord. Une ville qui n’existe pas, dans la réalité, mais dont la sémantique – la géographie symbolique - n’échappe pas à l’aspirant-fonctionnaire, pour qui le premier trajet, déjà, est éloquent. Il croise, dans le compartiment, un vieil homme qui pourrait être son double, qui a enseigné là-bas, n’a jamais su en sortir mais y revient tout de même. Il en dresse un tableau apocalyptique, concentrationnaire, parle d’une ville délétère qui, intimement, pue. Il l’avertit (à votre place, je fuirais tout de suite) puis se dissipe, laissant place à une famille de dégénérés qui ne fait que relever la lâcheté latente de l’homme – Gilles Saurat – qui prend sa mutation comme une semi-vérité sans fondement, voire l’opportunité de se débarrasser de la femme qu’il n’aime plus mais à qui il n’ose le dire. Ses premiers pas au collège Prévert sont l’occasion, pour Jourde, de dresser un portrait au vitriol des fossés entre réalité sociale et discours pédagogiste – entre sigles, acronymes, évaluations et propos sur l’inénarrable bienveillance. Son personnage, que le narrateur interpelle dans l’énonciation, croise des professeurs devenus de vieux acteurs oubliés par leur public,les corps tristes de vieux soutiers de la pédagogie. Tu as trouvé là ton enfer. Pour l’éternité, lui assène-t-on, alors qu’il croise Zablanski, le prof d’histoire, un Cioran des collèges qui lui décrit, avec cynisme et détachement, une apocalypse miniature. Il sera question, néanmoins, de violences permanentes – jusqu’au meurtre, dans la Cité voisine - de harcèlement, d’antisémitisme. Et de la cohabitation silencieuse de la plèbe et des notables de la ville, que Saurat rencontre chez sa logeuse, Mme Van Reeth, veuve d’un grand collectionneur qui fit des envieux et des jaloux, au point que sa noyade est restée un mystère, au même titre que son implication – à titre de témoin – dans l’Affaire des disparues de la Côte du Soleil. Il en faut peu pour que cette bourgeoisie, que Jourde traite à la Balzac - dans des scènes de dîners pour lesquels on le charge de faire l’homme de maison - attire la curiosité du personnage, fasciné par leur attraction pour le Mal, leur envie avouée de le réintroduire pour le neutraliser, pour cette ville qui, dit-on, se nourrit de fictions.
Dans Festins screts, sorti là aussi il y a bientôt vingt ans, Pierre Jourde entrecroise des histoires liées à un seul et même destin, celui d’un agrégé de Lettres stagiaire qui va connaître sa première affectation – à 1200€ - dans un collège prioritaire de Logres, dans le Nord. Une ville qui n’existe pas, dans la réalité, mais dont la sémantique – la géographie symbolique - n’échappe pas à l’aspirant-fonctionnaire, pour qui le premier trajet, déjà, est éloquent. Il croise, dans le compartiment, un vieil homme qui pourrait être son double, qui a enseigné là-bas, n’a jamais su en sortir mais y revient tout de même. Il en dresse un tableau apocalyptique, concentrationnaire, parle d’une ville délétère qui, intimement, pue. Il l’avertit (à votre place, je fuirais tout de suite) puis se dissipe, laissant place à une famille de dégénérés qui ne fait que relever la lâcheté latente de l’homme – Gilles Saurat – qui prend sa mutation comme une semi-vérité sans fondement, voire l’opportunité de se débarrasser de la femme qu’il n’aime plus mais à qui il n’ose le dire. Ses premiers pas au collège Prévert sont l’occasion, pour Jourde, de dresser un portrait au vitriol des fossés entre réalité sociale et discours pédagogiste – entre sigles, acronymes, évaluations et propos sur l’inénarrable bienveillance. Son personnage, que le narrateur interpelle dans l’énonciation, croise des professeurs devenus de vieux acteurs oubliés par leur public,les corps tristes de vieux soutiers de la pédagogie. Tu as trouvé là ton enfer. Pour l’éternité, lui assène-t-on, alors qu’il croise Zablanski, le prof d’histoire, un Cioran des collèges qui lui décrit, avec cynisme et détachement, une apocalypse miniature. Il sera question, néanmoins, de violences permanentes – jusqu’au meurtre, dans la Cité voisine - de harcèlement, d’antisémitisme. Et de la cohabitation silencieuse de la plèbe et des notables de la ville, que Saurat rencontre chez sa logeuse, Mme Van Reeth, veuve d’un grand collectionneur qui fit des envieux et des jaloux, au point que sa noyade est restée un mystère, au même titre que son implication – à titre de témoin – dans l’Affaire des disparues de la Côte du Soleil. Il en faut peu pour que cette bourgeoisie, que Jourde traite à la Balzac - dans des scènes de dîners pour lesquels on le charge de faire l’homme de maison - attire la curiosité du personnage, fasciné par leur attraction pour le Mal, leur envie avouée de le réintroduire pour le neutraliser, pour cette ville qui, dit-on, se nourrit de fictions.
Peu à peu, il va sortir, clandestinement, de l’espace qu’on lui a alloué, dans la maison, dans la forêt proche aussi, dans laquelle ses virées nocturnes l’emmènent à l’irréalité d’une présence dont il tombe amoureux, scénario étrangement prévu et retrouvé dans l’ordinateur de M. Van Reeth, écrit…trois ans avant qu’il arrive en ville. Comme s’il y avait une fatalité dans cette géhenne et qu’il n’y échappait pas. Un pandémonium, un dossier Gérien, une sirène dans la sylve cachée et le lien qui se fait entre toutes les histoires. Il n’y a pas d’autre vie que celle des nuits dans la forêt, se dit-il, au moment où se propre réalité se joue, dans les couloirs d’une administration kafkaienne ou dans les renoncements auxquels on le destine (tu comprends vite que tu ne parviendras à rien enseigner). On envisage les bacchanales des notables comme les sauvageries des enfants perdus, qui ne sauront jamais qui est Jean Bijoux – l’avatar de Sollers, vraisemblablement- mais regrettent collectivement qu’Hitler n’en ait eu que 6 millions. La fatalité qui colle aux victimes, au point qu’elles s’associent aux bourreaux pour s’acheter une paix sociale, est une des grandes pistes de réflexion du livre, qui n’en manque pas. La discussion, qui se poursuit au café, entre le prof d’histoire, Zablanski, et le jeune lettré encore idéaliste, résonne étrangement, vingt ans après, quand il est question des crimes d’honneur, des délits de fuite, des victimes de l’exclusion dont Z. dit qu’ils sont en fait les Dieux de leur famille, qui ont décrété que si le monde ne ressemble pas assez à Maman, alors il faut laver le sacrilège, à tout prix. La culture de l’excuse, évoquée via Hegel ou Girard, son bouc émissaire. On a eu la dureté dans des sociétés contraignantes, on a l’indulgence dans une société de liberté, assène l’historien, qui montre par l’exemple qu’il est désormais impossible d’emmener des élèves radicalisés visiter un mémorial de la déportation juive. Si les récits se croisent, dans la culture du secret des uns et l’acculturation de la masse des autres, c’est que Jourde veut montrer que les premiers – les maîtres, les favorisés – sont aussi morts que les autres, les asservis. Que Logres, qui porte bien son nom, est une ville-Moloch, qui retient son agent dès qu’il veut la quitter, et dont les habitants ne s’animent qu’en présence de celui qu’elle a accroché. Un piège, une plante carnivore, dit-on, sans qu’il en ressente, dans un premier temps, d’autre symptôme que l’innocuité de la pensée, quand la mort de sa mère, par exemple, l’emmène à se demander si elle a jamais existé. Les fantômes sur les faux quais de gare, lors du voyage initial, auraient dû l’avertir, mais c’est un voyage sans fin – sans heure d’arrivée non plus – qui engloutira sa thèse, repère ironique d’un ancien temps, lui a déjà échoué à faire l’écrivain. Les figures des repas chez Mme Van Reeth sont imbriquées l’une à l’autre par les histoires et les secrets, soigneusement consignés dans l’ordinateur du défunt, auxquels il faudra néanmoins accoler une réalité, que Saurat fuit de lui-même : il y retrouve la fille du train, l’ancien professeur, également, qu’on accusa de pédophilie. C’est l’âme noire de la ville que Van Reeth a consignée. La suite, la fin, l’analepse, appartiennent au roman lui-même : il convient de savoir si le supplicié s’en sort, s’il y a une issue dans ces enfers croisés.
On peut se féliciter, à la lecture de cet ouvrage massif, dense, parfois délité, d’avoir vécu une première affectation plutôt tranquille, en 1993. Naïve, sans doute, sans conscience du zablanskisme, sur le seul terrain de l’Éducation Nationale, étrillée façon puzzle. Les âmes damnées des petites communes, pour autant, n’ont jamais été aussi actuelles, dans leurs agissements, leurs réseaux et leurs cadavres – réels ou pas – dans des placards qu’on n’en finit pas de fermer.
18:45 Publié dans Blog | Lien permanent

















































