04/03/2024
JOURDOTHÈQUE (3/10)
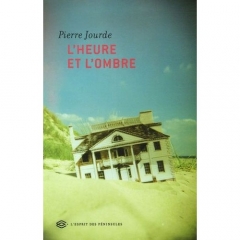 Pierre Jourde fait trop souvent référence à « l’heure et l’ombre», un roman qu’il a publié en 2006 – juste après Festins secrets, sur lequel je reviendrai – et qu’il établit comme son préféré. Il faut toujours, à la fois, se fier et se mé-fier au/du choix des écrivains, dans leur bibliographie : parfois, ils sont aveuglés par la reconnaissance ou par le manque d’intérêt qu’on a consacré à leur travail, un temps, et les deux peuvent fausser le jugement. Pourtant, on comprend pourquoi « l’heure et l’ombre » lui tient à cœur, tant il comprend les thèmes sur lesquels toute son œuvre s’est fondée. Les récits enchâssés, la présentation d’un pays ou d’un arrière-pays (perdu), le lien qui se fait avec l’enfance et l’impression. L’histoire commence comme un mauvais roman, un road-movie improvisé avec une femme fugacement croisée dans des soirées mondaines. Jusqu’à St Savin. On sait trop, et heureusement, qu’on n’en restera pas là, avec Jourde et déjà, dans les deux récits qu’ils font l’un et l’autre – la narration change, il faut suivre les accords – de ce qu’ils ont vécu là-bas, en leur temps (elle y a été médecin de campagne, il y a des souvenirs d’enfance, et je pèse chacun des mots), on retrouve la vision de contrées dont on tait la façon de vivre – des gens censés exister mais qu’on ne voit plus – des ombres errantes, des secrets de famille ou de village. Dans l’histoire que Denise raconte, il y a des spectres, des légendes de disparition et de sacrifices. Ils arrivent au matin à destination, après s’être perdus une partie de la nuit, on pourrait s’attendre à une concrétisation amoureuse mais 1) c’est mal connaître l’auteur et 2) il ne pourrait y avoir de confiance ni d’abandon avec cette femme qui a ses propres mystères et qui n’est en somme qu’un épigone de celle qu’il y a laissée, des années auparavant, qu’il croit reconnaître, indirectement, par ce que Denise dit d’un homme mystérieux qui pourrait être – les histoires parallèles et le conditionnel déclenchent l’anamnèse du narrateur – le beau-père de Sylvie, cette petite fille qu’il a connue quand il avait 4 ans, qu’il a observée en se cachant dans la haie à 12 – à chaque fois, la même joie qu’une naissance, inépuisable – et à laquelle il s’est déclarée sans rien dire à 27, quand il l’a retrouvée, encore. Cette fois, il est accompagné d’un alter-ego – il aurait pu être moi – en plus héroïque, qu’il voit un temps à sa place auprès de Sylvie (comme Denise, gouvernée par la lune), avant qu’il se passe, entre eux, un pacte comme il ne s’en passe qu’entre des hommes qui savent qu’aimer une femme, c’est entrer vraiment dans son intimité – dans la maison, pas celle du fond – cesser de ressentir la souffrance de ne pas le faire. Entre Sylvie & lui, laissés libres, le modus vivendi, c’est de ne rien exprimer, ressentir le paradoxe (J’avais lu des descriptions détaillées de cet état dans Proust, mais oui, on a beau être un jeune médecin, on peut avoir lu Proust) de préférer ne pas vivre les choses plutôt que de les avoir dépassées. Quitte à imaginer supprimer la femme qu’il aime –des pulsions qu’il demande au lecteur d’assumer – tant la violence de (son) désir en rendait invraisemblable la réalisation. Le personnage-narrateur va jusqu’à la poursuivre à Tours, dans une rue dont il ne connaît pas le numéro, croire la retrouver, la perdre de nouveau. Jusqu’à des rebondissements dont aucun n’est superflu, ni mal construit, jusqu’au dernier, à la dernière énonciation, Deus ex machina Il y a du Jourde qu’on reconnaît, dans la description clinique des douches de camping, son amour (sic) des enfants, l’administration, quelques insertions – on ne se refait pas – sur la littérature, la poésie. On s’amuse à composer avec Julien – il m’a arrêté dans mes excuses sur cet abandon de quinze ans – comme le potentiel Jourde que Jourde aurait pu devenir, écrivain-ermite revenu de la littérature telle qu’on la conçoit – au mieux une survivance culturelle, une marque de standing – si les vies se définissaient comme la somme des choix qu’on n'a pas faits ou devant lesquels on s’est dérobé, par peur ou par paresse. Il y a récurrence, dans tout le roman, entre le monde réel et la manière dont on (les gens) se le représente(nt), les impressions qu’on en garde. Son double, celui qu’il a chargé de vivre à sa place, va jusqu’à dire au narrateur qu’il a perdu Sylvie – qui l’aimait – parce qu’il l’aimait comme une abstraction, trop amoureux de l’amour. C’est un livre sur la culpabilité de n’être que soi – jusqu’à l’unique solution qui consiste à n’être rien – sur le passé – un emboitement de fantasmagories – et sur la permanence, avec une fin qui laisse le lecteur exsangue, jusqu’à l’excipit.
Pierre Jourde fait trop souvent référence à « l’heure et l’ombre», un roman qu’il a publié en 2006 – juste après Festins secrets, sur lequel je reviendrai – et qu’il établit comme son préféré. Il faut toujours, à la fois, se fier et se mé-fier au/du choix des écrivains, dans leur bibliographie : parfois, ils sont aveuglés par la reconnaissance ou par le manque d’intérêt qu’on a consacré à leur travail, un temps, et les deux peuvent fausser le jugement. Pourtant, on comprend pourquoi « l’heure et l’ombre » lui tient à cœur, tant il comprend les thèmes sur lesquels toute son œuvre s’est fondée. Les récits enchâssés, la présentation d’un pays ou d’un arrière-pays (perdu), le lien qui se fait avec l’enfance et l’impression. L’histoire commence comme un mauvais roman, un road-movie improvisé avec une femme fugacement croisée dans des soirées mondaines. Jusqu’à St Savin. On sait trop, et heureusement, qu’on n’en restera pas là, avec Jourde et déjà, dans les deux récits qu’ils font l’un et l’autre – la narration change, il faut suivre les accords – de ce qu’ils ont vécu là-bas, en leur temps (elle y a été médecin de campagne, il y a des souvenirs d’enfance, et je pèse chacun des mots), on retrouve la vision de contrées dont on tait la façon de vivre – des gens censés exister mais qu’on ne voit plus – des ombres errantes, des secrets de famille ou de village. Dans l’histoire que Denise raconte, il y a des spectres, des légendes de disparition et de sacrifices. Ils arrivent au matin à destination, après s’être perdus une partie de la nuit, on pourrait s’attendre à une concrétisation amoureuse mais 1) c’est mal connaître l’auteur et 2) il ne pourrait y avoir de confiance ni d’abandon avec cette femme qui a ses propres mystères et qui n’est en somme qu’un épigone de celle qu’il y a laissée, des années auparavant, qu’il croit reconnaître, indirectement, par ce que Denise dit d’un homme mystérieux qui pourrait être – les histoires parallèles et le conditionnel déclenchent l’anamnèse du narrateur – le beau-père de Sylvie, cette petite fille qu’il a connue quand il avait 4 ans, qu’il a observée en se cachant dans la haie à 12 – à chaque fois, la même joie qu’une naissance, inépuisable – et à laquelle il s’est déclarée sans rien dire à 27, quand il l’a retrouvée, encore. Cette fois, il est accompagné d’un alter-ego – il aurait pu être moi – en plus héroïque, qu’il voit un temps à sa place auprès de Sylvie (comme Denise, gouvernée par la lune), avant qu’il se passe, entre eux, un pacte comme il ne s’en passe qu’entre des hommes qui savent qu’aimer une femme, c’est entrer vraiment dans son intimité – dans la maison, pas celle du fond – cesser de ressentir la souffrance de ne pas le faire. Entre Sylvie & lui, laissés libres, le modus vivendi, c’est de ne rien exprimer, ressentir le paradoxe (J’avais lu des descriptions détaillées de cet état dans Proust, mais oui, on a beau être un jeune médecin, on peut avoir lu Proust) de préférer ne pas vivre les choses plutôt que de les avoir dépassées. Quitte à imaginer supprimer la femme qu’il aime –des pulsions qu’il demande au lecteur d’assumer – tant la violence de (son) désir en rendait invraisemblable la réalisation. Le personnage-narrateur va jusqu’à la poursuivre à Tours, dans une rue dont il ne connaît pas le numéro, croire la retrouver, la perdre de nouveau. Jusqu’à des rebondissements dont aucun n’est superflu, ni mal construit, jusqu’au dernier, à la dernière énonciation, Deus ex machina Il y a du Jourde qu’on reconnaît, dans la description clinique des douches de camping, son amour (sic) des enfants, l’administration, quelques insertions – on ne se refait pas – sur la littérature, la poésie. On s’amuse à composer avec Julien – il m’a arrêté dans mes excuses sur cet abandon de quinze ans – comme le potentiel Jourde que Jourde aurait pu devenir, écrivain-ermite revenu de la littérature telle qu’on la conçoit – au mieux une survivance culturelle, une marque de standing – si les vies se définissaient comme la somme des choix qu’on n'a pas faits ou devant lesquels on s’est dérobé, par peur ou par paresse. Il y a récurrence, dans tout le roman, entre le monde réel et la manière dont on (les gens) se le représente(nt), les impressions qu’on en garde. Son double, celui qu’il a chargé de vivre à sa place, va jusqu’à dire au narrateur qu’il a perdu Sylvie – qui l’aimait – parce qu’il l’aimait comme une abstraction, trop amoureux de l’amour. C’est un livre sur la culpabilité de n’être que soi – jusqu’à l’unique solution qui consiste à n’être rien – sur le passé – un emboitement de fantasmagories – et sur la permanence, avec une fin qui laisse le lecteur exsangue, jusqu’à l’excipit.
Pierre Jourde, l’Heure & l’ombre, l’Esprit des Péninsules, 2006
20:29 Publié dans Blog | Lien permanent


















































Les commentaires sont fermés.