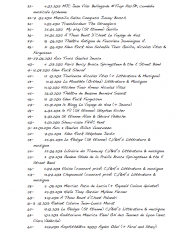01/12/2013
Les clés de la boîte à mails.
On est vite dépassé par les technologies censées nous faciliter la vie : au point même qu’en justice, on pense créer un poste de juge de peine des applications.
16:55 Publié dans Blog | Lien permanent
30/11/2013
Les heures pâles.
Ainsi donc, hier, me suis-je amusé, dans une parfaite mise en abyme du temps qui passe, à filmer l’horloge que j’ai récupérée de chez ma grand-mère paternelle. Cette horloge de chez Charvet, Lyon, qui tous les quarts d’heure, ceux de la nuit compris, rappelle l’esto memor et qui, à chaque heure fixe, sollicite Big Ben pour dire qu’une heure de plus vient de s’écouler. Rien de nouveau sous le soleil, aux mécanismes remontés de la réminiscence, mais l’impression étrange de devoir éprouver une mémoire quand toute la technologie récente nous abreuve. Les deuils seront-ils plus faciles à ceux qui n’auront pas d’effort à fournir pour se remémorer un visage, un lieu, une odeur ou une sonorité ou bien tout cela ne contribue-t-il qu’à l’illusion de la présence de l’autre ? Quels types de passage, de filiation, le monde moderne prépare-t-il ? Je garde la mémoire vive de ces moments-là, même si les tableaux s’estompent, peu à peu. Et je remonte l’horloge : elle s’était arrêtée, juste après.
14:31 Publié dans Blog | Lien permanent
29/11/2013
Mots doux sur le PAL.
 "J’ai passé une bonne partie de ma nuit en compagnie d’un type qui jouait pas mal au basket ball. Pour quelques instants, je ne suis qu’un type qui joue un peu de rock’n’roll. Je pense à certains de mes lancers qui n’ont pas atteint leur but. Un petit défilé de loupés qui font les voies royales. Normal."
"J’ai passé une bonne partie de ma nuit en compagnie d’un type qui jouait pas mal au basket ball. Pour quelques instants, je ne suis qu’un type qui joue un peu de rock’n’roll. Je pense à certains de mes lancers qui n’ont pas atteint leur but. Un petit défilé de loupés qui font les voies royales. Normal."
15:21 Publié dans Blog | Lien permanent
28/11/2013
Derrière le Mur.

15:16 Publié dans Blog | Lien permanent
27/11/2013
Une vie qu'on retrouve.
Je sais déjà que l’historien de l’inutile m’avait rappelé le concert des Inoxydables à la Boulang’, un jour de 1991, peut-être (je le laisse me retrouver la date), qui manquait à ma première liste, entamée à la main en 1985, dactylographiée ensuite, jusqu’à ce que j’arrête, je ne sais pour quelles raisons : la liste, l’inventaire, est un excellent exercice autobiographique, plus signifiant que des atermoiements nombrilistes. On émet une information, on ravive un souvenir chez celui qui la lit, dans le même temps, on se souvient de ceux qui nous accompagnaient ce soir-là, de la période de vie dont on pensait alors qu’elle durerait à jamais. Pour ne pas mourir rétroactivement en 2009, j’ai donc recherché, des tickets, des affiches, retrouvé des dates sur Internet. J’ai fouillé cette drôle de mémoire numérique qui fait qu’une photo, un bout de vidéo, un album sur l’ordinateur, tout cela ramène des indications très précises et fait que la mémoire, déjà, n’est plus tout à fait de la mémoire. Il n’empêche, j’ai dû en oublier pas mal, parce qu’il y a des trous conséquents, des mois passés sans concerts, ce qui m’arrive rarement, même si je ne suis pas un de ces acharnés – j’en connais – qui passent leur vie dans les salles, à voir les artistes tant qu’ils sont vivants. C’est justement parce qu’il me semble que j’y vais raisonnablement que ce chiffre de 283 concerts me paraît démentiel. On trouve de tout, comme à la Samaritaine, des toutes petites salles et des stades démesurés, des groupes inconnus, locaux, et des vedettes à paillettes. Beaucoup plus de chanson française que du reste, par contre. Il faut dire que tous ces mots en moi, je le leur dois pour quelques-uns d’entre eux, j’en donne à quelques autres. C’est une vie reconstituée, certainement pas – Dieu me tripote - la liste de mes envies.
17:28 Publié dans Blog | Lien permanent
26/11/2013
Cartésien.
Quand je grimpe les trois étages qui me ramènent chez moi, c’est toute ma vision du monde qui s’en trouve bouleversée : puisqu’il y a soixante-quatorze marches, qu’elles font chacun environ cinq centimètres de hauteur, ça fait trois cent soixante-dix centimètres d’élévation, mais d’un autre côté, si je regarde de là où je suis parti et là où je suis arrivé, il y a beaucoup plus de trois mètres soixante-dix de hauteur, pour moi qui en fait déjà un quatre-vingt quatre et demi ! Quelque chose m’échappe dans mes calculs, mais le temps que cette question m’obsède, je suis déjà arrivé au chaud, dans le confort de mon canapé rouge, lieu-dit de toutes mes paresses, y compris arithmétiques.
16:30 Publié dans Blog | Lien permanent
25/11/2013
Orange et marron.
J’apprends grâce à kronix que le Dalaï est contesté dans ses positions par ses héritiers réels (et pas métempsychiques), les deux Serge et Bernard, de Guyane.
18:23 Publié dans Blog | Lien permanent
24/11/2013
Garcinade.
L’autre jour, de mon exemplaire de « Huis-Clos » » ouvert au travail, ce billet d’absence qui tombe, daté de mars 1994. L’enfer, c'est pas les autres, c’est que j’y sois encore.
15:34 Publié dans Blog | Lien permanent