25/09/2015
La terrasse fleurie.
Ce soir, tard, je serai dans la chambre d’hôtel que Lettres-Frontière me réserve à chaque fois que je dois, le lendemain, animer l’atelier d’écriture que l’association a mis en place, en septembre dernier. Un an après, pourtant, je ne reviens pas pour travailler, mais pour découvrir, en même temps que ses auteurs, le livre (la nouvelle) sur lequel ils ont sué pendant un an, avec des moments de découragement, d’incompréhension, de mais-où-il-veut-en-venir-et-pourquoi-il-ne-nous-donne-pas-plus-d’indications. Je reviens pour inaugurer, donc, et j’aurai autant de plaisir qu’eux à découvrir la plaquette, à faire entrer Gabrielle dans la liste des personnages sur lesquels, à leur place, j’aurais écrit de la même façon. De là à dire que j’ai déterminé la tonalité et le contenu, il y a une marge, mais avant de commencer avec eux, je savais qu’il y avait trois issues possibles à un atelier d’écriture : l’échec complet, et le projet avorté, pour tout un tas de raisons ; la concession excessive, avec un patchwork d’écritures différentes qui ne satisfait, généralement, que celui qui l’a écrit, et encore, sur son seul passage ; et l’écriture collective, sur laquelle tout le monde a œuvré, jusqu’à ce qu’on en sorte l’essentiel : le mot juste et la musique qui va avec. Quand je regagnerai la mer, je saurai au moins que si tout n’est pas parfait dans ce qui a été écrit, personne n’a triché et le personnage existe, désormais, bel et bien.
14:33 Publié dans Blog | Lien permanent
24/09/2015
Les neiges d'antan.
C’était difficile de croire qu’on pût se réjouir d’être d’un monde d’avant, et pourtant…
19:21 Publié dans Blog | Lien permanent
23/09/2015
Historiette.
J’avais un premier axe dans cette soirée : Gaëlle - Charlotte - Adrian. De Easyexpat. Le fait que les cours – du moins ceux d’Adrian – venaient à peine de commencer ne m’avait pas échappé : il s’agissait d’un axe récent, une nouvelle garde. A moi qui représentais le passé, elle opposait des figures d’un présent absolu. Je ne fus pas surpris par la façon dont Adrian se sentit obligé de m’aborder. Ana était allée aider Charlotte et Julie à disposer les nappes sur la grande table du salon : il eût été inconvenant qu’il restât seul à cet instant. Son apprentie lui fit signe et il se présenta à moi, en anglais. Fut étonné par la spontanéité de ma réponse, signifiant d’un langage que nous aurions en commun. Se mit donc en devoir de me parler, vite et fort, me demandant si mon vol s’était bien passé, si j’avais pris un vol régulier, blah blah blah… Gaëlle nous ramena à la raison, rappela son maître à plus de pédagogie. Il s’y plia, mais c’était fait : en ce qui nous concernait, nous allions donner du sens, tout au long de la soirée, à la cordiale détestation franco-britannique.
Julie fut plus directe, encore. Libérée des tâches ménagères que lui confiait son hôte, elle vint me voir avec une autre coupe de champagne – celle d’avant m’ayant servi à trouver mes mots d’anglais sans donner une seule seconde l’impression d’une hésitation – fit clinquer son verre contre le mien et me dit, avec un immense sourire contredisant le perçant du regard :
- J’espère que tu n’es pas venu régler tes comptes.
17:54 Publié dans Blog | Lien permanent
22/09/2015
Le Boss, la Belle et l'impétrant.
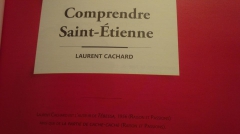 A St Etienne, où je suis attendu pour animer les rencontres des « Mots en scène », les 17&18 octobre, j’aurai quand même l’occasion de m’évader un instant, dès mon arrivée le vendredi en fin d’après-midi, pour participer à un événement réunissant, sur les trois jours, les auteurs édités par le Réalgar. L’information officielle suivra, mais je lirai, avant de rentrer, sagement, dans ma chambre d’hôtel pour consulter mes fiches une dernière fois, des extraits des deux livres d’Isabelle Flaten édités par le Boss de la Galerie. Et elle, en retour, lira des extraits de « Valse, Claudel », qui a ouvert le bal de cette belle collection, et un bout d’inédit qui, si tout se passe bien… Bref, ce sera bien, et ce sera un petit bout de ma vie d’auteur au milieu de mon travail d’interviewer. Qui n’est pas, du tout, pour me déplaire, loin de là.
A St Etienne, où je suis attendu pour animer les rencontres des « Mots en scène », les 17&18 octobre, j’aurai quand même l’occasion de m’évader un instant, dès mon arrivée le vendredi en fin d’après-midi, pour participer à un événement réunissant, sur les trois jours, les auteurs édités par le Réalgar. L’information officielle suivra, mais je lirai, avant de rentrer, sagement, dans ma chambre d’hôtel pour consulter mes fiches une dernière fois, des extraits des deux livres d’Isabelle Flaten édités par le Boss de la Galerie. Et elle, en retour, lira des extraits de « Valse, Claudel », qui a ouvert le bal de cette belle collection, et un bout d’inédit qui, si tout se passe bien… Bref, ce sera bien, et ce sera un petit bout de ma vie d’auteur au milieu de mon travail d’interviewer. Qui n’est pas, du tout, pour me déplaire, loin de là.
NB: en photo, le texte inédit écrit pour les 30 ans de la Fête du Livre.
19:51 Publié dans Blog | Lien permanent
21/09/2015
En reflection.
Il m'arrive régulièrement de me demander si j'ai été celui que je fus.
18:26 Publié dans Blog | Lien permanent
20/09/2015
Rien d'important.
Elle était belle, brillante, dans sa robe bigarrée, elle était amenée à des responsabilités nationales, mais il y avait cette faille qui se réveillait à chaque fois qu’elle se retournait sur sa vie, le chaos qu’avaient provoqué la séparation, la tristesse des enfants, l’échec d’un de ses idéaux, avec l’idée – et l’ambition – d’une vie meilleure pour tous. Il ne lui manquait qu’un homme à ses côtés, qui l’accompagne, la comprenne, saisisse, sans qu’elle en dise rien, ses moments de découragement, ceux, si rares, au cours desquels elle ne voulait être qu’une femme comme tout le monde. Comme n’importe quelle femme, disons. Mais plus que le trouver lui, il lui fallait trouver le temps de le chercher, de comprendre, en un rien de temps, si celui, en face d’elle, la prendrait pour ce qu’elle était réellement, pas publiquement. S’il l’écouterait parler de ses origines, de ses attaches et de tout ce qui lui semblait avoir à prouver sans la juger. Après, il y aurait le feeling, l’élection intime, celle des affinités. Elle en perdrait sans doute en route, avec qui elle aurait pu, mais qui… Tout ce qui ne se relève pas chez n’importe qui, qu’elle n’était pas. Après, un an, deux, plus peut-être, elle sourirait de savoir qu’un de ceux qu’elle avait éconduits, sans rien dire, vivait une part de l’existence qu’elle s’était un temps imaginée pour eux deux. Un moment de cette impalpable petite nostalgie perecquienne. Rien d’important.
18:37 Publié dans Blog | Lien permanent
19/09/2015
Newsletter.
Ma retraite est active: samedi, à Divonne-les-Bains, Lettres-Frontière présentera, en coédition avec Jean-Pierre Huguet (souvenez-vous, "le baiser de la nourrice"), la plaquette finale, résultat des ateliers d'écriture menés, conjointement, par Nicolas Couchepin à Monthey et moi-même à Divonne. Une double histoire, croisée, entre Gabrielle, à la frontière (c'est le titre) et Antonio, au même endroit. Ensuite, entre deux salons, à Mornant et à St Etienne, je pourrai tranquillement annoncer une édition qui me tient à cœur mais qui n'est pas celle dont je parle depuis (trop) longtemps. Par contre, elle sera celle, comme on range son bureau plusieurs fois avant de se mettre au travail, qui me mènera là où je veux aller.
18:13 Publié dans Blog | Lien permanent
18/09/2015
Jakobson.
On n'est jamais l'unique responsable des signes qu'on émet, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier d'en être l'émetteur singulier.
19:47 Publié dans Blog | Lien permanent
















































