16/04/2025
Girafe lymphatique - Épisode 1
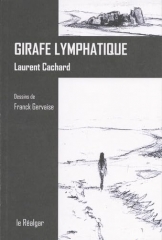 Clara Ville a perdu son père, de six à trente-six ans. Au moins, le calcul est clair. On ne lui a rien expliqué de l’absence qui s’est imposée un jour, pour ne pas ajouter du chagrin à l’incompréhension. À cet âge, on oublie vite. En rentrant de l’école, c’est son oncle, frère jumeau de son père, qu’elle a trouvé. Qui lui a dit qu’ils allaient prendre un goûter, qu’il fallait laisser Maman tranquille. Le piano n’était plus dans le salon ; dans sa mémoire, les traces laissées sur le mur font office de compte à rebours. Comme le parfum sucré de la brioche que son oncle lui a offerte, au Parc. Ces brioches aux pralines, elle n’en a plus jamais mangé ; les traces au mur, elle a consacré sa vie à les effacer. C’est tout cela, l’indicible, qu’il fallait retrouver, dans le portrait. Sous peine d’échec et d’effacement. Sans se laisser perturber par l’image d’elle adulte, alanguie sur un lit défait, longues jambes repliées sur elles-mêmes, plongée dans la lecture d’un roman de Richard Ford. Cette image s’effacera d’elle-même, comme les photos, le souvenir. Le portrait restera : c’est l’ambition du portraitiste.
Clara Ville a perdu son père, de six à trente-six ans. Au moins, le calcul est clair. On ne lui a rien expliqué de l’absence qui s’est imposée un jour, pour ne pas ajouter du chagrin à l’incompréhension. À cet âge, on oublie vite. En rentrant de l’école, c’est son oncle, frère jumeau de son père, qu’elle a trouvé. Qui lui a dit qu’ils allaient prendre un goûter, qu’il fallait laisser Maman tranquille. Le piano n’était plus dans le salon ; dans sa mémoire, les traces laissées sur le mur font office de compte à rebours. Comme le parfum sucré de la brioche que son oncle lui a offerte, au Parc. Ces brioches aux pralines, elle n’en a plus jamais mangé ; les traces au mur, elle a consacré sa vie à les effacer. C’est tout cela, l’indicible, qu’il fallait retrouver, dans le portrait. Sous peine d’échec et d’effacement. Sans se laisser perturber par l’image d’elle adulte, alanguie sur un lit défait, longues jambes repliées sur elles-mêmes, plongée dans la lecture d’un roman de Richard Ford. Cette image s’effacera d’elle-même, comme les photos, le souvenir. Le portrait restera : c’est l’ambition du portraitiste.
Et ce jour, à six ans, sans rien savoir des raisons de cette absence, Clara Ville se promet que son existence sera dédiée au père disparu. Chaque bulletin scolaire fixera cette excellence. Clara est une très bonne élève, ses appréciations combleraient n’importe quelle autre mère que la sienne, à la blessure inextin- guible. Elle la rejoint toutes les nuits dans son lit. Jusqu’à ce qu’elles s’endorment sans qu’on sache jamais qui de l’une consolait l’autre. Même si la femme qu’elle est devenue, la force qu’elle a développée, laissent à penser que c’est sans doute elle qui séchait les larmes de sa Maman. Lui disait de ne pas s’inquiéter, qu’elles le retrouveraient, qu’il reviendrait. Qu’il n’est jamais trop tard, que l’amour n’est pas perdu, qu’il sera intense, encore. Elle n’a pas les mots pour le dire, alors elle plonge sa main dans celle de sa mère, se serre contre elle, cherche sa cha- leur et triture sa chevelure au niveau de l’oreille gauche : un ri- tuel qu’elle gardera longtemps et que son fils adopetera des années après. Sa Maman pleure, des nuits durant. Pas elle, qui s’endurcit.
Jusqu’à quatorze ans, Clara Ville partagera le cérémonial du coucher. Quelques hommes vinrent à la maison pour un repas, deux parfois, puis plus rien, mais jamais sa mère ne dérogea à la règle. Dormir ensemble les maintenait dans une unité dont l’un s’était défait et ne s’en remettrait pas. Aujourd’hui elle trouve ça normal, évoquant la culture îlienne, sans se soucier de l’anachronisme. Le portraitiste, lui, voit derrière, là où se loge le vrai regard. Se doute qu’elle s’est forgée mère avant d’être fille ou femme. La couche qu’elle partage, c’est le lien du sang ; le plai- sir, elle le connaîtra dans ses perditions, puis dans ses convictions. Celui avec qui elle le partagera n’aura que deux issues, l’abandon ou la confiance, plus rare. L’homme devra être père, offrir la force de la fonction, du mythe qu’elle s’en est fait. C’est ce qu’elle a en tête à quatorze ans, qu’elle ne formule pas mais qu’elle retrouve dans le portrait qu’on a fait d’elle, vingt-cinq ans après. Trois ans après avoir retrouvé son père.
Il est dans la banlieue ni chic ni pauvre d’une grande ville qu’il n’avait pas choisie, qu’on fuit pour son ennui ou qu’on adore pour sa tranquillité. Il fallait oublier les petits arrange- ments d’une partie de la famille – la grand-mère, sulfureuse, fricotant avec le Gang des Lyonnais. Taire le choc des cultures pour ne pas sembler suffisant. Il préféra se fixer un cap inaccessible : le Clair de lune de Debussy, le programme d’une vie de pianiste, parce qu’il est verlainien et que le Nave va. Votre âme est un paysage choisi... Que n’a-t-on dit de ceux qui réalisent le rêve de tous les peintres, portrait et paysage mêlés ? L’état dans lequel nous plonge ce clair de lune, c’est l’impossibilité d’un choix, le triste et le beau mélangés, en mode mineur, l’amour vainqueur. Quel amour, au bout d’une vie, ailleurs, autrement ? La seule interrogation, à l’aube de sa soixantaine, après tant de saisons passées loin de ses proches, son jumeau, sa fille aînée, aimée, déniée, retrouvée. Par petites touches, impressionnisme andante très expressif, joué pianissimo. De quoi patienter toutes ces années sans se demander si son choix n’a pas été mauvais. Toute la tension liée à la vie d’un homme, la conscience de ses contraires. Qu’est-ce qui se joue, dans le troisième mouvement de la suite bergamasque, sinon un Ré b majeur propre à la nuit et aux eaux dormantes ? Le joue-t-il pour lui ou pour cette fille qu’il a eue avant son autre vie, ses autres enfants ? Un motif en tierces et huit mesures de l’aigu vers le grave, pour dépasser le regret et le souvenir, juste avant de fermer les yeux, une seconde, et se dire que pour le reste, c’est terminé ? Qu’on commet tous des erreurs, et que sa vie d’avant en fut une. Que d’autres aussi laissent des enfants, ne les ont pas, les font passer. Chacun vit en fonction d’une autre vie possible, dans l’incidence des choix. Et puis elle a eu son jumeau pour s’occuper d’elle : le même sang, les mêmes gènes, le même regard dans lequel elle le retrouvera, si elle s’en souvient encore. Ce n’est pas comme si elle l’avait totalement perdu.
Clara Ville grandit. Discrète, renfermée, elle rabroue d’un lent hochement de la tête et d’un regard noir, les garçons qui admirent ses longs cheveux. Elle semble dure, mais ne fait que se retrancher dans une citadelle que l’homme au piano lui a retirée. Elle avance, n’est pas dupe d’une famille qui n’est pas la sienne. Sa mère comble le vide de l’abandon par un excès de projets, des paroles enjouées, des cadeaux trop fréquents, qu’elle reçoit avec circonspection et mutisme. Si au moins elles savaient qu’un Clair de lune se travaille au loin pour elles deux, elles feraient corps et avanceraient. Chemineraient, mais mais pas comme on le dit désormais, dans un sabir qui ne tient pas compte de la portée du terme : puisque seul le chemin est diffi- cile, surtout dans l’intuition de devoir le rebrousser. Mais elle n’en est pas là, elle accumule les bons points en guettant le moment de les poser sur la table et de dire tu vois, c’est pour toi que j’ai fait ça. En solfège, elle est la première à mémoriser les notes- clés, reconnaît les rythmes avec noires et croches en 4/4, envi- sage l’harmonie. Note après note, elle entreprend de le recomposer, passe de l’impression à la mémoire, de l’amnésie au mythe. Dans le portrait, en filigrane, on craint pour elle la même histoire : ne quittera-t-elle pas, plus tard, une île, son en- fant sous le bras, pour lui épargner un père dont elle ne voulait pas pour lui ? Clara Ville ne sait rien encore de tout cela, elle mène son existence. On assure sa mère qu’elle a de la chance d’avoir une fille comme elle, qui ne se révolte contre rien, pas comme celles qui ont eu plus de chance mais ne s’en rendent pas compte. Elle rend à chaque fois un sourire gêné, comme une révérence. Que savent-ils, tous ceux-là, des heures passées à pleurer, à se demander pourquoi elle n’a pas de Papa qui vient la chercher à l’école, l’emmène au parc, pourquoi ses copines se taisent quand elle arrive, plus attentives à celle qui l’a vraiment perdu, dans un accident ? Elle se dit qu’il est mort, dans des circonstances inconnues, mais la part qu’elle a gardée du disparu et sa mère la convainquent qu’il n’en est rien. Qu’il est parti. Elle l’imagine marin, à l’autre bout du monde. Déteste les explications de texte, à l’école, ces amoureuses larmoyantes qui s’étaient forgé exprès cent sujets légitimes d’un départ si précipité. Alors elle opte pour les sciences, la rationalité. Le végétal, ensuite. Pour sa nécessité et son silence.
Dans la banlieue calme, la vie se reconstruit. La mère fait son deuil, se raisonne, comme dans toutes les histoires d’amour : pour éviter de souffrir, on ressasse les mots jusqu’à la nausée. Elle se dit qu’ils étaient trop jeunes et pas faits l’un pour l’autre. Puisque ces choses sont, c’est qu’il faut qu’elles soient. On passe des larmes aux émotions, les sentiments s’estompent : ce n’était pas de l’amour, mais de l’emprise. Quelqu’un d’autre approche, et le manège reprend. Dans une petite musique mélancolique. Clara le sent, exprime ses premières hostilités : elle pensait l’accord tacite : attendre l’Homme, toutes les deux. Celui qui s’approche n’en est pas digne. Elle est en colère, pour la première fois centrée sur un seul être, qu’elle n’a jamais su détester. Prend conscience de ce que la vie réserve, des rapaces qui proposent le plein quand le vide se profile, en accélèrent la perception, et rendent l’histoire irréversible. L’autre devient la solution, et si ce n’est pas vrai, il y a toujours moyen de s’en convaincre, en sollicitant tout ce qui n’allait pas. Le sentiment devient l’emprise, les débuts une illusion, la fin une vérité. Peu importe que le temps du deuil soit déterminé par autre chose que le recueillement ou la solitude. Les rapaces sont doués, pour distiller des possibles lorsqu’il est temps, et vaincre l’hésitation à se dire que c’est encore jouable, puisque le vide peut s’incarner. Qui dit la perte, les abandons, la voix qui serre le cœur quand on ne l’entend plus. Clara ne veut pas que les choses changent. La mère est précautionneuse, mais certains samedis, quand elle l’emmène dormir chez son oncle et sa tante, elle voit bien qu’elle est inhabituellement apprêtée et par- fumée. À quatorze ans, sa fille s’est préservée de toute atteinte extérieure : elle a déjà embrassé mais toujours éconduit. C’est elle qui éconduira, dans sa vie, qui sera l’instigatrice des projets, des voyages, des décisions. Des avenirs qu’on dessine, lira-t-on dans le portrait. Elle n’est pas prête à passer à l’acte, mais l’idée que sa mère s’y adonne la dégoûte : il n’y a pire trahison que d’embrasser un autre que celui qu’on aime. Elle est ainsi, ne transige avec aucun principe, pas même ceux qu’elle ne connaît pas encore. Ses cousines lui parlent comme à une sœur d’adoption. Elles disent des garçons que c’est la vie, avec un fatalisme inédit pour leur jeune âge, utilisent des mots comme beau-père que Clara prend pour un pléonasme : un père peut-il être autre que beau ? Plus beau que le sien ? Ces soirs-là, elle donne le change, fait l’habituée. Mais les lumières éteintes, elle triture nerveusement son oreiller, y enfouit la tête, laisse une fois de plus ses larmes couler, sans bruit.
Elle a toujours jugé ça dérisoire parce que son père l’aurait jugé ainsi. Mais ce 14 février, Clara Ville ne l’oubliera jamais. Elle est en première, élève brillante dans un lycée en déshérence. Elle se fait une place, ne dit rien, ne juge jamais, se fait respecter par sa seule présence. Son indolence est sa marque de fabrique, développée par mimétisme avec la vie – imaginée – de son père. Elle fume ses premiers joints, vénère l’apathie qui en découle. Tout se passe autour de ça, les fins d’après-midi, les rendez-vous au café, les premiers copains. Celui qui lui a fait l'amour, qu’elle a laissé faire, sans même qu’elle puisse dire si c’était bien ou pas. Cette vie enfumée ne la mène nulle part, mais c’est ce qu’elle cherche : elle tient son cap et sa promesse, excelle dans ce qu’elle fait, le reste ne regarde personne, pas même celui qui l’a possédée et croit la connaître mieux. Elle le quitte le lendemain, sans états d’âme, le privant de son fait d’arme. Parce qu’elle imagine son père ressentir dans sa chair l’étape que ce jeune homme lui a fait passer. Qu’elle refuse : il faut que l’homme de l’île la retrouve telle qu’il l’a lais- sée, ne se retourne pas sur un temps détruit. Que tout soit à sa place. C’est pour cela que ce 14 février, elle n’a pas supporté l’infidélité de sa mère, la nuit passée avec un homme venu le supplanter. Pour clore, comme si ce fût possible. Plus que pour sa propre pénétration, dans la fumette et la maladresse, elle s’est sentie salie. Devinait les étapes à venir, sa mère qui lui parlerait d’un homme gentil, attentionné. Elle y a droit, il faut qu’elle la comprenne... Elle n’opposerait que son mutisme. Rien n’est jamais linéaire, dans une vie. Ce soir-là aurait dû être un soir comme un autre – dans sa famille d’adoption, entre les bou- chées avalées sous les reproches inquiets de sa tante et les histoires de ses cousines qui la confortaient dans la certitude d’être différente – mais ce fut un soir qui l’ancra dans un après dont elle ne voulait pas. Qui signa l’arrêt des nuits passées ensemble, à attendre quelqu’un qui ne reviendrait jamais. À dix- sept ans, Clara Ville vivait la pleine conscience d’une notion qu’elle avait toujours déniée : l’éternité. Toute une vie sans le revoir, à cause de cette putain de Saint-Valentin.
Sur son île, l’homme au piano s’est taillé sa réputation. Au Conservatoire, les élèves disent qu’il faut passer par lui mais que ça va être dur. Exigeant, il assène ses convictions avec brutalité : on ne l’aime pas, on le craint. Ça lui va bien, persuadé qu’il n’y a qu’une voie pour lui. Prendre une décision et s’y tenir. À chaque étape de sa nouvelle vie, il se convainc avec du- reté qu’il fallait tout laisser derrière. Bien sûr, elle revenait de façon lancinante, la prunelle de ses yeux, grands, en amande, son regard confiant et stupéfait, qu’il n’oubliera qu’en réussissant sa nouvelle vie. Il n’est pas naïf : on ne refait pas sa vie, on continue seulement – une des rares chansons qu’il a accepté de jouer, lui qui trouve le genre prétentieux et sa musique médiocre. Il trouve médiocre tout ce qui n’excelle pas, c’est sa règle. Aux étudiants, il répète l’aphorisme de Cioran : Si quelqu’un doit tout à Bach, c’est Dieu. Une rédemption, l’idée qu’il ne vivra bien qu’en réussissant au centuple ce qu’il vient de rater. Il a trouvé quelqu’un avec qui partager son quotidien, une femme de tête, qui s’affiche dans la vie – son expression fétiche. Il ne sait pas encore qu’à dix mille kilomètres, une jeune femme pense la même chose, tranche, décide, parfois brutalement, sans tergiverser. Le manque s’est tellement incarné qu’elle ne peut pas en imaginer de plus importants. Lui vit dans son endroit écarté mais se défait de la fatalité : au quotidien, il se nourrit de la direction qu’il a prise. Évite de se dire que rien n’est jamais trop tard. Ne revisite pas sa vie, l’accepte comme une erreur de jeunesse, se persuade que les abandonner était mieux pour elles : il l’a fait parce qu’il fallait le faire. Les dommages sont collatéraux, il ne mise même pas sur le pardon, la compréhension de l’une ou de l’autre. Il s’est effacé de leurs vies, a priori, ça devrait suffire. Elles le perdent, il renonce à elles, la souffrance est équivalente, on passe à autre chose. Il a lu que le seul patronyme de Bach peut être figuré, en numérologie, de la façon suivante : 2=B, 1=A, 3=C, 8=H. Soit le total de 14, le chiffre de la Sainte Trinité, des entrées thématiques de la Fugue en Sol majeur BWV 541, ou de la Fugue n°11 du Clavier bien tempéré ? Données ésotériques qui lui font se souvenir que sa fille a le prénom de celles qui portent la bonne étoile. Qui s’imposent par la distance qu’elles mettent entre elles et les autres. S’échappent de la famille si elle est hostile, ou se replient dans le mutisme. On se convainc de tout, mon ange, ça n’est pas ma faute, il connaît le refrain, les connaît tous, et les accompagne, sans rien cacher de son courroux – une chanson est in- utile quand on vise au sublime – ni de son impatience que tout cela soit enfin derrière lui. Il n’est jamais question d’une petite fille malheureuse, mais d’un malentendu plus important que les autres. Les fausses routes sont partagées, les responsabilités d’un échec aussi. Sur son clavier, quand le doute le saisit, il décortique le morceau dans toutes ses strates, pour en éviter une lecture simpliste. Comme dans la vie qu’il a laissée, là-bas. Tout s’explique, dit-il. Le reste s’oublie.
Sur le continent, les choses changent. Clara Ville a désormais une autre trace indélébile sur laquelle fixer sa vie. Sa mère et elle n’ont jamais parlé de ce 14 février. Et d’autres Saint-Valentin – et leur cortège de cadeaux mielleux – sont venues installer un homme dans leur vie, le signe pour elle qu’il est temps d’en changer. Elle a obtenu son baccalauréat avec la mention pro- mise à son père, secrètement. Elle envisage des études ailleurs. Son oncle évoque l’absent, la difficulté qu’il a eue de se trouver lui-même, son enfermement dans la musique. Elle s’essaie au saxophone, ils jouent en famille. Sa mère ne dit rien, c’est la partie réservée, qui lui échappe. Elle sait que sa fille va partir aussi, que tout finit par se tarir, elle s’habitue à l’homme qu’elle a laissé entrer dans sa vie : il est attentif, attachant, comme promis. Elle ne l’aimera pas comme elle a aimé son bel homme mais il fera un bon compagnon. Elle ne sait rien encore de ses accès de colère et de boisson, justement parce qu’il ne sera jamais le grand amour, juste le plus long. Il lui parle d’un enfant, une part d’eux seuls, exclusive, elle rechigne, après tant d’années, concède, se dit que son corps refusera de lui-même, mais non, un matin, elle ressent des picotements ressurgis du néant : vingt ans après, au moment où le lien d’avec sa vie d’avant prépare ses bagages, elle ancre la nouvelle dans une réalité palpable, irréversible. Valentin aura bien fait les choses.
Clara apprend ça avec indifférence. Elle feint de se réjouir pour sa mère : elles savent toutes les deux la part de fatalisme dans cet événement. Elle-même ne le peut pas ; s’attacher à cette petite sœur, ce serait créer de l’obligation là où elle tend à s’en défaire. À la Fac, il y a cet escogriffe un peu lunaire, qui ne s’émeut pas de ses absences, ces moments où elle disparaît de la. conversation. Ils sont à l’heure des choix, dont elle seule connaît les incidences. Ils visent l’INRA, en Avignon. Ils ont l’enthousiasme juvénile, se voient tous ensemble pour la vie et là encore, seule Clara sait que les choses ne se passent pas comme ça. Elle n’en dit rien, mais dans ses échappées, regarde parfois tel ami comme si c’était la dernière fois. Recolle à la réa- lité dans un frisson, consciente. La petite sœur, elle ne la connaîtra pas, ou peu ; l’écart est important, le temps s’est écoulé depuis que l’homme au piano... Elle a vécu sans père et ne peut contempler le spectacle d’une famille surjouant son bonheur. Privée de son enfance, elle ne se laissera pas voler sa vie de femme. Ce qu’elle ressent pour Ben n’est que les prémices. Elle sonde la confiance qu’elle peut lui porter, le pro- jette comme père de ses enfants, se demande s’il pourrait, lui aussi, tout abandonner parce que sa vie n’est pas satisfaisante. Il y a trop d’artifices dans leur vie d’étudiants : le groupe, les soirées, les bières et les joints, tout cela ne durera qu’un temps et celui qui ne le comprend pas se sentira bien seul, le moment venu. C’est la théorie des bulles, éprouvée dans les amphi- théâtres. Quand les étudiants arrivent excités et grégaires, ils mettent du temps pour rentrer dans l’épreuve, se cherchent du regard, sourient, grimacent, jusqu’à rentrer, enfin, dans la bulle nécessaire à la concentration. Le dernier qui s’y met éprouve de façon cuisante la sensation de solitude et d’échec. Dans sa bulle, Clara Ville y est en permanence mais jamais le sort ne l’a désig- née comme la grande perdante. Ben aime la force qu’elle dé- gage de son grand corps malhabile. Il éprouve quelque chose de particulier en sa compagnie, mélange de fierté et de crainte. Il appelle ça l’amour, attend d’en être sûr avant de lui en parler.
C’est sa façon de procéder, pas à pas. Il ne sait pas encore que les bulles de temps de Clara Ville – celles qui la feront passer d’un lieu à l’autre et d’une histoire à sa fin – sont belles et longues, mais soumises à un seuil de tolérance qu’elle seule saurait définir.
Des enfants sont nés aussi, sur l’île. Deux frères que Clara Ville ne connaît pas. Ils font la fierté de leur père, qui les voit grandir, dehors, surfer, de plus en plus loin. Il connaît les dan- gers mais ne retient pas leurs élans : ils sont la preuve qu’en choisissant d’être libre, on parvient au moins aux trois quarts de son existence. Est-il heureux ? Sans doute pas. Il faudrait re- visiter tout ce qui l’a conduit là et il ne se sent pas prêt. Pas en- core. Il a confié sa fille à l’autre lui-même, qui la choie comme il l’aurait fait si elle n’avait pas incarné, en naissant, l’échec d’une vie à venir. Il faut contenir les émotions dans un seul Clair de Lune. Il échange avec son frère de temps à autre. Leur cor- respondance est codée : quand l’un écrit qu’à la maison, tout se passe bien, l’autre se dit que la même lune brille pour tout le monde et qu’il n’a pas à s’en vouloir. Jamais son frère ne le culpabilise ni ne le somme de revenir. Parfois, l’homme au piano se demande si son frère n’a pas eu, avec sa fille, l’enfant qu’il aurait voulu avoir. Et comme à son habitude, chasse ses pensées, sort respirer l’air marin, essaie de voir si ses fils sont en- core à l’eau puis rentre travailler ses arpèges. Sa femme tente de l'extirper de ses partitions, elle est spontanée, voudrait voyager, danser, il est casanier, taiseux et déteste la médiocité ambiante. Il lui a donné ce qu’elle voulait, une vie de famille, une maison, une douceur de vivre, elle ne peut rien lui reprocher. Elle a tenté de le faire parler de son passé, mais a vite compris qu’elle maniait de la nitroglycérine, qu’il ne faudrait pas y revenir, jamais. Elle a pris l’habitude de partir seule en métropole, de le laisser sur l’île, chercher la note absolue, côtoyer le divin et s’en vouloir de son outrecuidance. À quarante ans, ses assurances ne sont plus aussi fortes, il se doute qu’un jour, il n’échappera pas à la confrontation. Qu’il aura en face de lui une femme qui lui rappellera celle qu’il a aimée. Il le sait, mais peut, encore, choisir que ce jour n’arrive jamais, à force de le retarder. Par lâcheté ou précaution.
Girafe Lymphatique, le Réalgar, 2018
21:15 | Lien permanent


















































Les commentaires sont fermés.