19/05/2025
FIGURES SINGULIÈRES - L'EXPOSITION
 Il s'en est passé, du temps, depuis que - pour mes 35 ans - je me suis risqué à une invitation en forme de Libé avec, en dernière, un portrait de moi au même âge par mon inséparable Esther Rochant. Pas tendre, selon les lecteurs de l'époque... Depuis, j'ai érigé ce mode d'écriture en façon de vivre et pour mes 55, Jean-Renaud Cuaz, que je venais de rencontrer, m'a proposé de tous les rassembler : les variations (de nombre de signes, d'encadrés etc.), il en ferait son affaire. Qui s'est mal terminée, parce qu'une phrase d'un des 112 Portraits de mémoire a été mal comprise par son bénéficiaire. À l'époque, je mettais les portraiturés en face du fait accompli, pour des anniversaires, souvent, ou des occasions spéciales, ça ne m'a jamais valu d'ennuis. J'ai payé cher cet écart, que je ne reconnais (toujours) pas. D'autres, à la lecture du portrait, m'ont dit qu'il avait dû être ravi d'être aussi bien croqué... Dont acte. Je sais gré à Jean-Renaud de m'avoir immédiatement proposé, après, de m'occuper de Portraits de Sétois vivants, lui qui croquent les illustres aînés dans ses Trombinoscopes. J'ai évidemment procédé autrement, suis allé à la rencontre, très vite, de personnes que je ne connaissais pas et qui méritaient qu'on parle d'elles. J'ai évité - tant que possible - les inévitables, puisqu'ils étaient croqués ailleurs, un peu partout. Petit à petit, le phénomène d’entrainement aidant, j’ai osé solliciter des gens qui se sont montrés surpris, la plupart du temps, qu’on s’intéresse à eux, qu’on en fasse des personnages à part entière, racontés par un narrateur, qui restitue ce que le portraituré lui dit en même temps que ce qu’il perçoit de lui quand il le rencontre. De fil en aiguille, ça a fait deux volumes, 52 portraits - longs, distanciés - auxquels j’ai ajouté 8 du volume 3 à venir (janvier 2026) pour répondre à la belle proposition de la Médiathèque (Mitterrand) d’en exposer des extraits, joliment mis en panneaux, par paires, par JRC et l’An Demain. Cette somme, au final, s’apparentera à une contre-histoire, une contre-sociologie de la ville de Sète, qu’il m’a été donné de découvrir et à laquelle je rends un peu de la confiance qu’elle m’a conférée. Sans qu’on se prenne trop au sérieux : ici, Neptune n’aime pas ça, on le sait. Le 14 juin, à 18h, c’est le vernissage, Eddie Morano, que la démarche a intrigué, m’a fait l’amitié de croquer à son tour tous les portraiturés, pour compléter l’exposition. D’ici ou d’ailleurs, que vous en soyez ou pas - peut-être dans la centaine de noms qui complète l’index, à chaque fois? - c’est une démarche littéraire à saluer pour ce qu’elle a de manifeste. Et un mode que je continue d’adopter, même dans d’autres domaines : à la fin de cette semaine, je ferai une annonce qui prendra son visage.
Il s'en est passé, du temps, depuis que - pour mes 35 ans - je me suis risqué à une invitation en forme de Libé avec, en dernière, un portrait de moi au même âge par mon inséparable Esther Rochant. Pas tendre, selon les lecteurs de l'époque... Depuis, j'ai érigé ce mode d'écriture en façon de vivre et pour mes 55, Jean-Renaud Cuaz, que je venais de rencontrer, m'a proposé de tous les rassembler : les variations (de nombre de signes, d'encadrés etc.), il en ferait son affaire. Qui s'est mal terminée, parce qu'une phrase d'un des 112 Portraits de mémoire a été mal comprise par son bénéficiaire. À l'époque, je mettais les portraiturés en face du fait accompli, pour des anniversaires, souvent, ou des occasions spéciales, ça ne m'a jamais valu d'ennuis. J'ai payé cher cet écart, que je ne reconnais (toujours) pas. D'autres, à la lecture du portrait, m'ont dit qu'il avait dû être ravi d'être aussi bien croqué... Dont acte. Je sais gré à Jean-Renaud de m'avoir immédiatement proposé, après, de m'occuper de Portraits de Sétois vivants, lui qui croquent les illustres aînés dans ses Trombinoscopes. J'ai évidemment procédé autrement, suis allé à la rencontre, très vite, de personnes que je ne connaissais pas et qui méritaient qu'on parle d'elles. J'ai évité - tant que possible - les inévitables, puisqu'ils étaient croqués ailleurs, un peu partout. Petit à petit, le phénomène d’entrainement aidant, j’ai osé solliciter des gens qui se sont montrés surpris, la plupart du temps, qu’on s’intéresse à eux, qu’on en fasse des personnages à part entière, racontés par un narrateur, qui restitue ce que le portraituré lui dit en même temps que ce qu’il perçoit de lui quand il le rencontre. De fil en aiguille, ça a fait deux volumes, 52 portraits - longs, distanciés - auxquels j’ai ajouté 8 du volume 3 à venir (janvier 2026) pour répondre à la belle proposition de la Médiathèque (Mitterrand) d’en exposer des extraits, joliment mis en panneaux, par paires, par JRC et l’An Demain. Cette somme, au final, s’apparentera à une contre-histoire, une contre-sociologie de la ville de Sète, qu’il m’a été donné de découvrir et à laquelle je rends un peu de la confiance qu’elle m’a conférée. Sans qu’on se prenne trop au sérieux : ici, Neptune n’aime pas ça, on le sait. Le 14 juin, à 18h, c’est le vernissage, Eddie Morano, que la démarche a intrigué, m’a fait l’amitié de croquer à son tour tous les portraiturés, pour compléter l’exposition. D’ici ou d’ailleurs, que vous en soyez ou pas - peut-être dans la centaine de noms qui complète l’index, à chaque fois? - c’est une démarche littéraire à saluer pour ce qu’elle a de manifeste. Et un mode que je continue d’adopter, même dans d’autres domaines : à la fin de cette semaine, je ferai une annonce qui prendra son visage.
Des liens critiques :
https://dis-leur.fr/portraits-singulieres-figures-singulieres-de-laurent-cachard/
12:52 Publié dans Blog | Lien permanent
29/04/2025
FAUSTO.
23:30 Publié dans Blog | Lien permanent
07/04/2025
Odessa, en mémoire.
 Ça doit être ça, la vie qui passe par derrière, dirait Sartre – tiens, j’ai une amie qui revendique d’être contemporaine de Sartre, même s’ils n’ont passé qu’une année et demie sur la même terre ! À chaque fois que je revois passer cette photo, je sais que c’est la plus belle que j’aurai jamais prise, pour ce qu’elle désigne. Cette cour intérieure anodine, c’est celle d’un immeuble dont l’adresse indiquait, dans le guide qui m’accompagnait à Odessa, en novembre 2014, le musée de l’histoire juive de la ville. Odessa, fondée en 1794 par Catherine II, Impératrice de Russie, a attiré de nombreux Juifs de l'Empire en quête de sécurité, de liberté et de dynamisme économique. Une société cosmopolite et tolérante – à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs représentent un tiers de la population multiethnique d’Odessa, qui compte environ 600 000 habitants - que développèrent des banquiers, des intellectuels, des artistes et des "anonymes", créant un mythe de l'âge d'or dans l'imaginaire juif avant les exils et les massacres de masse du XXe siècle et une communauté juive odessite décimée aux trois quarts durant la Seconde Guerre mondiale. C’est pourtant dans cette impasse – au contraire du centre rutilant de Dniepropetrovsk – que j’ai trouvé un petit musée, dans un appartement du rez-de-chaussée. Fermé ce jour-là, jusqu’à son propriétaire, me voyant devant la porte, décide de m’ouvrir et, devant l’objet de ma venue (l’exil de mes deux familles qui quittent les pogroms du début du siècle dernier), me fasse visiter, dans un anglais parfait, la collection sublime et émouvante, jusque dans des petites cuillères retrouvées, qu’il tenait à la disposition de tous ceux pour qui la mémoire n’est pas un vain mot. Il n’est sans doute plus de ce monde, ce monsieur : qu’il sache pourtant que depuis 6 ans, maintenant, Aurelia Kreit est à disposition de ceux qui ont encore de la curiosité en réserve. Elle m’accompagne depuis des décennies, maintenant, et quand je ne serai plus là, à mon tour, c’est elle qui prendra le relais et ramènera à la surface d’un temps qui va trop vite, l’image et le souvenir d’un musée inoubliable.
Ça doit être ça, la vie qui passe par derrière, dirait Sartre – tiens, j’ai une amie qui revendique d’être contemporaine de Sartre, même s’ils n’ont passé qu’une année et demie sur la même terre ! À chaque fois que je revois passer cette photo, je sais que c’est la plus belle que j’aurai jamais prise, pour ce qu’elle désigne. Cette cour intérieure anodine, c’est celle d’un immeuble dont l’adresse indiquait, dans le guide qui m’accompagnait à Odessa, en novembre 2014, le musée de l’histoire juive de la ville. Odessa, fondée en 1794 par Catherine II, Impératrice de Russie, a attiré de nombreux Juifs de l'Empire en quête de sécurité, de liberté et de dynamisme économique. Une société cosmopolite et tolérante – à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs représentent un tiers de la population multiethnique d’Odessa, qui compte environ 600 000 habitants - que développèrent des banquiers, des intellectuels, des artistes et des "anonymes", créant un mythe de l'âge d'or dans l'imaginaire juif avant les exils et les massacres de masse du XXe siècle et une communauté juive odessite décimée aux trois quarts durant la Seconde Guerre mondiale. C’est pourtant dans cette impasse – au contraire du centre rutilant de Dniepropetrovsk – que j’ai trouvé un petit musée, dans un appartement du rez-de-chaussée. Fermé ce jour-là, jusqu’à son propriétaire, me voyant devant la porte, décide de m’ouvrir et, devant l’objet de ma venue (l’exil de mes deux familles qui quittent les pogroms du début du siècle dernier), me fasse visiter, dans un anglais parfait, la collection sublime et émouvante, jusque dans des petites cuillères retrouvées, qu’il tenait à la disposition de tous ceux pour qui la mémoire n’est pas un vain mot. Il n’est sans doute plus de ce monde, ce monsieur : qu’il sache pourtant que depuis 6 ans, maintenant, Aurelia Kreit est à disposition de ceux qui ont encore de la curiosité en réserve. Elle m’accompagne depuis des décennies, maintenant, et quand je ne serai plus là, à mon tour, c’est elle qui prendra le relais et ramènera à la surface d’un temps qui va trop vite, l’image et le souvenir d’un musée inoubliable.
17:35 Publié dans Blog | Lien permanent
31/03/2025
CÉPHALÉES II*

On est le 31 de ce mois. Par provocation, comme Pierre Desproges a mangé un crabe le jour où on lui a appris qu’il avait un cancer (« un partout ! »), je pourrais manger autant de Mars qu’on en compte ce jour, mais je préfère me dire que j’en ai offert 30 à ma sœur hier, pour ses 60 ans, que je n’envisageais pas, il y a deux années pile. Ils sont arrivés après quatre jours de joie pure et d’amour fou, comme les autres échéances viendront, maintenant : je n’ai (plus) peur de rien. Comment il disait, Blier, déjà ? Ah, oui : merci la vie.
*En référence au très bon Céphalées de Nicolas Vitas, chroniqué ici.
14:09 Publié dans Blog | Lien permanent
24/03/2025
Les perdantes irrémédiables.
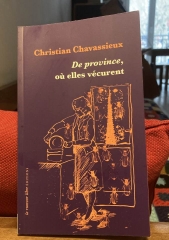 Le recueil de nouvelles de Christian Chavassieux (de Province, où elles vécurent, la Rumeur libre) se construit sur une boucle, puisque le prologue le dédie à Xavier, immense lecteur, et que la dernière nouvelle est consacrée au récit de son suicide, des répliques qu’il a entrainées auprès de ses amis, dont l’auteur et sa douce, à qui il consacre la plus longue – près de la moitié de l’ouvrage – des récits, sous le titre Mado & Léo. Qu’il ait changé les prénoms, ici et là, n’y change rien, lui-même prévenant dès l’entame : Je vais donc nous livrer tous, nous livrer car écrire est un acte de trahison. Dans les inconsolables, l’histoire qu’il consacre à sa compagne, il y a d’abord cette mythologie des hirondelles et de la buanderie qu’elle laisse ouverte pour elles, honorée de leur fidélité, puis le peuple des chats du haut (et par conséquent celui du bas), la perte parentale, la phobie des autres et de la voiture, l’amour inconditionnel qu’elle partage en silence avec son écrivain, dans le dénuement – le luxe de ceux qui ont renoncé à l’aisance pour savourer le temps – les confessions au psychiatre, l’effroi devant l’avenir politique qui s’annonce. La ouate et l’autarcie salvatrices, la violence du dehors. La fin de vie, là aussi, la démence de la mère, l’abandon du père – pas de médecin, pas d’hôpital, pas d’urgences, ça ira comme ça- la querelle de qui des deux partira le premier, quand ce sera leur tour.
Le recueil de nouvelles de Christian Chavassieux (de Province, où elles vécurent, la Rumeur libre) se construit sur une boucle, puisque le prologue le dédie à Xavier, immense lecteur, et que la dernière nouvelle est consacrée au récit de son suicide, des répliques qu’il a entrainées auprès de ses amis, dont l’auteur et sa douce, à qui il consacre la plus longue – près de la moitié de l’ouvrage – des récits, sous le titre Mado & Léo. Qu’il ait changé les prénoms, ici et là, n’y change rien, lui-même prévenant dès l’entame : Je vais donc nous livrer tous, nous livrer car écrire est un acte de trahison. Dans les inconsolables, l’histoire qu’il consacre à sa compagne, il y a d’abord cette mythologie des hirondelles et de la buanderie qu’elle laisse ouverte pour elles, honorée de leur fidélité, puis le peuple des chats du haut (et par conséquent celui du bas), la perte parentale, la phobie des autres et de la voiture, l’amour inconditionnel qu’elle partage en silence avec son écrivain, dans le dénuement – le luxe de ceux qui ont renoncé à l’aisance pour savourer le temps – les confessions au psychiatre, l’effroi devant l’avenir politique qui s’annonce. La ouate et l’autarcie salvatrices, la violence du dehors. La fin de vie, là aussi, la démence de la mère, l’abandon du père – pas de médecin, pas d’hôpital, pas d’urgences, ça ira comme ça- la querelle de qui des deux partira le premier, quand ce sera leur tour.
De Province est une somme de 15 nouvelles, certaines très courtes (une page, une page et demie) et d’autres plus conséquentes, dans la durée, jamais dans le sujet : les histoires qui me touchent, écrit-il, sont celles de perdantes. De perdantes irrémédiables. Toutes situées entre deux siècles, sans que rien n’ait vraiment changé, ni chez elles, ni dans le monde dans lequel elles évoluent. Qu’elles subissent, davantage. On y trouve des histoires de deuil, de fin de vie à l’EPHAD, de disparues dont on salit la mémoire en s’en moquant encore, de chômage, d’emplois aidés (vos TUCS, c’est du toc !), d’avortements répétés, d’enfants élevés dans la haine de leur mère, d’une terrible désillusion quand on croit voir un visage aimé tant attendu… Chavassieux avait averti, là aussi : enfant, il jugeait les femmes supérieures aux personnages masculins, avant de se rendre compte que la réalité était autre, et qu’elles pouvaient être absolument décevantes, comme eux. La désillusion (encore) est supérieure à l’idéalisation, et c’est là-dessus qu’il construit, d’une petite voix intérieure, l’énoncé de l’ensemble des non-dits qui construisent les relations humaines, celle d’une sœur qui refuse à la sienne de partager le deuil de leur mère, d’une directrice de prison qui refuse à des détenues de voir le fruit de leur travail artistique (sauf en payant), d’une femme – un corps brut de femelle sèche, millénaire, en T-shirt et poignets de force, laide, visage osseux, regard d’une dureté insoutenable – qui le renvoie à (s)es mollesses de vie confortable… Il y a cette clocharde qui le réveille en pleine nuit pour qu’il l’emmène à l’hôpital et qui ne s’en souvient pas le lendemain (les bonnes actions sont gratuites), cette jeune fille dont l’entretien à Pôle-Emploi n’a fait que renforcer le sentiment d’exclusion, cette plus ancienne qui ne supporte pas qu’on ne l’ait pas retenue pour un festival parce qu’elle a plus de 50 ans et le fait culpabiliser. Il y a Angèle, Inès, Mina, Louise, Solène, il y a cette jeune femme violée en réunion par un grand connard de boucher-charcutier hilare, qui n’aura pour seule possibilité de défense de faire la gueule le lendemain. Les actions se situent en bord de Loire, dans la campagne reculée – on retrouve les prés de chardons deux fois - et quand il fait voyager ses protagonistes aux États-Unis, c’est pour qu’ils se retrouvent dans un dinner paumé, avec Tom Waits en titre et fond musical : c’est l’Amérique des autres…
On sait depuis l’Affaire des vivants que Chavassieux excelle dans le réalisme et qu’il sait mieux que les autres remonter les secrets de famille, les pathologies collectives et l’extraordinaire puissance de la nuisance sociale. Ce livre articulé autour du suicide et de l’échec pourrait plomber le lecteur s’il n’était pas doublé d’une très forte déclaration d’amour envers les plus opprimées de toutes – je suis moins apitoyé par le sort de mes frères – celle qui existent encore moins que les autres, qu’on gratifie d’un pauvre (Mina) méprisant quand on veut bien les nommer et qu’on humilie jusque dans la mort : celle d’une mère à qui on aurait juste aimé dire je t’aime, une seule fois, une autre à qui on aurait aimé demandé si elle nous avait aimé, au moins. Et puis il y a cette langue archaïque dans le sens le plus noble du terme, qui fait que les récits s’enchâssent et que l’ensemble se lit d’une traite : on dit trop souvent que la nouvelle mène au roman, quitte à ce qu’on retrouve, souvent, dans l’exercice, les mêmes défauts d’écriture (comptez le nombre de fois où l’anaphore est utilisée…) ; ici, c’est le roman qui a mené à la nouvelle, et c’est l’exercice d’un auteur essentiel, dans sa démarche et dans son œuvre.
De Province, où elles vécurent, la Rumeur libre, 2025
14:44 Publié dans Blog | Lien permanent
21/03/2025
Bal', Bob & I.
Il se passe de chouettes choses dans cette petite librairie de Caluire - par ailleurs mon Combray à moi. Balmino y était en récital mercredi, Marie Schermesser, aujourd'hui, viendra parler de la traduction de Bob Kaufman (Sardine dorée, le Réalgar) et vendredi prochain, je serai avec Stéphane Pétrier, Stéphane Thabouret et des membres du Voyage de Noz sur l'absence de scène de la librairie pour présenter mes Noz d'émeraude et lancer ainsi les festivités de l'anniversaire du groupe.
En prime, les mots qu'Anthony, le libraire, a tenus à mon égard : "Laurent Cachard est habité par quelque chose qui le dépasse, du coup, il ne fait jamais les choses à moitié, c’est pour cela qu’on l’aime. Il y a une intensité rare qui traverse son œuvre (aux écritures multiples) mais sa sensibilité n’est pas sacrifiée à sa rage de vivre et d’écrire, son esprit va vite mais il aime prendre son temps, explorer l’objet qu’il aborde pour en faire émerger toutes les faces et livrer une exigeante recette que chacun pourra s’approprier. Si nous sommes parfois bousculés par son écriture, sa densité, ses lacets, ce chemin est régulièrement récompensé par des instants de grâce.."
07:39 Publié dans Blog | Lien permanent
01/03/2025
LYON CAPITALE.
 Si l'on considère que Lyon Capitale m'accorde un article tous les 13 ans, il faudra attendre ma 70e année (sic) pour que ce magazine chronique un de mes prochains ouvrages. En attendant, il y a l'émotion de relire ce beau papier autour de mon Poignet d'Alain Larrouquis et plus encore d'y trouver trace, dans l'édition de cette semaine, de mes Noz d'émeraude, en attendant la rencontre le 28 mars (18h30) au Panier de livres, à Caluire.
Si l'on considère que Lyon Capitale m'accorde un article tous les 13 ans, il faudra attendre ma 70e année (sic) pour que ce magazine chronique un de mes prochains ouvrages. En attendant, il y a l'émotion de relire ce beau papier autour de mon Poignet d'Alain Larrouquis et plus encore d'y trouver trace, dans l'édition de cette semaine, de mes Noz d'émeraude, en attendant la rencontre le 28 mars (18h30) au Panier de livres, à Caluire.
03:22 Publié dans Blog | Lien permanent
12/02/2025
L’IMMENSE DOUCEUR DU CONSTAT.
 C’est un p…. d’album - les modes ont un sens - le prochain album de Stéphane Balmino, les saisons à l’envers, comme un rappel à l’année dans le même sens de Boris Vian ou comme le signe de la mélancolie d’un temps où les choses allaient dans la bonne direction, ou qu’on n’avait pas la conscience qu’elles passaient, convaincus de notre invicibilité. Le goût des lendemains, la force de retourner en studio et d’offrir à son public un support qui n’est plus du tout au goût du jour, l’énergie qu’il faudra pour le défendre. A moins que l’auteur d’un « J’écris » - qui campe dans mon Panthéon musical – s’offre, à la Ferré, une Saison en enfer, en jouant sur les nombres et sur un bout de sonorité. Rimbaldien, il l’est assurément, Balmino, qui ouvre, sur fond de sirène lancinante, sur un morceau de près de 7 minutes – deux fois la durée d’un passage radio – assumé, le N de l’amour, la haine du conformisme dans une vie qui vit son p… d’automne, qu’il n'espère pas éternel, puisqu’il s’agit, ici, de les inventer, les saisons, de mettre le feu aux règles du jeu. Huit morceaux pour une quarantaine de minutes, c’est un format anachronique et ça lui va bien, à Balmino, chez qui on entend les références sans qu’il en joue : de Brel, à qui sa voix renvoie, on retient l’ombre de ton ombre, l’allusion au chien, la quête, aussi ; de Leprest, avec qui il a chanté, cette façon de poser, dans les textes, une énonciation particulière, de parler d’Elle comme de Je (forcément un autre, vu comme ça) ou de tutoyer, en interpellant : tu es là, tu es le prix à payer. La déraison d’être. De Tom Waits, outre le côté éraillé, il y a ces superbes motsanglais glissés en refrain du premier – long – titre : every beginning has an end. Même dans cette nuit sans retour dont il s’est protégé, Balmino, dans sa vie en quittant la Croix-rousse pour la quiétude de la campagne : Ici, le calme est partout, l’encre peut couler, les pages se tourner. On peut, enfin, regarder le temps passer, sortir les eaux de vie et envisager, sereinement, l’heure qui ferme les paupières. Mais pas avant d’avoir féraillé dur (Je graverai mon pied au cul de ceux qui n’ont pas entendu) et de renvoyer, au mitan de la moitié de l’abum – un vrai, qui s’écoute linéairement – à la distorsion des guitares électriques et des levers brutales de batterie claire. Avec ses Bad Seeds à lui, il a peaufiné les mélodies, piano, accordéon, cordes, s’est appuyé sur une session rythmique impressionnante, et ça donne un 7e album dont on dirait paresseusement qu’il est l’album de la maturité (cliché inside) s’il ne l’avait pas déjà acquise avant – et notamment dans Contresens, qui disait déjà tout de la vie qu’il s’est choisie. Son évidence du septénaire* - il y a biensept jours de la semaine, sept planètes importantes, sept couleurs dans le spectre de la lumière, sept merveilles du monde et, comme un message qui lui serait adressé de très loin, sept notes de musique - il l’a construite sur une injonction (refuse tous les compromis !), des récurrences (les thèmes du vent et du silence), des camaïeux (la note bleue – d’accordéon – la nuit noire) et unquestionnement : de quel sommeil faudra-t-il s’arracher pour qu’on ne nous enterre pas vivants ?
C’est un p…. d’album - les modes ont un sens - le prochain album de Stéphane Balmino, les saisons à l’envers, comme un rappel à l’année dans le même sens de Boris Vian ou comme le signe de la mélancolie d’un temps où les choses allaient dans la bonne direction, ou qu’on n’avait pas la conscience qu’elles passaient, convaincus de notre invicibilité. Le goût des lendemains, la force de retourner en studio et d’offrir à son public un support qui n’est plus du tout au goût du jour, l’énergie qu’il faudra pour le défendre. A moins que l’auteur d’un « J’écris » - qui campe dans mon Panthéon musical – s’offre, à la Ferré, une Saison en enfer, en jouant sur les nombres et sur un bout de sonorité. Rimbaldien, il l’est assurément, Balmino, qui ouvre, sur fond de sirène lancinante, sur un morceau de près de 7 minutes – deux fois la durée d’un passage radio – assumé, le N de l’amour, la haine du conformisme dans une vie qui vit son p… d’automne, qu’il n'espère pas éternel, puisqu’il s’agit, ici, de les inventer, les saisons, de mettre le feu aux règles du jeu. Huit morceaux pour une quarantaine de minutes, c’est un format anachronique et ça lui va bien, à Balmino, chez qui on entend les références sans qu’il en joue : de Brel, à qui sa voix renvoie, on retient l’ombre de ton ombre, l’allusion au chien, la quête, aussi ; de Leprest, avec qui il a chanté, cette façon de poser, dans les textes, une énonciation particulière, de parler d’Elle comme de Je (forcément un autre, vu comme ça) ou de tutoyer, en interpellant : tu es là, tu es le prix à payer. La déraison d’être. De Tom Waits, outre le côté éraillé, il y a ces superbes motsanglais glissés en refrain du premier – long – titre : every beginning has an end. Même dans cette nuit sans retour dont il s’est protégé, Balmino, dans sa vie en quittant la Croix-rousse pour la quiétude de la campagne : Ici, le calme est partout, l’encre peut couler, les pages se tourner. On peut, enfin, regarder le temps passer, sortir les eaux de vie et envisager, sereinement, l’heure qui ferme les paupières. Mais pas avant d’avoir féraillé dur (Je graverai mon pied au cul de ceux qui n’ont pas entendu) et de renvoyer, au mitan de la moitié de l’abum – un vrai, qui s’écoute linéairement – à la distorsion des guitares électriques et des levers brutales de batterie claire. Avec ses Bad Seeds à lui, il a peaufiné les mélodies, piano, accordéon, cordes, s’est appuyé sur une session rythmique impressionnante, et ça donne un 7e album dont on dirait paresseusement qu’il est l’album de la maturité (cliché inside) s’il ne l’avait pas déjà acquise avant – et notamment dans Contresens, qui disait déjà tout de la vie qu’il s’est choisie. Son évidence du septénaire* - il y a biensept jours de la semaine, sept planètes importantes, sept couleurs dans le spectre de la lumière, sept merveilles du monde et, comme un message qui lui serait adressé de très loin, sept notes de musique - il l’a construite sur une injonction (refuse tous les compromis !), des récurrences (les thèmes du vent et du silence), des camaïeux (la note bleue – d’accordéon – la nuit noire) et unquestionnement : de quel sommeil faudra-t-il s’arracher pour qu’on ne nous enterre pas vivants ?
Les saisons à l’envers, c’est un manifeste pour que rien ne reste de travers, pour la caravane de ces instants fous à lier, qui mettent l’intensité au centre de ce qu’il nous reste à vivre. Une immense douceur du constat : on est curieux, on est merveilleux, on se tait. Sans chercher le dernier mot – que tu manipules à merveille, souvent – mais toujours le premier geste (disait Reggiani). Ils ne se pas étendus sur la question, mais il y a deux ans, leur (nouvelle) maison est partie en fumée. L’incendie, la date contre laquelle on se bat pour qu’elle ne soit pas déterminante de ce qui fut, mais génératrice de ce qui sera. L’homme du futur antérieur - Il en aura fallu, du temps – joue entre le mode de l’action, au matin du grand soir, et le futur simple des horizons qui chantent, de nouveau, le goût des lendemains. Sa tribu et luiauront connu les abris de fortune (quand tournent les vautours ?), compris que 500 ouvrages partis en fumée ne sont rien au regard de ce qu’ils auraient pu connaître de pire. L’important, c’est la danse, les corps en vie qui réagissent aux vibrations, les hanches (de mescaline) gémellées à la psycho activité, en expérimentation : une espèce de transe, que confirme son complice Nicolas "Boulasse" Moumbounou, dans l’idée de métisser les sens uniques. Les saisons de la viesont métaphoriquement celles des âges et des expériences vécues : la fragile tarentelle de la sienne, Balmino veut la mener en plein, sans regrets – je partirai sans crainte et sans laisser d’adresse – en cavalier solitaire (on n’est pas obligé de le croire) né pour le vent. Insistant : j’ai toujours aimé le vent. Qui le portera, lui aussi, loin des masques qui grimacent et de la pourriture du fruit, vers les bouquets d’étoiles vers lesquels il navigue : les paraboles maritimes (gonfler la voile, le navire, lechalut, le raffiot, babord, la proue, la quille…) sont nombreuses pour un homme qui s’est réfugié à la campagne ! Mais les odyssées sont intérieures, le plus souvent, et il faut de la métaphysique pour prendre la peine, reconnaître son Ithaque (ici, tu peux te poser) et savoir que l’on a bien travaillé. Comme les paysans d’à côté, finalement, les seuls à savoir quelles sont les influences des saisons, leur almanach amoureux** à eux - Nom de Dieu, déjà septembre Fainéants peuvent s'aller pendre Aux vendanges de septembre tout s'arrange - et l’artiste a toujours été le complément idéal de celui qui, cultivant la terre, se permet un 3e sillon, quand deux suffisent, pour signer son tableau (l’apologue est de Alain, sur le travail). On gage, sans rien en savoir, que la vie se reconstruit là- bas au rythme de ce qui se passe quand tout s’est effondré, mais qu’on n’a jamais été aussi proche du terme et donc du recommencement. On se sépare ou on se répare, c’est sur ce pacte qu’on engage une reconstruction, et les 4 saisons de Balmino – hiver, automne, été, printemps – aboutiront donc, si on a bien saisi, à l’air qu’on reprend (le souffle, l’inspiration, l’intuition), aux champs reverdis, aux fleurs et aux bourgeons sur les arbres de Perséphone. Qui ne peut, dans le mythe, rester plus de quatre mois auprès de la Mère-Nature, mais qui laisse, à chaque fois qu’elle s’en va, la perspective qu’on la retrouve. Il en est ainsi des chanteurs qu’on aime, et même de ceux qui ne sont plus là : ça n’est pas pour rien qu’ils abreuvent leurs propres sillons, en 45 ou 33 tours. Du bout de quel silence ressortira-t-il, Balmino, quand il aura livré sa dernière production ? Un jour, on se sait, c’est lui qui l’a dit (après Gabin, après Socrate). On aura le droit de préférer telle ou telle rythmique, telle façon de raconter une histoire. De considérer le danger d’avoir tout dit dans le masterpiece du premier morceau. Mais impossible de rester de glace, et difficile de se dire que nos peurs de l’enfance (et nos parties de cache-cache) étaient des danses et qu’on ne l’avait encore pas compris. Mais on pourra aussi écouter ce disque-là en boucle, l’inscrire tout de suite dans la playlist de notre vie propre, qui connaît un automne providentiel et levoudrait flamboyant, encore un peu. Avant de la rendre (la vie), comme l’âme, à qui elle appartient. À qui elle appartient. À qui elle appartient. En tout cas, cet album à venir s’offre ce que peu de disques ou de livres – ces activités de jadis – peuvent s’offrir, maintenant, à l’heure des courses contre la montre et des concours d’éloquence : une durée, l’idée de quelque chose qui fait sens. Pour pasticher, un origami musical, un plaisir délicieux (…), isolé, sans la notion desa cause. Et l’envie (personnelle) de demander aux violonistes et violoncellistes – Tout son ranime de la mort, restitue la merveille du souffle à des corps désertés par le souffle*** – s’ils ont ressenti l’impression de participer de quelque chose de supérieur à l’enregistrement d’un disque. D’un son sacré sorti autrement que des guitares, « Il cimento dell'armonia e dell'inventione ». Des chansons écrites pour servir d’écrins littéraires m’inventent des souvenirs - à la musique, des instructions données à ceux qui sont venus jouer pour qu'ils insufflent de la vie à ses compositions. Et rendent au silence. Ou à un mot, mais pas le dernier, puisqu’on se l’interdit : ouah ! LC
@balminomusic
*Girafe lymphatique, le Réalgar, 2018
**Jean-Louis Murat, l’almanach amoureux, Mockba, 2005
***Pascal Quignard, la leçon de musique, Hachette, 1987
19:05 Publié dans Blog | Lien permanent

















































