24/06/2010
Jour de grève.
Voilà bien mon paradoxe: c'est au moment où les contingences se réduisent quasiment au strict minimum et que je bénéficie d'un temps de vacances dont il faut sans cesse rappeler au grand public qu'il ne m'est pas payé, que je ne parviens pas à me discipliner pour me mettre au travail. Je papillonne, je fais des petits films (ah, ça, j'en fais des petits films, dont le deuxième teaser de cache-cache, déjà prêt, qui me fascine moi-même: à se demander si ça va valoir le coup de sortir le roman, au bout du compte!), je virevolte à droite, à gauche (enfin, plutôt à gauche, aujourd'hui, quand même!), mais rien de bien conséquent ne sort. Ma vie n'est qu'un perpétuel entre-deux. Il vaudrait mieux que j'ouvre un skyblog, tiens! Enfin, quand même, samedi, un événement de première, un des marqueurs de mon existence... Paco de Lucia viendra m'enchanter de nouveau. C'est déjà ça: il y a plein de gens sur Terre, et on se demande pourquoi, qui voudraient que Dieu leur apparaisse: pour moi, ce sera la quatrième fois.
21:18 | Lien permanent
21/06/2010
Bande-annonce
Puisque le sort en est jeté, ou quasiment, autant lancer le plus vite possible ce qui mettra de toute manière des mois à se mettre en place. Je me suis livré à l'exercice délicat de la lecture du début de "la partie de cache-cache", ici illustré de quelques images mystérieuses. Evidemment, dans ce roman où les narrateurs sont des enfants, ma voix détonne, mais il n'est plus temps, déjà, de se trouver des excuses en amont...
17:40 | Lien permanent
19/06/2010
D'une chaise à l'autre, variations autour de Jean-Louis Pujol
 On ne s’est jamais suffisamment demandé pourquoi les chaises s’offraient à nous, pourquoi une place, dans une assemblée, pouvait nous paraître pré-destinée au point de s’y sentir aimanté. Parce qu’il aurait peut-être fallu pour cela accepter que tout fût écrit, les lieux, les rencontres, les phénomènes. Qu’une vie, dès lors, pourrait s’écrire au rythme des chaises sur lesquelles on s’est un jour assis, pour s’en relever enrichi d’un autre déterminisme : je peux choisir un siège plutôt qu’un autre, je peux aussi ne prendre que celui qu’il me reste, le fait est que la chaise est là, que je vais m’y asseoir et qu’à partir de là, le charme peut agir. Ou pas.
On ne s’est jamais suffisamment demandé pourquoi les chaises s’offraient à nous, pourquoi une place, dans une assemblée, pouvait nous paraître pré-destinée au point de s’y sentir aimanté. Parce qu’il aurait peut-être fallu pour cela accepter que tout fût écrit, les lieux, les rencontres, les phénomènes. Qu’une vie, dès lors, pourrait s’écrire au rythme des chaises sur lesquelles on s’est un jour assis, pour s’en relever enrichi d’un autre déterminisme : je peux choisir un siège plutôt qu’un autre, je peux aussi ne prendre que celui qu’il me reste, le fait est que la chaise est là, que je vais m’y asseoir et qu’à partir de là, le charme peut agir. Ou pas.
Déclinons : à tel moment de mon existence, on m’invite à prendre un siège, sans rien savoir du champ de mes possibles ; c’est un risque, que ne mesure peut-être pas celui ou celle qui m’y invite, parce qu’on ne sort en rien, en apparence, d’une action déjà socialement définie. Pourtant, autour de l’acte lui-même, les incidences sont nombreuses, et concentriques ; elles vont dicter un comportement et par assimilation, conditionner une existence : plus que moi qui choisis la chaise, ce serait donc la chaise qui me choisit ! D’abord parce qu’elle me définit à part entière comme appartenant à l’espèce des assis : elle m’intègre et me confère une normalité, au vu des autres chaises.
Elle me dessine ensuite, suivant son degré d’exposition : il y a une sociabilité des chaises, la place qu’elles occupent est parlante ou ne l’est pas, on sait déjà, suivant que l’on est puissant ou misérable, là où on va être assis. Rien n’a beaucoup changé depuis le trône, les ors sont différents mais la crainte demeure : il est des sièges qu’on ne saurait investir sans y être invité ! C’est donc avec circonspection qu’on aborde une chaise : on sait que la présentation n’est pas terminée, qu’il va falloir accorder la place qu’on nous donne aux attentes de ceux qui nous la donnent, qu’il va falloir rester en éveil, s’asseoir prudemment, ne jamais donner l’impression d’être installé : il y a des canapés pour ça, de ces endroits de fin de soirée où plus rien ne se décide parce que tout est déjà su. Il y a de la rigueur dans la tenue d’une chaise, c’est à celui qui y prend place de s’y plier ; c’est un des préceptes de l’éducation, qui correspond avec l’apprentissage des libertés, celles que l’enfant peut prendre sur une chaise haute. Le rapport au temps est double, d’ailleurs, parce qu’il est courant qu’on ressorte pour l’enfant la chaise de bois sur laquelle on a soi-même fait son initiation, moins par nostalgie que pour se convaincre que les leçons étaient bonnes. Et tout ça relève de l’équilibrisme, parce qu’il faut veiller à ce que l’enfant ne chute pas, qu’il comprenne que le bon usage de la chaise consiste à y rester jusqu’à ce qu’on soit invité à la quitter...
Or un enfant qui n’accepterait pas cette contrainte n’a aucune raison, a priori, de l’accepter dans un autre contexte, scolaire ou social, et restreint d’ores et déjà le panel de rôles qu’il pourrait se voir confier. A moins qu’il ne devienne comédien, un mode de vie où la chaise n’est guère prisée : au mieux à l’Opéra, où la chaise de poste désigne la loge du rez-de-chaussée, placée du côté de la Reine, au pire pour la rempailler...
17:41 | Lien permanent
16/06/2010
D"astreinte
La particularité du Ministère qui m'emploie est d'envoyer sur site des enseignants corriger les épreuves du baccalauréat, en leur demandant sans vergogne d'avancer les frais de déplacement et d'hébergement. Je pars donc en Ardèche jusqu'à vendredi. Et je n'en ai pas envie.
07:00 Publié dans Blog | Lien permanent
15/06/2010
Le roi du pays de rien
 Difficile de faire l’exercice critique d’une œuvre qu’on a déjà annoncée comme étant une merveilleuse régression dans l’époque rock’n’roll des années Starshooter et Téléphone. Que je n’ai pas connue comme telle, dois-je m’empresser de préciser, et que je ne peux qu’apprécier que ce pour ce qu’elle a été. Un disque, en 2010, c’est déjà un signe vers le passé, alors un disque de rock, en français, il faut être inconscient pour tenter l’expérience, ou alors ne rien en attendre d’autre que la satisfaction d’un travail (très) bien fait. Ce qui est le cas de [S]ex Machina, dont j’ai déjà parlé ici pour la chanson que j’ai écrite pour eux, « Je connais mes limites ». Il me restait à écouter la galette dans son intégralité, ce que j’ai fait plus d’une fois depuis hier, entre l’écoute incomparable de la voiture et le test probant de mes Cabasse (je ne donne pas la marque de mon ampli, on va se croire dans Belletto, après !). Je ne vais pas dire que j’aime tout et, afin d’éviter l’argumentation à concession partielle, je vais commencer par les mais plutôt que par le oui. Sachant que mes restrictions d’auditeur sont dans le cahier des charges d’un groupe de rock : qu’on mette les instruments en avant, que la balance des concerts se retrouve au mieux dans l’enregistrement studio. C’est le mixage qui rend le arbitrage et si l’album de Deuce est d’une facture absolument professionnelle à ce sujet, il n’en reste pas moins qu’à mon goût, la structure des morceaux est un peu répétitive, sauf dans les morceaux surprises de [S]ex Machina. Sans que je puisse arguer d’un vocabulaire technique suffisant, les ponts musicaux et les deux guitares sont, à mon sens, trop récurrents. Le ton est donné d’emblée, d’ailleurs, dans les enchaînements, de « Velvet sea » au très entêtant « Coup de théâtre ». A mon oreille de brassensophile, c’est un peu « too much » (class for the neighbourhood, moi aussi, j’ai quand même un peu de Lettres dans ce domaine !), mais « ça envoie le bois » et c’est bien là l’essentiel. Et le son, le mastering, pour le coup, est dantesque, c’est un fait : mention particulière, chez moi, au « Roi du pays de rien » - attention les rockers, la cinquantaine approchante vous micheldelpechise !- et à « Démobilisé », qui seront en concert des faits d’armes absolus. Le final, par définition, de « Coup de théâtre », est aussi un petit bijou (« Tombé du ciel, venu de l’au-delà, Ô Deus ex machina »), de ces airs qui rentrent et qui ne quittent plus… J’accroche moins à « Sitting Bull », à moins que les « Run, run, run » m’aient plongé dans une trop grande nostalgie post Aurélia Kreit, qui sait. Avec Stéphane Pétrier, je l’ai déjà écrit ici, comme lien entre ces deux époques. Christophe Simplex, le chanteur de Deuce, m’a expliqué à quel point sa collaboration avec Pétrier comme directeur artistique de l’album, l’avait poussé dans des retranchements qu’il ne se soupçonnait pas. Ça s’entend, ça se respire, ça met [S]ex Machina plus loin qu’il aurait jamais espéré aller, sans doute. Et les chœurs du monsieur ne gâtent rien, en plus de ça… Ses sentences (« fais pas ton Johnny », « je m’ennuie ») non plus. Les insertions d’un quatrain de Tim Staffell dans « Velvet sea » et de – me semble-t-il – Daniel Mesguich en arrière-fond dans « Coup de théâtre » montrent à quel point cet album a été pensé, préalablement et dans l’action.
Difficile de faire l’exercice critique d’une œuvre qu’on a déjà annoncée comme étant une merveilleuse régression dans l’époque rock’n’roll des années Starshooter et Téléphone. Que je n’ai pas connue comme telle, dois-je m’empresser de préciser, et que je ne peux qu’apprécier que ce pour ce qu’elle a été. Un disque, en 2010, c’est déjà un signe vers le passé, alors un disque de rock, en français, il faut être inconscient pour tenter l’expérience, ou alors ne rien en attendre d’autre que la satisfaction d’un travail (très) bien fait. Ce qui est le cas de [S]ex Machina, dont j’ai déjà parlé ici pour la chanson que j’ai écrite pour eux, « Je connais mes limites ». Il me restait à écouter la galette dans son intégralité, ce que j’ai fait plus d’une fois depuis hier, entre l’écoute incomparable de la voiture et le test probant de mes Cabasse (je ne donne pas la marque de mon ampli, on va se croire dans Belletto, après !). Je ne vais pas dire que j’aime tout et, afin d’éviter l’argumentation à concession partielle, je vais commencer par les mais plutôt que par le oui. Sachant que mes restrictions d’auditeur sont dans le cahier des charges d’un groupe de rock : qu’on mette les instruments en avant, que la balance des concerts se retrouve au mieux dans l’enregistrement studio. C’est le mixage qui rend le arbitrage et si l’album de Deuce est d’une facture absolument professionnelle à ce sujet, il n’en reste pas moins qu’à mon goût, la structure des morceaux est un peu répétitive, sauf dans les morceaux surprises de [S]ex Machina. Sans que je puisse arguer d’un vocabulaire technique suffisant, les ponts musicaux et les deux guitares sont, à mon sens, trop récurrents. Le ton est donné d’emblée, d’ailleurs, dans les enchaînements, de « Velvet sea » au très entêtant « Coup de théâtre ». A mon oreille de brassensophile, c’est un peu « too much » (class for the neighbourhood, moi aussi, j’ai quand même un peu de Lettres dans ce domaine !), mais « ça envoie le bois » et c’est bien là l’essentiel. Et le son, le mastering, pour le coup, est dantesque, c’est un fait : mention particulière, chez moi, au « Roi du pays de rien » - attention les rockers, la cinquantaine approchante vous micheldelpechise !- et à « Démobilisé », qui seront en concert des faits d’armes absolus. Le final, par définition, de « Coup de théâtre », est aussi un petit bijou (« Tombé du ciel, venu de l’au-delà, Ô Deus ex machina »), de ces airs qui rentrent et qui ne quittent plus… J’accroche moins à « Sitting Bull », à moins que les « Run, run, run » m’aient plongé dans une trop grande nostalgie post Aurélia Kreit, qui sait. Avec Stéphane Pétrier, je l’ai déjà écrit ici, comme lien entre ces deux époques. Christophe Simplex, le chanteur de Deuce, m’a expliqué à quel point sa collaboration avec Pétrier comme directeur artistique de l’album, l’avait poussé dans des retranchements qu’il ne se soupçonnait pas. Ça s’entend, ça se respire, ça met [S]ex Machina plus loin qu’il aurait jamais espéré aller, sans doute. Et les chœurs du monsieur ne gâtent rien, en plus de ça… Ses sentences (« fais pas ton Johnny », « je m’ennuie ») non plus. Les insertions d’un quatrain de Tim Staffell dans « Velvet sea » et de – me semble-t-il – Daniel Mesguich en arrière-fond dans « Coup de théâtre » montrent à quel point cet album a été pensé, préalablement et dans l’action.
Bref, c’est bien. C’est aussi l’occasion de se plonger dans l’écriture de Christophe Simplex, qui dit beaucoup plus qu’il veut bien le laisser entendre. Qui se protège parfois derrière quelques artifices thématiques de rocker mais qui a donné, avec « Marius Beyle », une dimension de lui qu’il n’avait pas encore explorée par disque : c’est à un tempo bien plus lent que ça se passe, via une voix délivrée du moindre effet avant que les instruments viennent la soutenir de façon plus marquée : c’est bien au dessus, dans l’écriture, des deux tributes à Gainsbourg (« la marche arrière », « Couleur cappuccino ») que je trouve en retrait dans l’album. On ne peut pas aligner dix chefs-d’œuvre dans un disque non plus et [S]ex Machina a choisi de frapper fort dès le départ. Il vaut mieux ça que l’inverse… L’écriture de Simplex, c’est un festival de R.C.C.C (références culturelles collectives cachées), Marilyn, les Beatles via Maharishi, Hitchcock, Verlaine, même, doublé de petits clins d’œil perso à des textes précédents, à d’autres époques encore (« Quel bel avenir », « la vie, c’est pas du cinéma »). C’est dire beaucoup et sous-entendre plus encore. Alors, évidemment, quand on n’est pas rock’n’roll, on peut aussi se demander ce qu’il donnerait sans plus aucun effet, plus de wo-o-o-o-o, de sha !, de mmmmmmmmm. Mais ce n’est pas le sujet. Et j’avais dit pas de « oui, mais » : un mais oui !, assurément.
14:00 Publié dans Blog | Lien permanent
13/06/2010
Après tout, qu'est-ce qu'on est?

21:46 Publié dans Blog | Lien permanent
10/06/2010
Les Edites
Quand Christian Chavassieux, avec qui je converse à ciel ouvert sur nos blogs respectifs depuis huit mois, m'a invité à participer au 1er Salon de la petite édition et du livre d'artiste de Roanne, je n'ai pas hésité une seule seconde: il est encore des terrains où le combat est permanent et d'intérêt collectif. Je serai donc là-bas dès demain, Raison & Passions aussi, pour assister aux rencontres professionnelles, puis samedi et dimanche, pour rencontrer le public. Je lirai samedi à 14h30 des extraits de "Tébessa, 1956" et de "la partie de cache-cache". A moins que je lise du Psychopompe et qu'on inverse également les rôles? Entre temps, il y a rencontre à la Médiathèque de St Etienne demain à 18h: le même Chavassieux y laissera derrière lui son "Baiser de la nourrice". Profitez-en, il n'y a rien à la télé...

13:50 Publié dans Blog | Lien permanent
09/06/2010
Outrance, Outrage, Outreau.
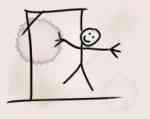 Ce blog n'a pas de vocation politique, du moins pas autrement que par l'esthétique. Mais je me dois de vous raconter une histoire comme il s'en passe beaucoup, en ce moment, dans un Etat pour qui force doit rester à la loi (à dire avec un accent méditerranéen très prononcé, souvenir de Malek Oussekine et de Human Bomb réunis). Ce n'est ni de Stéphane Guillon, ni de Didier Porte qu'il s'agit là, mais d'un caricaturiste local, qui participe à l'édition papier et numérique d'un fanzine d'une ville de province que je ne nommerai pas, sauf pour dire qu'elle a accueilli la première maison de la Culture - inaugurée par Malraux, celui qui a fait entrer Jean Moulin là où il ne faut surtout pas mettre Albert Camus - et accessoirement moi-même, dans sa médiathèque, pour y présenter Tébessa. Je ne nommerai pas non plus la revue subversive, je ne dirai pas qu'elle détourne dans son titre celui du seul journal régional existant, en tirant un peu vers la ballade de Villon. Notez que je n'ai rien dit, hein? Non, parce que ça devient compliqué: quatre mois après qu'elle est passée inaperçue dans l'édition en ligne, le Directeur de la Police Préfectorale porte plainte pour injure à représentant de la République. Ignorant sans doute que la Res Publica confère une image, publique par essence, que l'usage laisse à la merci des humoristes et des caricaturistes, dont la fonction est de durcir le trait, par définition. Et voilà que le Directeur de la publication, ainsi que son président, se voient convoqués au commissariat, devant des fonctionnaires gênés, qui ne comprennent pas que le fond de l'article - sur les 400 expulsions de sans-papiers menées à train d'enfer dans cette petite ville - n'ait posé aucun problème et que seul le dessin soit visé. On aura tout dit en ajoutant que ce haut fonctionnaire - à qui il reste quinze ans pour s'acheter une Rollex (s'il ne l'a déjà) et qui a déjà réussi largement sa vie si tant est qu'une mission détermine une existence - participait la semaine d'avant à une exposition titrée "Savoir Désobéir", et sous-titrée "des préfets iniques sous Pétain", en l'honneur de policiers insoumis, élevés au rang de Justes parmi les Justes... Et que son zèle lui permettra sans doute d'obtenir le poste qu'il brigue auprès de son Autorité. Une histoire parmi tant d'autres, vous disais-je. Sans doute contre-productive, pour autant: à mépriser toute forme de liberté, on fabrique des insurgés.
Ce blog n'a pas de vocation politique, du moins pas autrement que par l'esthétique. Mais je me dois de vous raconter une histoire comme il s'en passe beaucoup, en ce moment, dans un Etat pour qui force doit rester à la loi (à dire avec un accent méditerranéen très prononcé, souvenir de Malek Oussekine et de Human Bomb réunis). Ce n'est ni de Stéphane Guillon, ni de Didier Porte qu'il s'agit là, mais d'un caricaturiste local, qui participe à l'édition papier et numérique d'un fanzine d'une ville de province que je ne nommerai pas, sauf pour dire qu'elle a accueilli la première maison de la Culture - inaugurée par Malraux, celui qui a fait entrer Jean Moulin là où il ne faut surtout pas mettre Albert Camus - et accessoirement moi-même, dans sa médiathèque, pour y présenter Tébessa. Je ne nommerai pas non plus la revue subversive, je ne dirai pas qu'elle détourne dans son titre celui du seul journal régional existant, en tirant un peu vers la ballade de Villon. Notez que je n'ai rien dit, hein? Non, parce que ça devient compliqué: quatre mois après qu'elle est passée inaperçue dans l'édition en ligne, le Directeur de la Police Préfectorale porte plainte pour injure à représentant de la République. Ignorant sans doute que la Res Publica confère une image, publique par essence, que l'usage laisse à la merci des humoristes et des caricaturistes, dont la fonction est de durcir le trait, par définition. Et voilà que le Directeur de la publication, ainsi que son président, se voient convoqués au commissariat, devant des fonctionnaires gênés, qui ne comprennent pas que le fond de l'article - sur les 400 expulsions de sans-papiers menées à train d'enfer dans cette petite ville - n'ait posé aucun problème et que seul le dessin soit visé. On aura tout dit en ajoutant que ce haut fonctionnaire - à qui il reste quinze ans pour s'acheter une Rollex (s'il ne l'a déjà) et qui a déjà réussi largement sa vie si tant est qu'une mission détermine une existence - participait la semaine d'avant à une exposition titrée "Savoir Désobéir", et sous-titrée "des préfets iniques sous Pétain", en l'honneur de policiers insoumis, élevés au rang de Justes parmi les Justes... Et que son zèle lui permettra sans doute d'obtenir le poste qu'il brigue auprès de son Autorité. Une histoire parmi tant d'autres, vous disais-je. Sans doute contre-productive, pour autant: à mépriser toute forme de liberté, on fabrique des insurgés.
21:04 Publié dans Blog | Lien permanent


















































