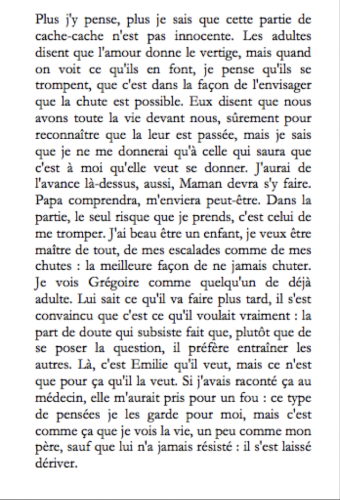30/04/2012
Des bulles de temps.
 On dit depuis l’Antiquité (et accessoirement dans le fabuleux « Rois & Reine » de Desplechin) que les femmes passent de bulles en bulles – qui doivent être des bulles de temps – quand les hommes vivent sur une droite, pour mourir qui plus est. Dans « Grand huit », d’Isabelle Kaufmann, chacune de ces bulles de temps est sondée narrativement jusqu’à ce qu’elles se croisent. Dans l’action fondatrice – et force perturbatrice à la fois – Kitz arrête sa Bugatti le long d’une route : une femme est étendue sur la chaussée, morte ; dans son véhicule à elle, il y a un nouveau-né, qu’il prend. Dans le même temps, sa femme l’a quitté pour son plus proche collaborateur, ils l’ont trahi et lui prend une revanche, ce faisant, sur la vie. Il élève David, qu’il adore ; en retour, David l’aide, de son point de vue d’enfant précoce et ingénieux, à concevoir les jouets qu’il crée, du ramoneur à pipe au manège lumineux de vie. Le tableau est idyllique jusqu’à ce qu’on enlève David et que son ex-femme - menaçant de tout révéler - lui demande, plutôt qu’une rançon classique, de restituer le temps qu’elle a perdu. A chaque fois par tranche de huit ans, en hommage, certainement, aux arabesques qu’elle aimait dessiner et dont elle a fini par faire un modèle d’existence, adorant telle patineuse artistique, vénérant l’anamorphose parfaite proche, allongée, de l’infini. Le nœud gordien de « grand huit » ne s’arrête pas à sa dimension policière : les apparences sont trompeuses, les ravisseurs ne s(er)ont pas forcément qui on croit qu’ils sont. Il y a aussi deux scientifiques qui touchent au but puisqu’il ne leur manquait qu’une personne prête à tout –renoncer au cartésianisme – pour leur servir de cobaye. Au hasard des errances de Kitz, Isabelle Kaufmann nous fait croiser Einstein, par le biais de sa théorie récente de la relativité générale. Exeunt Euclide - sa géométrie aux trois axes droits et à la lumière rectiligne - et le bon sens - chose au monde la mieux partagée – Kitz consulte les savants-fous (Schweich et Reinhardt) en même temps qu’une voyante bulgare qui possède, dit-elle en lui jouant de la cornemuse, un divan sur lequel s’est assis Frédéric Chopin. D’apparence loufoque, dans le rythme des chapitres et dans les portraits de ses figures, « Grand huit », une fois la surprise passée, fonctionne comme roman parce qu’il plonge le lecteur dans l’interrogation centrale, la plus inextricable de toute métaphysique : comment faire, dans l’urgence, pour rattraper le temps perdu, le concéder, qui plus est, à quelqu’un qui nous en veut ? J’ai déjà écrit ici, récemment, sur la mythologie d’une linéarité du temps, cité Grégoire XIII à qui l’on doit le 15 octobre 1582 comme lendemain du 4, par exemple. Mais Kaufmann va plus loin encore puisqu’elle mêle l’angoisse du – faux – père à la quête absolue d’une éternité qu’il faudra trouver pour la céder. Les histoires s’emmêlent, on retrouve Odile, sans la linéarité d’existence exposée au départ, le lecteur passe d’une sphère de narration à l’autre en se demandant ce qui peut bien les relier : c’est donc un exercice réussi, même si je dois concéder une certaine impatience avant qu’il ne m’accroche. Tiens, une impatience, encore une marque de temps dont on aimerait qu’il passe plus vite ! Ou qu’il rejoigne les assurances sur lesquelles, souvent, on se repose. Kaufmann interroge même le sujet de la femme pensante, Marie Curie et quelques rares autres exceptés ; les figures féminines sont elliptiques, dans « Grand huit » : Llena, Claudia, des personnages in absentia ou doublement factices. A chaque arabesque – mise en abyme – supplémentaire, on cherche une réalité qui en cache une autre, systématiquement dissimulée. Et révélée à la fois : par les prédictions de la cartomancienne, par Odile, présentée dans la 2ème partie du roman comme on ne l’avait pas suffisamment perçue au début : mi-ange mi-démon, aux pouvoirs surnaturels et au regard bleu acier. Kaufmann se plaît à faire entrer son lecteur dans les circonvolutions, les volutes, les rouleaux des vagues que son héroïne a érigés en modèles d’existence. Elle remonte le cours des enfances de chacun, introduit tel ou tel repère temporel qui n’empêche pas le contemporain de sourire, tel le secret – que je tairai – de l’origine du nom Haribo, voire de celle de la Recherche. Du temps perdu, évidemment. Elle reconstruit les souvenirs, la mémoire, point par point, et les misérables petits tas de secrets passés à la moulinette freudienne, dont le premier, ici, est fondateur d’un édifice du mensonge. Intègre nos duplicités – gémellités - dans des rebondissements romanesques qui laisseront le lecteur pantois ou exsangue, mais pas indifférents. Avec l’infini en soi et en perspective. Quand Schweich s’interroge sur ce que Bergson dit du temps du physicien plutôt que de celui du philosophe, Kaufmann laisse le lecteur réfléchir mais a déjà choisi. Son dénouement sera magistral, à coups d’équations vitales à une seule inconnue revendiquée mais à beaucoup plus que cela en fait. Genre x = 5+8. Qu’elle se mette en huit et qu’elle coupe les cheveux par le même chiffre, son roman schizophrène n’y va pas par huit chemins pour emporter l’adhésion.
On dit depuis l’Antiquité (et accessoirement dans le fabuleux « Rois & Reine » de Desplechin) que les femmes passent de bulles en bulles – qui doivent être des bulles de temps – quand les hommes vivent sur une droite, pour mourir qui plus est. Dans « Grand huit », d’Isabelle Kaufmann, chacune de ces bulles de temps est sondée narrativement jusqu’à ce qu’elles se croisent. Dans l’action fondatrice – et force perturbatrice à la fois – Kitz arrête sa Bugatti le long d’une route : une femme est étendue sur la chaussée, morte ; dans son véhicule à elle, il y a un nouveau-né, qu’il prend. Dans le même temps, sa femme l’a quitté pour son plus proche collaborateur, ils l’ont trahi et lui prend une revanche, ce faisant, sur la vie. Il élève David, qu’il adore ; en retour, David l’aide, de son point de vue d’enfant précoce et ingénieux, à concevoir les jouets qu’il crée, du ramoneur à pipe au manège lumineux de vie. Le tableau est idyllique jusqu’à ce qu’on enlève David et que son ex-femme - menaçant de tout révéler - lui demande, plutôt qu’une rançon classique, de restituer le temps qu’elle a perdu. A chaque fois par tranche de huit ans, en hommage, certainement, aux arabesques qu’elle aimait dessiner et dont elle a fini par faire un modèle d’existence, adorant telle patineuse artistique, vénérant l’anamorphose parfaite proche, allongée, de l’infini. Le nœud gordien de « grand huit » ne s’arrête pas à sa dimension policière : les apparences sont trompeuses, les ravisseurs ne s(er)ont pas forcément qui on croit qu’ils sont. Il y a aussi deux scientifiques qui touchent au but puisqu’il ne leur manquait qu’une personne prête à tout –renoncer au cartésianisme – pour leur servir de cobaye. Au hasard des errances de Kitz, Isabelle Kaufmann nous fait croiser Einstein, par le biais de sa théorie récente de la relativité générale. Exeunt Euclide - sa géométrie aux trois axes droits et à la lumière rectiligne - et le bon sens - chose au monde la mieux partagée – Kitz consulte les savants-fous (Schweich et Reinhardt) en même temps qu’une voyante bulgare qui possède, dit-elle en lui jouant de la cornemuse, un divan sur lequel s’est assis Frédéric Chopin. D’apparence loufoque, dans le rythme des chapitres et dans les portraits de ses figures, « Grand huit », une fois la surprise passée, fonctionne comme roman parce qu’il plonge le lecteur dans l’interrogation centrale, la plus inextricable de toute métaphysique : comment faire, dans l’urgence, pour rattraper le temps perdu, le concéder, qui plus est, à quelqu’un qui nous en veut ? J’ai déjà écrit ici, récemment, sur la mythologie d’une linéarité du temps, cité Grégoire XIII à qui l’on doit le 15 octobre 1582 comme lendemain du 4, par exemple. Mais Kaufmann va plus loin encore puisqu’elle mêle l’angoisse du – faux – père à la quête absolue d’une éternité qu’il faudra trouver pour la céder. Les histoires s’emmêlent, on retrouve Odile, sans la linéarité d’existence exposée au départ, le lecteur passe d’une sphère de narration à l’autre en se demandant ce qui peut bien les relier : c’est donc un exercice réussi, même si je dois concéder une certaine impatience avant qu’il ne m’accroche. Tiens, une impatience, encore une marque de temps dont on aimerait qu’il passe plus vite ! Ou qu’il rejoigne les assurances sur lesquelles, souvent, on se repose. Kaufmann interroge même le sujet de la femme pensante, Marie Curie et quelques rares autres exceptés ; les figures féminines sont elliptiques, dans « Grand huit » : Llena, Claudia, des personnages in absentia ou doublement factices. A chaque arabesque – mise en abyme – supplémentaire, on cherche une réalité qui en cache une autre, systématiquement dissimulée. Et révélée à la fois : par les prédictions de la cartomancienne, par Odile, présentée dans la 2ème partie du roman comme on ne l’avait pas suffisamment perçue au début : mi-ange mi-démon, aux pouvoirs surnaturels et au regard bleu acier. Kaufmann se plaît à faire entrer son lecteur dans les circonvolutions, les volutes, les rouleaux des vagues que son héroïne a érigés en modèles d’existence. Elle remonte le cours des enfances de chacun, introduit tel ou tel repère temporel qui n’empêche pas le contemporain de sourire, tel le secret – que je tairai – de l’origine du nom Haribo, voire de celle de la Recherche. Du temps perdu, évidemment. Elle reconstruit les souvenirs, la mémoire, point par point, et les misérables petits tas de secrets passés à la moulinette freudienne, dont le premier, ici, est fondateur d’un édifice du mensonge. Intègre nos duplicités – gémellités - dans des rebondissements romanesques qui laisseront le lecteur pantois ou exsangue, mais pas indifférents. Avec l’infini en soi et en perspective. Quand Schweich s’interroge sur ce que Bergson dit du temps du physicien plutôt que de celui du philosophe, Kaufmann laisse le lecteur réfléchir mais a déjà choisi. Son dénouement sera magistral, à coups d’équations vitales à une seule inconnue revendiquée mais à beaucoup plus que cela en fait. Genre x = 5+8. Qu’elle se mette en huit et qu’elle coupe les cheveux par le même chiffre, son roman schizophrène n’y va pas par huit chemins pour emporter l’adhésion.
16:43 Publié dans Blog | Lien permanent
29/04/2012
La Sévigné & Moi (2)
 Un jour que j'étais dans la maison de Jean Frémiot et que nous confrontions nos habitudes de citadin et de campagnard, j'ai lancé comme un défi que je pourrais écrire un roman sur lui, sur la façon dont je l'imaginais enfant. En ce temps-là, j'avais déjà écrit ce qui deviendrait "Tébessa", mais je n'étais pas dans une perspective d'édition, ou alors d'auto-édition, avec des petits livrets plastifiés qui accompagnaient les premières expo de Jean ou de Jean-Louis Pujol, les premières scènes de NADA aussi, dont on ne savait pas qu'il n'y en aurait plus. Je dis ça à Jean Frémiot donc, avec un peu de provocation, et la question que je lui pose immédiatement après, c'est : est-ce que tu avais un ennemi quand tu étais petit? Et là il me répond tout de go Richard D., avec un nom en deux syllabes que je ne saurais répéter ici, pas plus que je n'ai pu l'utiliser pour le roman. Cette inimitié, si spontanément exprimée, a donné le premier élan au récit. Il s'agirait d'une tragédie et les deux enfants seront rivaux. Il restait à dégager un enjeu, qui sera donc Émilie. Laquelle aurait pu s'appeler Sabine, puisque j'ai aussi demandé à Jean s'il se souvenait, a contrario, d' une jeune fille qu'il aimait bien et qu'il m'a répondu Sabine. Mais Sabine Heudebert. Or, donner le nom d'une marque de biscottes à un personnage de roman n'est pas le meilleur moyen de commencer. Et j'avais une idée en tête. Dont je ne savais pas, néanmoins, qu'elle m'empêcherait pendant des années d'en poursuivre l'écriture...
Un jour que j'étais dans la maison de Jean Frémiot et que nous confrontions nos habitudes de citadin et de campagnard, j'ai lancé comme un défi que je pourrais écrire un roman sur lui, sur la façon dont je l'imaginais enfant. En ce temps-là, j'avais déjà écrit ce qui deviendrait "Tébessa", mais je n'étais pas dans une perspective d'édition, ou alors d'auto-édition, avec des petits livrets plastifiés qui accompagnaient les premières expo de Jean ou de Jean-Louis Pujol, les premières scènes de NADA aussi, dont on ne savait pas qu'il n'y en aurait plus. Je dis ça à Jean Frémiot donc, avec un peu de provocation, et la question que je lui pose immédiatement après, c'est : est-ce que tu avais un ennemi quand tu étais petit? Et là il me répond tout de go Richard D., avec un nom en deux syllabes que je ne saurais répéter ici, pas plus que je n'ai pu l'utiliser pour le roman. Cette inimitié, si spontanément exprimée, a donné le premier élan au récit. Il s'agirait d'une tragédie et les deux enfants seront rivaux. Il restait à dégager un enjeu, qui sera donc Émilie. Laquelle aurait pu s'appeler Sabine, puisque j'ai aussi demandé à Jean s'il se souvenait, a contrario, d' une jeune fille qu'il aimait bien et qu'il m'a répondu Sabine. Mais Sabine Heudebert. Or, donner le nom d'une marque de biscottes à un personnage de roman n'est pas le meilleur moyen de commencer. Et j'avais une idée en tête. Dont je ne savais pas, néanmoins, qu'elle m'empêcherait pendant des années d'en poursuivre l'écriture...
17:09 Publié dans Blog | Lien permanent
28/04/2012
La Sévigné & Moi.
 J’ai quatorze jours pour préparer ce que je vais dire à Grignan sur le thème du deuxième roman. Je parlerai, je l’ai dit, des deux autres romans sélectionnés, avec « la partie de cache-cache » et « Du domaine des murmures », déjà chroniqué. Ce sera une rubrique unique, comme un feuilleton, qui n’intéressera sans doute personne mais comme personne n’écoute, comme dit Miossec, eh bien je le ferai quand même. Et ceux qui auront suivi jusqu’au bout auront droit, comme dans les meilleurs films américains à gros budget, à une fin alternative du roman ! Mais comment vais-je pouvoir expliquer qu’au même titre que – je donne cette thèse du sociologie Bernard Lahire à chacune de mes interventions – un auteur qui n’est pas rémunéré pour le travail qu’il fournit est obligé d’en prendre un autre (un second, qui devient de fait le premier), mon rapport à « la partie » comme deuxième roman va être difficile à expliquer dans la mesure où c’est un roman dont j’ai interrompu l’écriture. Définitivement, le croyais-je alors. Pour compenser cette déchirure qu’entraîne un tel renoncement, de roman, j’en ai écrit un autre. Pour m’amuser. Sans savoir, là non plus, que ce roman, mon deuxième, de facto, encore, deviendrait mon troisième dans l’édition. Rien de linéaire là-dedans, alors. Demain, la génèse.
J’ai quatorze jours pour préparer ce que je vais dire à Grignan sur le thème du deuxième roman. Je parlerai, je l’ai dit, des deux autres romans sélectionnés, avec « la partie de cache-cache » et « Du domaine des murmures », déjà chroniqué. Ce sera une rubrique unique, comme un feuilleton, qui n’intéressera sans doute personne mais comme personne n’écoute, comme dit Miossec, eh bien je le ferai quand même. Et ceux qui auront suivi jusqu’au bout auront droit, comme dans les meilleurs films américains à gros budget, à une fin alternative du roman ! Mais comment vais-je pouvoir expliquer qu’au même titre que – je donne cette thèse du sociologie Bernard Lahire à chacune de mes interventions – un auteur qui n’est pas rémunéré pour le travail qu’il fournit est obligé d’en prendre un autre (un second, qui devient de fait le premier), mon rapport à « la partie » comme deuxième roman va être difficile à expliquer dans la mesure où c’est un roman dont j’ai interrompu l’écriture. Définitivement, le croyais-je alors. Pour compenser cette déchirure qu’entraîne un tel renoncement, de roman, j’en ai écrit un autre. Pour m’amuser. Sans savoir, là non plus, que ce roman, mon deuxième, de facto, encore, deviendrait mon troisième dans l’édition. Rien de linéaire là-dedans, alors. Demain, la génèse.
17:50 Publié dans Blog | Lien permanent
27/04/2012
Rappel d'offres.
18:28 Publié dans Blog | Lien permanent
26/04/2012
L'empreinte du chant.
 J’ai déjà parlé ici du talent de Guillo, un de ces auteurs/compositeurs/interprètes dont les médias ne parlent pas mais dont le talent est presque naturel, si l’on passait sous silence les heures passées à ciseler les chansons qu’ils viennent défendre là où ils peuvent, là où on les invite à venir. Hier, après m’être imprégné pendant des mois de son album « Super 8 », c'était l'heure du rendez-vous, auquel Gérard Védèche m'avait convié. Ces chanteurs-là, hélas, il faut se préparer à les voir dans des conditions indignes de ce qu’ils font, justement, mais le débat n’est pas nouveau. Dans ce bar de St Etienne où il a joué, une petite poignée de personnes l’ont écouté remonter le temps d’une enfance - dont il a gardé la nostalgie de la fraternité, des étés à la campagne, des jouets mécaniques et de ce qu’on allait faire de ses dix doigts - et d’une vie d’homme au parcours non linéaire mais tout entier tourné vers la sensibilité. Guillo sur scène est impressionnant, pas seulement quand il vous fixe de ses yeux d’un clair perçant. Par son charisme, son jeu de guitare tout en retenue, il occupe la scène sans afféterie, juste au service des mots qu’il envoie. Et qu’on reçoit en plein cœur, souvent : rien de plus juste n’a été écrit sur les adieux imbéciles sur un quai de gare et, en soi, c’est déjà un exploit d’éviter le cliché. Sur la maison laissée vide par un autre départ. Sur des chevaux qu’il a aimés. Sur un personnage de film générationnel qui permet justement de revenir vers le futur. Je lui confie l’anecdote, il en sourit : je n’avais pas vu ces films si en vogue dans les 80’s, c’est « Si j’étais Marty Mc Fly », sa chanson, qui a fait que je les ai enfin regardés, avec quelqu’un dont j’avais l’âge quand ils sont sortis. Il chante, Guillo, il donne, le nombre est dépassé, pas question de ne pas faire ce pour quoi il est fait. C’est ce qui me donne la matière de ce billet, d’ailleurs : parmi tous ceux qui prétendent, et ils sont nombreux, comment l’évidence n’apparaît-elle pas à tous ? En peu de temps dans ma vie, j’ai croisé des personnes qui incarnaient leur Art. Parfois, le compliment m’est retourné, même s’il est ambigu : il peut aussi signifier de rester dans son domaine. L’autre bonheur du jour, s’il fallait les lister, c’est aussi l’absence de surprise (ce n'est pas péjoratif) dans la rencontre, l’impression d’avoir trouvé la personne que j’étais venu chercher. Qui habite, pour ne rien gâter, à une poignée de kilomètres d’Orthez, où je verrais d’un bon œil qu’on se retrouve pour une scène partagée, quand j’y viendrai, en octobre. Encore un rendez-vous d'amis: à n'importe quelle heure, je suis admis.
J’ai déjà parlé ici du talent de Guillo, un de ces auteurs/compositeurs/interprètes dont les médias ne parlent pas mais dont le talent est presque naturel, si l’on passait sous silence les heures passées à ciseler les chansons qu’ils viennent défendre là où ils peuvent, là où on les invite à venir. Hier, après m’être imprégné pendant des mois de son album « Super 8 », c'était l'heure du rendez-vous, auquel Gérard Védèche m'avait convié. Ces chanteurs-là, hélas, il faut se préparer à les voir dans des conditions indignes de ce qu’ils font, justement, mais le débat n’est pas nouveau. Dans ce bar de St Etienne où il a joué, une petite poignée de personnes l’ont écouté remonter le temps d’une enfance - dont il a gardé la nostalgie de la fraternité, des étés à la campagne, des jouets mécaniques et de ce qu’on allait faire de ses dix doigts - et d’une vie d’homme au parcours non linéaire mais tout entier tourné vers la sensibilité. Guillo sur scène est impressionnant, pas seulement quand il vous fixe de ses yeux d’un clair perçant. Par son charisme, son jeu de guitare tout en retenue, il occupe la scène sans afféterie, juste au service des mots qu’il envoie. Et qu’on reçoit en plein cœur, souvent : rien de plus juste n’a été écrit sur les adieux imbéciles sur un quai de gare et, en soi, c’est déjà un exploit d’éviter le cliché. Sur la maison laissée vide par un autre départ. Sur des chevaux qu’il a aimés. Sur un personnage de film générationnel qui permet justement de revenir vers le futur. Je lui confie l’anecdote, il en sourit : je n’avais pas vu ces films si en vogue dans les 80’s, c’est « Si j’étais Marty Mc Fly », sa chanson, qui a fait que je les ai enfin regardés, avec quelqu’un dont j’avais l’âge quand ils sont sortis. Il chante, Guillo, il donne, le nombre est dépassé, pas question de ne pas faire ce pour quoi il est fait. C’est ce qui me donne la matière de ce billet, d’ailleurs : parmi tous ceux qui prétendent, et ils sont nombreux, comment l’évidence n’apparaît-elle pas à tous ? En peu de temps dans ma vie, j’ai croisé des personnes qui incarnaient leur Art. Parfois, le compliment m’est retourné, même s’il est ambigu : il peut aussi signifier de rester dans son domaine. L’autre bonheur du jour, s’il fallait les lister, c’est aussi l’absence de surprise (ce n'est pas péjoratif) dans la rencontre, l’impression d’avoir trouvé la personne que j’étais venu chercher. Qui habite, pour ne rien gâter, à une poignée de kilomètres d’Orthez, où je verrais d’un bon œil qu’on se retrouve pour une scène partagée, quand j’y viendrai, en octobre. Encore un rendez-vous d'amis: à n'importe quelle heure, je suis admis.
En bonus, Nicolas Vitas – qui a écrit « Que restera-t-il ? » et mérite pour cela le Panthéon - a dit aux quatre personnes qui restaient qu’elles pourraient toujours courir et, allez comprendre, j'ai acquiescé et ne demande que ça.
17:43 Publié dans Blog | Lien permanent
25/04/2012
Nipponoclaste.
 Cet homme, sur la scène de l’amphithéâtre, fait près de vingt ans de moins que l’âge qu’il avoue. Il est Japonais, il intervient, pour l’occasion, sur le sujet des jardins japonisants, en guise de caution culturelle aux deux autres orateurs, l’un traitant de l’histoire des jardins, l’autre de la mode des jardins zen dans la profession. Etsuo Yoneyama, puisque c’est de lui qu’il s’agit, devrait s’excuser d’être là puisqu’il n’a rien à voir, de près ou de loin, avec la profession horticole, voire avec le Japon tout court puisque ça fait trente ans qu’il est arrivé en France pour étudier, qu’il s’y est installé et que, chiasme complet, il enseigne le japonais dans une école de management. Quelques sourires ont fleuri dans la salle à la vue des quelques fautes d’orthographe ponctuant ses diapositives, mais ils se sont vite éteints quand le mien s’est ravi : voilà ce petit homme discret qui se met à expliquer à des jeunes que ce qui l’a intéressé dans la vie, c’est la différence, l’altérité. Et que l’Asie et l’Occident ne sont pas le même monde, que la première des différences est religieuse. Selon lui, la vision du monde occidentale est dualiste, entre la matière et l’esprit, et qu’elle est due au monothéisme. Et le voilà passant en revue la philosophie grecque désignant l’esprit comme la partie noble. Pour arriver au cartésianisme occidental, l’animal-machine, l’esprit et la matière qui ne se mélangent pas, sauf au niveau du cerveau. Puis à « Djin Djack » Rousseau, qu’il tient comme le plus essentiel des philosophes. A cet instant, je regarde les jeunes Français qui ne rient plus de ses fautes et de sa modestie. Il continue, Etsuo, oppose à la dualité occidentale, la vision unitaire du monde japonais, son polythéisme, la trilogie entre le Monde, le Sacré et le Bien. Dans la culture japonaise, nous dit-il, c’est la Nature qui domine, via la confrontation des hasards. Il n’y a pas de représentation de l’esprit humain, la Nature est nettement supérieure à l’homme et le lui rappelle en permanence, là-bas, par les séismes, les tsunamis et les éruptions. Même la production, l’atelier, sont sacrés et obéissent aux règles naturelles des 5S (via la traduction, ça donne le tri, le rangement, la propreté, le nettoyage et la discipline) et des 3M (irrégularités, gaspillage, tâches difficiles). Une leçon de philosophie entre le Shintô, le bouddhisme et le Zen : l’oubli de soi, l’esprit qui doit (re)devenir la Nature dans sa vénération. La recherche de l’apaisement, de l’harmonie, de la purification. Dans le jardin zen comme dans l’Etat de nature de Rousseau, il n’y a rien d’inutile ni de superflu. C’est là qu’il s’est permis, dans un sourire, de dire que ce n’était pas possible avec des Français, qui parlent trop et ne connaissent pas le Ma, le milieu, le vide, l’espace qui ne sert à rien mais qu’il faut trouver et respecter. Avec les Français, pas d’intervalle. A cet instant, tout l’amphithéâtre était concerné. Et la sortie s’est faite sur un pas japonais : comme une invitation faite au promeneur à se décaler pour regarder un autre paysage que celui qu’il a l’habitude de voir et qu’il ne regarde plus.
Cet homme, sur la scène de l’amphithéâtre, fait près de vingt ans de moins que l’âge qu’il avoue. Il est Japonais, il intervient, pour l’occasion, sur le sujet des jardins japonisants, en guise de caution culturelle aux deux autres orateurs, l’un traitant de l’histoire des jardins, l’autre de la mode des jardins zen dans la profession. Etsuo Yoneyama, puisque c’est de lui qu’il s’agit, devrait s’excuser d’être là puisqu’il n’a rien à voir, de près ou de loin, avec la profession horticole, voire avec le Japon tout court puisque ça fait trente ans qu’il est arrivé en France pour étudier, qu’il s’y est installé et que, chiasme complet, il enseigne le japonais dans une école de management. Quelques sourires ont fleuri dans la salle à la vue des quelques fautes d’orthographe ponctuant ses diapositives, mais ils se sont vite éteints quand le mien s’est ravi : voilà ce petit homme discret qui se met à expliquer à des jeunes que ce qui l’a intéressé dans la vie, c’est la différence, l’altérité. Et que l’Asie et l’Occident ne sont pas le même monde, que la première des différences est religieuse. Selon lui, la vision du monde occidentale est dualiste, entre la matière et l’esprit, et qu’elle est due au monothéisme. Et le voilà passant en revue la philosophie grecque désignant l’esprit comme la partie noble. Pour arriver au cartésianisme occidental, l’animal-machine, l’esprit et la matière qui ne se mélangent pas, sauf au niveau du cerveau. Puis à « Djin Djack » Rousseau, qu’il tient comme le plus essentiel des philosophes. A cet instant, je regarde les jeunes Français qui ne rient plus de ses fautes et de sa modestie. Il continue, Etsuo, oppose à la dualité occidentale, la vision unitaire du monde japonais, son polythéisme, la trilogie entre le Monde, le Sacré et le Bien. Dans la culture japonaise, nous dit-il, c’est la Nature qui domine, via la confrontation des hasards. Il n’y a pas de représentation de l’esprit humain, la Nature est nettement supérieure à l’homme et le lui rappelle en permanence, là-bas, par les séismes, les tsunamis et les éruptions. Même la production, l’atelier, sont sacrés et obéissent aux règles naturelles des 5S (via la traduction, ça donne le tri, le rangement, la propreté, le nettoyage et la discipline) et des 3M (irrégularités, gaspillage, tâches difficiles). Une leçon de philosophie entre le Shintô, le bouddhisme et le Zen : l’oubli de soi, l’esprit qui doit (re)devenir la Nature dans sa vénération. La recherche de l’apaisement, de l’harmonie, de la purification. Dans le jardin zen comme dans l’Etat de nature de Rousseau, il n’y a rien d’inutile ni de superflu. C’est là qu’il s’est permis, dans un sourire, de dire que ce n’était pas possible avec des Français, qui parlent trop et ne connaissent pas le Ma, le milieu, le vide, l’espace qui ne sert à rien mais qu’il faut trouver et respecter. Avec les Français, pas d’intervalle. A cet instant, tout l’amphithéâtre était concerné. Et la sortie s’est faite sur un pas japonais : comme une invitation faite au promeneur à se décaler pour regarder un autre paysage que celui qu’il a l’habitude de voir et qu’il ne regarde plus.
15:11 Publié dans Blog | Lien permanent
24/04/2012
Moody Blues.
Je n’ai aucune raison objective de me plaindre de ma condition d’écrivain émergeant, moi qui suis attendu, ces prochaines semaines, à Grignan et à Annecy pour y parler de mon travail. Néanmoins, je cède un peu au découragement ces derniers temps au regard de ma propre impéritie dans la création, la diffusion de mon travail et le coup de pouce qu’on attend toujours de la part de ceux qu’on a déjà croisés, qu’on pensait avoir séduits. Je me suis interdit l’aigreur dans l’édition, je revendique, par ailleurs, des éclaircies que je n’attendais plus, mais le difficile semble toujours, depuis Kierkegaard, le seul chemin. Un chemin long et chaotique, dont on facilite l’accès aux uns, pas aux autres.
17:34 Publié dans Blog | Lien permanent
23/04/2012
Tour de Grevisse.
Je n'ai rien à dire sur l'élection présidentielle sauf qu'il me semblait qu'auparavant, le pluriel était d'usage. Mais bon.
21:45 Publié dans Blog | Lien permanent