29/01/2017
NIE FERGESSEN (4/4).

NB : pour mémoire, cette nouvelle a été écrite (pour les épisodes 2,3&4 in situ, à la Souris Verte, à Epinal, en direct de la captation vidéo de cinq nouveaux titres). Un beau moment partagé avec Anne, Vincent & Jo, des visages retrouvés sur la route, d’autres dont on fait la connaissance, Michel, Olivier, Pauline… À chaque fois le plaisir est décuplé par le fait d’en être, d’y revenir, comme une marque de permanence renouvelée. Merci à Michaëla & David, évidemment, à Fabien Cruzille, Thomas Jedwab-Wroclawski, Cyril Magi et tous les autres. Être de l’autre côté de la barrière est une expérience toujours fascinante pour ceux qui aiment la musique et les arts vivants. Les projets ne manquent pas, les rendez-vous non plus. Cooool…
15:49 Publié dans Blog | Lien permanent
NIE FERGESSEN (3/4).

Elle n’aura pas entendu Cyril, le réalisateur, donner les consignes, rester et tousser aux mêmes places, pour les raccords, les deux sets, les différences d’enregistrement, les fonctions de chacun des cadreurs : Jean-François se charge des plans sur Michaëla, Christian focalise sur David, Eymeric est à la grue, Julien au travelling et la caméra centrale, autonome, prendra les plans larges. Thomas - sans lumière il n’y a pas de vidéo – conseille au public de ne pas fixer les barres d’éclairage et d’être acteur du tournage ; Fabien vulgarise le concept d’ear monitor, pas sûr que tout le monde ait compris, mais on pardonne à ces fans, qui ont patienté plus de trois heures, pour les premiers arrivés. Trois de plus qu’elle, qui entre sur scène quasiment en même temps qu’eux. Ils sont de nouveau au rendez-vous, elle mesure, à chaque fois qu’elle les retrouve, l’importance de la route, qui ponctue les rencontres, en provoque d’autres. Elle est toute à sa confusion d’être la retardataire,
« C’est pas de notre faute ! », annonce David sur scène, suivi de son « Cool », classique. Michaëla, cheveux plaqués, longue tresse chinoise, avoue qu’ils sont un peu stressés, présente Paul (« premier concert, déjà un enregistrement »), « tout le monde est prêeeeeeeeet ? », « Ouaaaaaaais », et c’est « Old is beautiful », comme un rappel que ce qu’elle a vécu peut être déjà ancien mais que l’important n’est pas là. Les arabesques que Thomas projette sur le mur, la frappe martiale et aérienne de Paul provoquent les premiers hochements de tête de spectateurs qui ne savent pas trop comment se situer : on est entre la répétition publique et la solennité de l’enregistrement. « N’hésitez pas à être vous-mêmes, à être heureux ! », propose Michaëla, « C’est drôle, on vous connaît tous et on ne vous a pas dit bonjour », répond David, il y a des pauses à combler. Dans le fond rouge, elle commence à scruter mais tout la ramène à sa dette et elle se concentre : la deuxième prise entraîne enfin les premiers vivats du public, aussitôt ramené aux exigences du tournage : les éclairages se règlent entre les pistes, Thomas offre un verre de vin à Michaëla, il faudra le supprimer des raccords, peut-être est-il derrière, là-bas, vers la porte ? Le deuxième morceau, c’est « la mélancolie », on voit Paul s’exciter sur ses pads sans qu’on entende rien d’autre qu’un petit battement sourd, avant que la grosse caisse reprenne. Tout est curieux, le son n’est pas à destination du public, mais des ingénieurs. « Ça va, Paul ? », « ça va ». Elle s’interroge : qu’est-ce qui la provoque, la mélancolie et quelle est la frontière avec la complaisance ? Elle est là, en plein, maintenant, mais n’est-ce pas l’idée de ce qu’elle est venue y chercher qui l’a menée là, plus que ce qu’elle y trouvera réellement ? Michaëla introduit « Tangerine » en disant que c’est l’absence de concerts, l’année qui vient de s’écouler, le fait que certains d’entre ceux qui sont sur scène aujourd’hui leur ont manqué qui leur a inspiré ce morceau, qu’elle joue au clavier, voix fragile, montées blues. « C’est cool, c’est comme à la maison, avec juste un peu plus de monde dans le salon », conclut-elle. Ça n’empêche pas David de se planter et Michaëla d’aller le masser. Le public plaisante, interpelle les artistes, ça n'évite pas d’être extrêmement concentré. Michaëla lâche un propos sur les daurades, c’est la deuxième fois qu’on en parle et à Epinal, c’est étonnant. Ou codé. « Tu veux la guerre » réveille un peu tout le monde : « C’est quoi le problème, y’a pas de problème », elle semble prendre ça pour elle, pour tout ce qui a manqué à sa vie ces dernières années, ces conflits qui les ont ponctuées, toutes ces impossibilités dont on fait cas mais qui ne résistent pas à l’adage que le duo répète : « D’avance, on a tous perdu ». Michaëla perd un peu son ear, mais les deux revendiquent un peu plus de Paul dedans : il n’y en a toujours que cinq qui comprennent, mais c’est l’essentiel. Le solo de David est dantesque, arrivera-t-il à le faire à chaque fois, plaisante Fabien. « I want love » enchaîne, ses énumérations, ses scansions, sa visée et sa p…. de rythmique. Le petit Paul est une bien belle trouvaille, décidément, bon nombre de regards sont posés sur lui, dont le sien, ce qui l’empêche d’en chercher un autre, ailleurs. Mais au dernier coup de baguette, c’est le break qu’on annonce, la possibilité d’aller prendre l’air et, enfin, de savoir.
01:52 | Lien permanent
28/01/2017
NIE FERGESSEN (2/4).

Ses pas l’ont menée machinalement devant la salle de concert. Elle n’y entrera que tout à l’heure, mais elle sait qu’à l’intérieur, l’armée travaille. Cyril est arrivé ce matin, avec Christian, Jean-François et des étudiants de BTS du lycée de la Communication, à Metz, ils ont installé un dispositif impressionnant : grues, travelling sur rails, une SonyF55, un GH4 Lumix, un Canon EOSC… Aux consoles de son et d’éclairage, ayant survécu à la mise en examen sollicitée par le directeur de l’hôtel précité, Fabien et Thomas créent l’ambiance, check le Recc – faut faire gaffe, c’est généreux dans le bas, les casques ! - Thomas commençant, c’est son concept, par envoyer de la fumée. On installe une scène à l’envers, Paul Gremillet, le très jeune batteur sosie de Barton Fink, est devant, tout au bord, tournant le dos à la fosse, ce qui n’inquiète personne, puisque le concept du tournage, c’est d’installer les spectateurs sur les planches, autour du duo. En mode Presley 68 come back special, comme elle, pile. Qui se demande s’il est venu, s’il est déjà là, en train d’écrire. Si tous ceux qui fourmillent, chacun à leur tâche, savent qui il est et pourquoi il se cache, dans un coin, pour écrire ces instants qui se passent. Paul est un musicien que le duo a repéré, qu’ils ont voulu pour eux : pendant l’installation, il danse ses morceaux, bat dans le vide, s’imprègne. Il les libère des programmations, les rend à leur liberté de guitaristes. Michaëla fait des mouvements de yoga, va chercher l’énergie qu’elle restituera tout à l’heure ; David distribue des cooool, signe que tout se passe bien. Dans l’envers du décor, il y a un grand écart avec le jour du concert d’il y a deux ans : moins de frénésie et de dispersion, l’affaire est réglée comme du papier musique, ça tombe bien. Mais elle ne sait rien de tout ça : elle fait partie de ceux qui arrivent quand tout est prêt. En avance, pour le coup, cette fois-ci : retrouvant dans les rues, les enseignes, une partie du froid aussi, la mélancolie suffisante pour se dire que rien n’a changé et que tout, pourtant, est différent.
Devant la Souris Verte, il y a déjà du monde : la production a demandé aux heureux élus – le nombre de spectateurs est évidemment restreint par la configuration, au grand dam du groupe qui supporte mal l’idée de faire des déçus – de venir à midi, pour une entrée à 13heures, qui attendra un peu, quand même. Elle hésite à s’approcher : retrouver tel ou tel visage connu l’amènerait déjà à considérer le présent comme tel, à sortir d’un entre-deux temporel qu’elle fait durer. Revenir, c’est ancrer une réalité qui n’est plus, souvent. Elle se réfugie dans un bar, commande un Saint-Véran. Ironie, elle reconnaît au millième de seconde l’intro piano de « l’Aigle Noir », ferme les yeux, s’imprègne de ce morceau qu’elle a tant écouté, les arrangements de Michel Colombier, la guitare rock, la partition de basse surréelle, la levée de batterie… Qu’est-ce qu’elle raconte, cette chanson, qu’elle n’ait pas connu aussi ? À la fin du verre et du morceau, hagarde, elle paie et se dirige vers l’entrée de la salle. Il s’est passé une demi-heure, mais elle est plus importante que les deux années écoulées. On a déjà fait entrer le public, on lui reproche son retard, elle s’excuse, sourit tristement. Anne, à la porte, ne sait pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait, la laisse entrer, l’accompagne, pousse pour elle la lourde porte : elles traversent la fosse qu’elle avait quittée bondée, deux ans avant, n’a pas le temps de s’attarder sur le matériel en place, les projecteurs, les deux consoles en contrebas de la scène. Il reste une place côté jardin, elle a juste le temps de s’installer dans l’obscurité et l’épais brouillard de Thomas, pas celui de regarder s’il est là, parmi les spectateurs, ou quelque part ailleurs, à s’émouvoir de sa venue.
16:39 Publié dans Blog | Lien permanent
27/01/2017
NIE FERGESSEN (1/4).
Elle s’est dit qu’elle allait monter. Qu’il était temps, deux ans après, d’aller vérifier la théorie selon laquelle les lieux s’imprègnent de ce qu’on y a laissés et qu’il est possible, parfois, qu’on retrouve tout tel quel, les endroits comme les énergies. Deux ans auparavant, elle était rentrée le cœur et l’esprit chamboulés, sans savoir dans quel ordre, ni pourquoi. Sans savoir si les mots de ceux qu’elle était venue écouter avaient généré la rencontre ou s’ils l’avaient accompagnée, seulement. Si de tous ceux qui avaient convergé vers cette scène improbable - gageure et apogée de trois années de concerts incessants - l’homme dont elle avait saisi le regard était celui qu’elle était destinée à rencontrer. Qui allait combler ses désirs d’intensité, inscrire ses pas sur les siens et ceux des deux qu’elle suivait partout où elle pouvait aller. Cet homme, dans le hall d’entrée de l’hôtel, pas tout à fait à l’aise dans le barnum artistique, le bal des suiveurs, elle avait lu ses chroniques de résidence, s’était délectée des épisodes qu’il livrait quotidiennement, pour installer l’ambiance et faire monter l’envie. Il lui avait semblé, pendant quatre jours, qu’elle était parmi l’équipe, les techniciens dont il dressait le portrait, les artistes eux-mêmes dont il parlait en focalisation interne, en se mettant dans la tête de chaque élément du duo, dans ce qu’il recevait et donnait à l’autre dans le même temps… Elle avait lu ces longues chroniques, médium d’un autre temps, celui de la lenteur, de l’installation dans un lieu, dans les coulisses d’un spectacle à venir. Etait-ce l’écriture elle-même, ou sa régularité, était-ce parce qu’il disait ce qu’elle voulait entendre d’eux, mais elle s’était piquée au jeu, avait voulu voir à quoi ressemblait cet homme qui repoussait des limites physiques dans l’exercice, était tombée sur son visage. De belles photos, professionnelles, d’un être ordinaire. Pas du genre à provoquer des émois, des histoires projetées. Une force de la nature, imposant, inquiétant, peut-être. En tout cas, dans le hall de l’hôtel, dans la frénésie des départs, le lendemain du concert - ces moments qu’on prolonge pour éviter la retombée trop brutale - elle les avait reconnus, lui et son air d’être là sans y être. Il est possible que pour raconter aussi justement un instant, on doive s’en extraire au moment où on le vit. N’était-ce pas ce dont elle souffrait elle aussi, finalement ? N’était-ce pas cette mélancolie que sollicitaient chez elle les chansons du duo, dût-elle, à tel acmé du concert, fondre en larmes sur des vers tristes, ceux des amours délitées. Elle était venue lui parler, comme on aborde quelqu’un qu’on connaît, sauf qu’ils ne se connaissaient pas. En inspirant un bon coup, elle avait donné un immense élan naturel à quelque chose qui ne l’était pas : ils auraient à évoquer, tout de suite, des choses qui les reliaient, ce n’est pas ainsi, socialement, qu’on fait connaissance. Ils seraient dans la connivence, tout de suite, ne pourraient rien cacher de leurs failles, puisque les chansons qu’ils allaient évoquer les palliaient toutes, à leur façon. Il fallait qu’elle maquille cet abandon par un sourire, un charme. Qu’ils soient à égalité, puisqu’elle l’avait lu. Une rencontre, théoriquement, c’est une jonction, là, elle faisait se relier les quatre jours qu’ils avaient vécus ensemble mais séparément. En avait-il seulement conscience, lui, des histoires qui se jouaient quand il les racontait chez lui, seul – peut-être – pris au piège d’une fiction plus complète que pourrait l’être la réalité ? Dans tout ce qu’elle avait lu de ce qu’il avait écrit du duo, elle n’avait rien trouvé sur « Des amours », sa chanson, ça lui donnait un temps d’avance dans l’abord : quand on provoque une rencontre, on n’en devine jamais les incidences. Elle avait vérifié ça tant de fois dans sa vie récente, celle d’après la fin de l’histoire, celle à laquelle on croit jusqu’à ce qu’on en fasse le deuil. Avant qu’on en termine, souvent, dans une agonie qui pousse les romantiques à jurer qu’ils lui substitueront l’intensité, jusqu’au bout. S’ils étaient là, c’est qu’ils étaient pareils. Qu’ils correspondaient. Que le duo qu’ils étaient venus voir présiderait la naissance du leur. D’un coup de palpitant.
16:01 Publié dans Blog | Lien permanent
11/01/2017
PITIÉ POUR LES LOUPS!
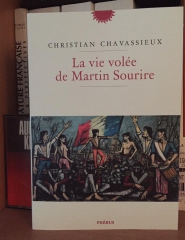 Il faut d’abord encaisser - une deuxième fois – le sublimissime finale de « la vie volée de Martin Sourire », le nouveau roman de Christian Chavassieux, pour répondre à une question qu’il s’est récemment posée[1] : que dire de ce roman maintenant qu’il l’a écrit, et qu’il lui faut en parler ? Comme si le mutisme de son personnage – que compense le stigmate d’un sourire perpétuel, « particularité de sa physionomie » - devait s’emparer de lui, s’il ne pouvait plus opposer aux lecteurs qui se succèderont qu’un « je ne sais pas » lapidaire, comme les rares mots que Martin rend à ceux qui l’interrogent. Fussent-ils Royaux puisqu’il en est ainsi : la force perturbatrice du roman se fonde sur l’offrande qu’une vieille indigente tend à bout de bras, les mêmes que ceux que tend l’enfant, sur le passage du cortège. En une seconde, ravie par son sourire, déjà, un destin se noue : le petit rien du tout sera adopté par Marie-Antoinette. L’Autrichienne, Reine du Royaume de France. Passera d’une vie de gueux à celle, dorée, du Palais de Versailles, dans l’ombre de ceux que la Reine, en mal de maternité, a déjà accueillis, de ceux – dont un petit Noir, charmant – qu’on lui a offerts. Jusqu’à ce qu’elle se lasse, et les confie à d’autres : Martin, sans s’émouvoir, passera de mains en mains, de moins en moins nobles, jusqu’à grandir dans l’univers factice du Petit Trianon – initialement construit pour désennuyer le Roi – ramené à sa condition tout en en étant extrait : Martin, coqueluche permanente – « Tous sont sous le charme » - grandit à l’abri du besoin mais occupe le poste de vacher, à la « constance placide » : il observe le monde, la Nature, devine qu’elle n’est pas si originelle que ça mais ne se pose aucune espèce de question. Il vit au rythme, nous dit-on, du Ranz des vaches, qui n’a pas chez lui l’acception que lui donne Rousseau dans le Dictionnaire de la Musique[2] mais en suggère l’interprétation, puisque le roman ramène le philosophe de façon récurrente (huit fois, contre sept à Voltaire, belle revanche rétrospective !) : extirpé de son milieu, l’enfant se développe mieux qu’il l’aurait fait ailleurs, mais sa nature est profonde. Et se rappellera à lui. Il aurait, pu, Martin, rester au Petit Trianon, voir le théâtre des événements se dérouler hors de ses lieux et hors d’un temps que le destin royal a suspendu. Voir ses figures y évoluer, également : Richard Mique, intendant et contrôleur général des bâtiments et jardins de la Reine, Claude Richard, le jardinier-fleuriste du Roi, Valy et Marie Bussard, qui ont (peut-être) amené à Versailles le chant des bergers Suisses. Et, de temps à autre, comme une apparition, la Reine, qui tarde à reconnaître Martin, lequel lui rend – somptueux dialogue – un Oui Madame forcé à la question qu’elle lui pose. Le Roi, de loin, dans un douloureux contraste physique : « un homme simplement là, hésitant, gauche et emprunté, gras de figure, épais de lèvres et de bassin. »
Il faut d’abord encaisser - une deuxième fois – le sublimissime finale de « la vie volée de Martin Sourire », le nouveau roman de Christian Chavassieux, pour répondre à une question qu’il s’est récemment posée[1] : que dire de ce roman maintenant qu’il l’a écrit, et qu’il lui faut en parler ? Comme si le mutisme de son personnage – que compense le stigmate d’un sourire perpétuel, « particularité de sa physionomie » - devait s’emparer de lui, s’il ne pouvait plus opposer aux lecteurs qui se succèderont qu’un « je ne sais pas » lapidaire, comme les rares mots que Martin rend à ceux qui l’interrogent. Fussent-ils Royaux puisqu’il en est ainsi : la force perturbatrice du roman se fonde sur l’offrande qu’une vieille indigente tend à bout de bras, les mêmes que ceux que tend l’enfant, sur le passage du cortège. En une seconde, ravie par son sourire, déjà, un destin se noue : le petit rien du tout sera adopté par Marie-Antoinette. L’Autrichienne, Reine du Royaume de France. Passera d’une vie de gueux à celle, dorée, du Palais de Versailles, dans l’ombre de ceux que la Reine, en mal de maternité, a déjà accueillis, de ceux – dont un petit Noir, charmant – qu’on lui a offerts. Jusqu’à ce qu’elle se lasse, et les confie à d’autres : Martin, sans s’émouvoir, passera de mains en mains, de moins en moins nobles, jusqu’à grandir dans l’univers factice du Petit Trianon – initialement construit pour désennuyer le Roi – ramené à sa condition tout en en étant extrait : Martin, coqueluche permanente – « Tous sont sous le charme » - grandit à l’abri du besoin mais occupe le poste de vacher, à la « constance placide » : il observe le monde, la Nature, devine qu’elle n’est pas si originelle que ça mais ne se pose aucune espèce de question. Il vit au rythme, nous dit-on, du Ranz des vaches, qui n’a pas chez lui l’acception que lui donne Rousseau dans le Dictionnaire de la Musique[2] mais en suggère l’interprétation, puisque le roman ramène le philosophe de façon récurrente (huit fois, contre sept à Voltaire, belle revanche rétrospective !) : extirpé de son milieu, l’enfant se développe mieux qu’il l’aurait fait ailleurs, mais sa nature est profonde. Et se rappellera à lui. Il aurait, pu, Martin, rester au Petit Trianon, voir le théâtre des événements se dérouler hors de ses lieux et hors d’un temps que le destin royal a suspendu. Voir ses figures y évoluer, également : Richard Mique, intendant et contrôleur général des bâtiments et jardins de la Reine, Claude Richard, le jardinier-fleuriste du Roi, Valy et Marie Bussard, qui ont (peut-être) amené à Versailles le chant des bergers Suisses. Et, de temps à autre, comme une apparition, la Reine, qui tarde à reconnaître Martin, lequel lui rend – somptueux dialogue – un Oui Madame forcé à la question qu’elle lui pose. Le Roi, de loin, dans un douloureux contraste physique : « un homme simplement là, hésitant, gauche et emprunté, gras de figure, épais de lèvres et de bassin. »
La vie volée de Martin Sourire aurait pu être celle-ci, mais comme dans toute initiation, il faut un point de rupture, l’envie de dépasser les bordures. « Franchir le mur », aller là où s’exprime une opinion publique – « une nouveauté » - qui n’est pas favorable au Régime, c’est un euphémisme. Jusque là, apprend-on, Martin contemplait « un monde dont il n’est pas », tout en en étant. Même « remis à sa juste place », en vacher, comme persifle Armand, autre éphémère protégé de la Reine. En partant, puisque « Jésus a arrangé (s)on cas », il entre de plain-pied dans un pays qui a faim – les guerres d’Amérique ont ruiné le Royaume – et qui gronde (« le peuple, c’est le nombre et le nombre avait faim »). Martin devient témoin d’un Paris qui bruisse de colère et de mouvements, mais décide d’en être acteur, cette fois-ci : puisqu’ « il faut être à Paris pour prendre la mesure de la République », puisque les temps sont politiques, on suit les soubresauts de l’An 1789, la naissance des Etats généraux, les premières émeutes, la création d’une Assemblée Nationale, la fuite des nobles… Chavassieux romancier devient historien à part entière – l’idée qu’il se fait de la littérature dans son exigence et sa finalité –, raconte l’Histoire à travers celle qu’il écrit. Les références sont évidemment exactes, teintées, ici et là, d’un distant et sarrautien « c’est bien ça », ou d’une ironique rectification, sur le « ça ira ». Il y a une fonction référentielle dans le roman, sauf à être agrégé d’histoire – et encore, de la période – mais rien de pesant : on suit Martin dans ce qu’on nomme « l’opposé de Versailles », le style se modifie dans la deuxième partie, qui multiplie les descriptions et, par-delà, les énumérations, de l’immense pauvreté parisienne, d’une « Aria de la foule » qui se dessine, de cette exaltation, cette fraternité qu’il y trouve. Le récit se fait épique ou élégiaque : on sait l’écrivain capable d’envolées hugoliennes (dans « les Nefs de Pangée »[3]), poétiques et véristes à la fois (dans « l’Affaire des Vivants »[4]). Pour autant, la réussite de « Martin Sourire », c’est de poursuivre, sans coup férir, la vie de son personnage éponyme. Qu’on retrouve, dans une farandole de mets, dans les cuisines de Beauvilliers – premier homme de son siècle dans l’Art culinaire – au service d’Etienne-Louis Boullée, architecte utopiste qui permet à Chavassieux d’écrire, une fois encore, sur les bibliothèques (celle des Rois d’Ugarite, d’Assurbanipal, des Ptolémée, celles d’Hadrien… Relire « Mausolées », pour l’occasion) et les livres qui comptent[5], dans une vie. Et de vibrer avec Martin sur le projet de son protecteur. Qui les héberge, sa Marianne - Dieu qu’elle était jolie ! - et lui, contre menus services. Qui désespère, lui, de Rousseau, mais tient à ce que Martin - « qui n’est pas frustre » - se serve en livres et étudie ses plans de Bibliothèque Royale, un projet démesuré qui se heurtera hélas au « manque d’audace, (à) la médiocrité des esprits »… À peine le temps de suivre Martin dans des aventures égrenées par les saisons, les années et les ellipses qu’elles induisent et c’est la troisième et dernière partie du roman, « la grande sauvage », titre initial du manuscrit. Un choc littéraire, logorrhée consciente et maîtrisée que Martin destine, dans l’énonciation, à la femme qu’il aime et qui le voit revenir de quatre années passées en sans-culotte au service de la Nation. Par « élan révolutionnaire » et ce jusqu’en Vendée : jusqu’à ce que la question du Citoyen Lequinio – Elu de l’Assemblée Législative et Envoyé de la Convention – « sur ce qui se passait ici » déclenche un chapitre 8 torrentiel[6], « précipice devant ses pensées », salvateur dans ce qu’il détruit des illusions qui l’ont porté jusque là. Nonobstant, à chaque étape de son parcours, des rappels à sa condition fielleux : de Beauvilliers, qui lui glisse qu’il aurait fait, « au mieux, un excellent second » ; de Louis-Ange Pitou, qui lui assène un « vous n’êtes pas libre » quand Martin s’émancipe trop, à son goût, de ce qu’il doit à Marie-Antoinette… Ce qu’il lui doit, d’ailleurs, sans rien déflorer, c’est le sujet du roman lui-même : de la vie d’homme qu’elle a déterminée à celle qu’elle l’a laissé mener, seul, jusqu’à sa vérité singulière. Dans un pays que la raison a déserté (ce que se dit Richard Mique devant le Tribunal Révolutionnaire, aux six heures quotidiennes de Louison, la machine à raccourcir), « tout se peut », même être « avec les pires » et « charrier l’enfer jusqu’à la stupeur du Ciel ». Heureusement, in fine, les six jours fériés des sans-culottides…
Je dis depuis 2014 maintenant que « l’Affaire des Vivants » est un VRAI chef-d’œuvre de la littérature. Un de ces romans qui sortent une fois tous les trente ans. « La vie volée de Martin Sourire » est de cette lignée d’écriture : on est pris, captivé, entre densité du contexte et structure narrative impeccable, comme toujours. On peut faiblir, revenir, annoter, mais pas lâcher. S’il doute toujours de ce qu’il va bien pouvoir en dire aux lecteurs qui ne manqueront pas de le rencontrer, qu’il les laisse le remercier de ce qu’il est et de ce qu’il fait. On dira que c’est l’ami qui parle, mais ce sera idiot : l’ami que je suis en a perdu d’autres en disant – toujours – ce qu’il pense. Que l’imbécile qui m’a piqué dans ma boîte mon exemplaire de presse dédicacé se méfie, par contre : j’ai appris suffisamment de rituels sataniques dans cet ouvrage pour qu’il passe un mauvais moment, chat noir (salut, Gaïa ![7]) ou non.
[1] Kronix, le blog journalier de l’auteur, 9.01.2017
[2] « Ces effets, qui n’ont aucun lieu sur les étrangers, ne viennent que de l’habitude, des souvenirs, de mille circonstances qui, retracées par cet Air à ceux qui l’entendent, & leur rappelant leur pays, leurs anciens plaisirs, leur jeunesse & toutes leurs façons de vivre, excitent en eux un doute amer d’avoir perdu tout cela », Dictionnaire de la musique, 1768.
[3] Mnémos, 2015
[4] Phébus, 2014
[5] De la Bibliothèque Bleue, “littérature de colportage” aux oeuvres ésotériques, en passant par les récits antiques de Pausanias, les aventures de Télémaque de Fénelon : du fatum librorum à son pendant inverse.
[6] Aux intonations du « Baiser de la nourrice » (JP Huguet Editions, 2009) ?
[7] Le chat (noir) de mon fils, déesse grecque et féline, disparue le 28 août 2016, le même jour que mon père.
15:42 Publié dans Blog | Lien permanent

















































