11/01/2017
PITIÉ POUR LES LOUPS!
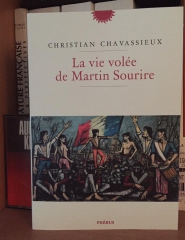 Il faut d’abord encaisser - une deuxième fois – le sublimissime finale de « la vie volée de Martin Sourire », le nouveau roman de Christian Chavassieux, pour répondre à une question qu’il s’est récemment posée[1] : que dire de ce roman maintenant qu’il l’a écrit, et qu’il lui faut en parler ? Comme si le mutisme de son personnage – que compense le stigmate d’un sourire perpétuel, « particularité de sa physionomie » - devait s’emparer de lui, s’il ne pouvait plus opposer aux lecteurs qui se succèderont qu’un « je ne sais pas » lapidaire, comme les rares mots que Martin rend à ceux qui l’interrogent. Fussent-ils Royaux puisqu’il en est ainsi : la force perturbatrice du roman se fonde sur l’offrande qu’une vieille indigente tend à bout de bras, les mêmes que ceux que tend l’enfant, sur le passage du cortège. En une seconde, ravie par son sourire, déjà, un destin se noue : le petit rien du tout sera adopté par Marie-Antoinette. L’Autrichienne, Reine du Royaume de France. Passera d’une vie de gueux à celle, dorée, du Palais de Versailles, dans l’ombre de ceux que la Reine, en mal de maternité, a déjà accueillis, de ceux – dont un petit Noir, charmant – qu’on lui a offerts. Jusqu’à ce qu’elle se lasse, et les confie à d’autres : Martin, sans s’émouvoir, passera de mains en mains, de moins en moins nobles, jusqu’à grandir dans l’univers factice du Petit Trianon – initialement construit pour désennuyer le Roi – ramené à sa condition tout en en étant extrait : Martin, coqueluche permanente – « Tous sont sous le charme » - grandit à l’abri du besoin mais occupe le poste de vacher, à la « constance placide » : il observe le monde, la Nature, devine qu’elle n’est pas si originelle que ça mais ne se pose aucune espèce de question. Il vit au rythme, nous dit-on, du Ranz des vaches, qui n’a pas chez lui l’acception que lui donne Rousseau dans le Dictionnaire de la Musique[2] mais en suggère l’interprétation, puisque le roman ramène le philosophe de façon récurrente (huit fois, contre sept à Voltaire, belle revanche rétrospective !) : extirpé de son milieu, l’enfant se développe mieux qu’il l’aurait fait ailleurs, mais sa nature est profonde. Et se rappellera à lui. Il aurait, pu, Martin, rester au Petit Trianon, voir le théâtre des événements se dérouler hors de ses lieux et hors d’un temps que le destin royal a suspendu. Voir ses figures y évoluer, également : Richard Mique, intendant et contrôleur général des bâtiments et jardins de la Reine, Claude Richard, le jardinier-fleuriste du Roi, Valy et Marie Bussard, qui ont (peut-être) amené à Versailles le chant des bergers Suisses. Et, de temps à autre, comme une apparition, la Reine, qui tarde à reconnaître Martin, lequel lui rend – somptueux dialogue – un Oui Madame forcé à la question qu’elle lui pose. Le Roi, de loin, dans un douloureux contraste physique : « un homme simplement là, hésitant, gauche et emprunté, gras de figure, épais de lèvres et de bassin. »
Il faut d’abord encaisser - une deuxième fois – le sublimissime finale de « la vie volée de Martin Sourire », le nouveau roman de Christian Chavassieux, pour répondre à une question qu’il s’est récemment posée[1] : que dire de ce roman maintenant qu’il l’a écrit, et qu’il lui faut en parler ? Comme si le mutisme de son personnage – que compense le stigmate d’un sourire perpétuel, « particularité de sa physionomie » - devait s’emparer de lui, s’il ne pouvait plus opposer aux lecteurs qui se succèderont qu’un « je ne sais pas » lapidaire, comme les rares mots que Martin rend à ceux qui l’interrogent. Fussent-ils Royaux puisqu’il en est ainsi : la force perturbatrice du roman se fonde sur l’offrande qu’une vieille indigente tend à bout de bras, les mêmes que ceux que tend l’enfant, sur le passage du cortège. En une seconde, ravie par son sourire, déjà, un destin se noue : le petit rien du tout sera adopté par Marie-Antoinette. L’Autrichienne, Reine du Royaume de France. Passera d’une vie de gueux à celle, dorée, du Palais de Versailles, dans l’ombre de ceux que la Reine, en mal de maternité, a déjà accueillis, de ceux – dont un petit Noir, charmant – qu’on lui a offerts. Jusqu’à ce qu’elle se lasse, et les confie à d’autres : Martin, sans s’émouvoir, passera de mains en mains, de moins en moins nobles, jusqu’à grandir dans l’univers factice du Petit Trianon – initialement construit pour désennuyer le Roi – ramené à sa condition tout en en étant extrait : Martin, coqueluche permanente – « Tous sont sous le charme » - grandit à l’abri du besoin mais occupe le poste de vacher, à la « constance placide » : il observe le monde, la Nature, devine qu’elle n’est pas si originelle que ça mais ne se pose aucune espèce de question. Il vit au rythme, nous dit-on, du Ranz des vaches, qui n’a pas chez lui l’acception que lui donne Rousseau dans le Dictionnaire de la Musique[2] mais en suggère l’interprétation, puisque le roman ramène le philosophe de façon récurrente (huit fois, contre sept à Voltaire, belle revanche rétrospective !) : extirpé de son milieu, l’enfant se développe mieux qu’il l’aurait fait ailleurs, mais sa nature est profonde. Et se rappellera à lui. Il aurait, pu, Martin, rester au Petit Trianon, voir le théâtre des événements se dérouler hors de ses lieux et hors d’un temps que le destin royal a suspendu. Voir ses figures y évoluer, également : Richard Mique, intendant et contrôleur général des bâtiments et jardins de la Reine, Claude Richard, le jardinier-fleuriste du Roi, Valy et Marie Bussard, qui ont (peut-être) amené à Versailles le chant des bergers Suisses. Et, de temps à autre, comme une apparition, la Reine, qui tarde à reconnaître Martin, lequel lui rend – somptueux dialogue – un Oui Madame forcé à la question qu’elle lui pose. Le Roi, de loin, dans un douloureux contraste physique : « un homme simplement là, hésitant, gauche et emprunté, gras de figure, épais de lèvres et de bassin. »
La vie volée de Martin Sourire aurait pu être celle-ci, mais comme dans toute initiation, il faut un point de rupture, l’envie de dépasser les bordures. « Franchir le mur », aller là où s’exprime une opinion publique – « une nouveauté » - qui n’est pas favorable au Régime, c’est un euphémisme. Jusque là, apprend-on, Martin contemplait « un monde dont il n’est pas », tout en en étant. Même « remis à sa juste place », en vacher, comme persifle Armand, autre éphémère protégé de la Reine. En partant, puisque « Jésus a arrangé (s)on cas », il entre de plain-pied dans un pays qui a faim – les guerres d’Amérique ont ruiné le Royaume – et qui gronde (« le peuple, c’est le nombre et le nombre avait faim »). Martin devient témoin d’un Paris qui bruisse de colère et de mouvements, mais décide d’en être acteur, cette fois-ci : puisqu’ « il faut être à Paris pour prendre la mesure de la République », puisque les temps sont politiques, on suit les soubresauts de l’An 1789, la naissance des Etats généraux, les premières émeutes, la création d’une Assemblée Nationale, la fuite des nobles… Chavassieux romancier devient historien à part entière – l’idée qu’il se fait de la littérature dans son exigence et sa finalité –, raconte l’Histoire à travers celle qu’il écrit. Les références sont évidemment exactes, teintées, ici et là, d’un distant et sarrautien « c’est bien ça », ou d’une ironique rectification, sur le « ça ira ». Il y a une fonction référentielle dans le roman, sauf à être agrégé d’histoire – et encore, de la période – mais rien de pesant : on suit Martin dans ce qu’on nomme « l’opposé de Versailles », le style se modifie dans la deuxième partie, qui multiplie les descriptions et, par-delà, les énumérations, de l’immense pauvreté parisienne, d’une « Aria de la foule » qui se dessine, de cette exaltation, cette fraternité qu’il y trouve. Le récit se fait épique ou élégiaque : on sait l’écrivain capable d’envolées hugoliennes (dans « les Nefs de Pangée »[3]), poétiques et véristes à la fois (dans « l’Affaire des Vivants »[4]). Pour autant, la réussite de « Martin Sourire », c’est de poursuivre, sans coup férir, la vie de son personnage éponyme. Qu’on retrouve, dans une farandole de mets, dans les cuisines de Beauvilliers – premier homme de son siècle dans l’Art culinaire – au service d’Etienne-Louis Boullée, architecte utopiste qui permet à Chavassieux d’écrire, une fois encore, sur les bibliothèques (celle des Rois d’Ugarite, d’Assurbanipal, des Ptolémée, celles d’Hadrien… Relire « Mausolées », pour l’occasion) et les livres qui comptent[5], dans une vie. Et de vibrer avec Martin sur le projet de son protecteur. Qui les héberge, sa Marianne - Dieu qu’elle était jolie ! - et lui, contre menus services. Qui désespère, lui, de Rousseau, mais tient à ce que Martin - « qui n’est pas frustre » - se serve en livres et étudie ses plans de Bibliothèque Royale, un projet démesuré qui se heurtera hélas au « manque d’audace, (à) la médiocrité des esprits »… À peine le temps de suivre Martin dans des aventures égrenées par les saisons, les années et les ellipses qu’elles induisent et c’est la troisième et dernière partie du roman, « la grande sauvage », titre initial du manuscrit. Un choc littéraire, logorrhée consciente et maîtrisée que Martin destine, dans l’énonciation, à la femme qu’il aime et qui le voit revenir de quatre années passées en sans-culotte au service de la Nation. Par « élan révolutionnaire » et ce jusqu’en Vendée : jusqu’à ce que la question du Citoyen Lequinio – Elu de l’Assemblée Législative et Envoyé de la Convention – « sur ce qui se passait ici » déclenche un chapitre 8 torrentiel[6], « précipice devant ses pensées », salvateur dans ce qu’il détruit des illusions qui l’ont porté jusque là. Nonobstant, à chaque étape de son parcours, des rappels à sa condition fielleux : de Beauvilliers, qui lui glisse qu’il aurait fait, « au mieux, un excellent second » ; de Louis-Ange Pitou, qui lui assène un « vous n’êtes pas libre » quand Martin s’émancipe trop, à son goût, de ce qu’il doit à Marie-Antoinette… Ce qu’il lui doit, d’ailleurs, sans rien déflorer, c’est le sujet du roman lui-même : de la vie d’homme qu’elle a déterminée à celle qu’elle l’a laissé mener, seul, jusqu’à sa vérité singulière. Dans un pays que la raison a déserté (ce que se dit Richard Mique devant le Tribunal Révolutionnaire, aux six heures quotidiennes de Louison, la machine à raccourcir), « tout se peut », même être « avec les pires » et « charrier l’enfer jusqu’à la stupeur du Ciel ». Heureusement, in fine, les six jours fériés des sans-culottides…
Je dis depuis 2014 maintenant que « l’Affaire des Vivants » est un VRAI chef-d’œuvre de la littérature. Un de ces romans qui sortent une fois tous les trente ans. « La vie volée de Martin Sourire » est de cette lignée d’écriture : on est pris, captivé, entre densité du contexte et structure narrative impeccable, comme toujours. On peut faiblir, revenir, annoter, mais pas lâcher. S’il doute toujours de ce qu’il va bien pouvoir en dire aux lecteurs qui ne manqueront pas de le rencontrer, qu’il les laisse le remercier de ce qu’il est et de ce qu’il fait. On dira que c’est l’ami qui parle, mais ce sera idiot : l’ami que je suis en a perdu d’autres en disant – toujours – ce qu’il pense. Que l’imbécile qui m’a piqué dans ma boîte mon exemplaire de presse dédicacé se méfie, par contre : j’ai appris suffisamment de rituels sataniques dans cet ouvrage pour qu’il passe un mauvais moment, chat noir (salut, Gaïa ![7]) ou non.
[1] Kronix, le blog journalier de l’auteur, 9.01.2017
[2] « Ces effets, qui n’ont aucun lieu sur les étrangers, ne viennent que de l’habitude, des souvenirs, de mille circonstances qui, retracées par cet Air à ceux qui l’entendent, & leur rappelant leur pays, leurs anciens plaisirs, leur jeunesse & toutes leurs façons de vivre, excitent en eux un doute amer d’avoir perdu tout cela », Dictionnaire de la musique, 1768.
[3] Mnémos, 2015
[4] Phébus, 2014
[5] De la Bibliothèque Bleue, “littérature de colportage” aux oeuvres ésotériques, en passant par les récits antiques de Pausanias, les aventures de Télémaque de Fénelon : du fatum librorum à son pendant inverse.
[6] Aux intonations du « Baiser de la nourrice » (JP Huguet Editions, 2009) ?
[7] Le chat (noir) de mon fils, déesse grecque et féline, disparue le 28 août 2016, le même jour que mon père.
15:42 Publié dans Blog | Lien permanent

















































Les commentaires sont fermés.