19/06/2014
Start from the Back.

La réussite de Fergessen, je l’ai écrit mille fois, c’est cette technicité vocale et instrumentale d’une part, doublée d’une harmonie des voix, de l’énergie et du jeu de scène à nulle autre pareille. Mais Fergessen, c’est aussi l’armada humaine qu’ils arrivent à fédérer, dont une unité, hier, m’a conduit à considérer le concert de derrière, où je ne me trouvais pas, mais où j’ai croisé le chemin d’une jeune femme qui, de son propre aveu, a tout quitté pour les suivre et leur rendre l’intensité que leurs chansons lui ont donnée, dans une vie qui ne la satisfaisait plus et qu’elle remet à l’endroit, avec leur aide, leur soutien, en échange d’un abandon qui n’a rien de sordide, mais relève du choix, celui qu’on fait par amour. Quand on l’aborde, et qu’elle ne connaît pas, elle minimise son être, son importance, son rôle, mais en confiance, elle émet des idées, des propositions, des choses qui iraient dans le sens d’un élan qu’ils ne maîtrisent pas, dont ils ne peuvent avoir conscience. Elle fait la petite main, avec charme, élégance et discrets tatouages, propose des contraintes inédites dans les mots échangés, surtout un. C’est intéressant, une fois n’est pas coutume, de détourner son regard de la scène pour aller voir tout derrière, là où il n’y a plus personne, la regarder vivre son concert, en triturant sa médaille et en entonnant des refrains qu’elle connaît par cœur. On a envie de mieux la connaître, cette femme qui regrette d’avoir cédé à l’appel des Rolling Stones au SDF parce qu’ils lui ont fait rater Fergessen à Nancy, dans la configuration artistique qu’on regrette tous de ne pas avoir vue, mais qu’on attend pour l’hiver prochain, puisque ça s’annonce. De savoir ce qu’elle a réellement lâché dans sa vie, entre les renoncements qu’on a forcés chez elle et les lâcher-prises qu’elle a concédés. En partant, on se dit qu’elle méritait une note, pas de celle qu’on octroie pour valider un examen ou pas, mais quelque chose qu’on écrit, qui personnalise, et qui en dit plus sur ceux qu’elle a choisis que sur elle-même, au final. Un truc qui élude des moments forts, entre la Fergessenmania qui provoque ses premiers malaises chez Anne, qui s’écroule juste devant moi (par amour pour David ou parce qu’on lui a offert un Mars gratuit ?) ou la métaphysique toujours d’aplomb du duo, dans les transitions et dans ces paroles, dont on ressent le manque juste après qu’on les a entendues. Hier, au Fil, il y avait les trois hôtes des concerts du Home Sweet Tour du printemps, Joël, Yannick et Vincent, revenus en amis. Je regardais derrière, mais je n’ai rien raté. Du tout.
02:53 Publié dans Blog | Lien permanent
18/06/2014
Plus rien ne sera comme avant.
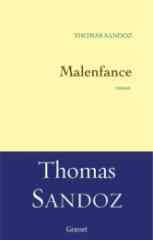 J’ai tourné de longs mois autour de Malenfance, de Thomas Sandoz. Pas parce que je n’avais pas envie de lire, au contraire, mais parce qu’il y a toujours une appréhension à l’idée d’aborder un Sandoz, depuis la Fanée, premier roman que j’ai lu de lui et que je classe – je le lui ai dit – comme un des meilleurs livres de ces dix dernières années. Malenfance, donc, et déjà, le lien, dans le titre, avec une culture alternative, avec Lenny Escudero, et l’impossibilité de ne pas rire, depuis le dernier Salon de Saint-Etienne, où j’ai donné à Thomas un exemplaire de ma partie de cache-cache, parce que je savais qu’il aimerait. Ce n’est pas de l’immodestie, simplement le sentiment, depuis une rencontre croisée à Sierre, que certains thèmes nous rapprochent : son personnage, Pouce, a l’âge des personnages de cache-cache - 11 ans – et si l’action est située en 1978, à l’âge même de ses 11 ans à lui, de mes 10 à moi, et si les repères temporels sont nombreux – les deux romans partageront donc l’Etalon noir, de Walter Farley – entre les pubs pour console Sega (c’est plus fort que toi), le Baron Empain, un ticket pour Barry Lyndon dans le caniveau, autant le dire sans rien dévoiler, il s’agit d’un leurre : parce que l’errance de Pouce - qui a raté le train qui devait le ramener chez lui en portant assistance à un chaton blessé, qu’il garde tout au long du roman contre lui – se fait dans une alternance des récits de la désagrégation familiale, la déliquescence des amours parentales, les carrières échouées de la mère et le silence du père, et d’un décor qui n’est pas le sien, qui l’éloigne de là où il devait aller. Etonnant croisement, dans le récit, entre l’univers naturel, doux, à coups d’énumérations horticoles, et le théâtre de zones industrielles abandonnées, d’arrière-cours, de cabanons hostiles et d’une population inquiétante. Progressivement, Pouce sort de l’enfance et, comme le lecteur, se cramponne à l’espoir d’une issue heureuse. Ce qui fait monter l’appréhension sus-nommée, puisque dans la Fanée, on s’accroche aussi à l’espoir que son adolescente rencontre quelqu’un qui la sauve, jusqu’à la dernière ligne. Les mêmes composantes familiales – cette mère qui comprend tout à l’envers - le même decorum sordide, Pouce, dans « Malenfance », n’est plus celui qui était tout pour ses parents, et craint les réactions à son retard autant que le lecteur, au fur et à mesure des 159 pages de ce roman étouffant. Le chat qu’il tient contre sa poitrine, qu’il protège des coups (des blousons noirs, des chiens de fermiers, des junkies, du spectre de la Fanée retrouvée), c’est lui, l’allégorie de l’innocence suppliciée, la malenfance. Le moment de la bascule, symbolique chez le psychologue Sandoz. Qui laisse le lecteur exsangue – tout mouillé, dit Frémiot – rendu au silence. On parle trop d’autres auteurs, et pas assez de Sandoz.
J’ai tourné de longs mois autour de Malenfance, de Thomas Sandoz. Pas parce que je n’avais pas envie de lire, au contraire, mais parce qu’il y a toujours une appréhension à l’idée d’aborder un Sandoz, depuis la Fanée, premier roman que j’ai lu de lui et que je classe – je le lui ai dit – comme un des meilleurs livres de ces dix dernières années. Malenfance, donc, et déjà, le lien, dans le titre, avec une culture alternative, avec Lenny Escudero, et l’impossibilité de ne pas rire, depuis le dernier Salon de Saint-Etienne, où j’ai donné à Thomas un exemplaire de ma partie de cache-cache, parce que je savais qu’il aimerait. Ce n’est pas de l’immodestie, simplement le sentiment, depuis une rencontre croisée à Sierre, que certains thèmes nous rapprochent : son personnage, Pouce, a l’âge des personnages de cache-cache - 11 ans – et si l’action est située en 1978, à l’âge même de ses 11 ans à lui, de mes 10 à moi, et si les repères temporels sont nombreux – les deux romans partageront donc l’Etalon noir, de Walter Farley – entre les pubs pour console Sega (c’est plus fort que toi), le Baron Empain, un ticket pour Barry Lyndon dans le caniveau, autant le dire sans rien dévoiler, il s’agit d’un leurre : parce que l’errance de Pouce - qui a raté le train qui devait le ramener chez lui en portant assistance à un chaton blessé, qu’il garde tout au long du roman contre lui – se fait dans une alternance des récits de la désagrégation familiale, la déliquescence des amours parentales, les carrières échouées de la mère et le silence du père, et d’un décor qui n’est pas le sien, qui l’éloigne de là où il devait aller. Etonnant croisement, dans le récit, entre l’univers naturel, doux, à coups d’énumérations horticoles, et le théâtre de zones industrielles abandonnées, d’arrière-cours, de cabanons hostiles et d’une population inquiétante. Progressivement, Pouce sort de l’enfance et, comme le lecteur, se cramponne à l’espoir d’une issue heureuse. Ce qui fait monter l’appréhension sus-nommée, puisque dans la Fanée, on s’accroche aussi à l’espoir que son adolescente rencontre quelqu’un qui la sauve, jusqu’à la dernière ligne. Les mêmes composantes familiales – cette mère qui comprend tout à l’envers - le même decorum sordide, Pouce, dans « Malenfance », n’est plus celui qui était tout pour ses parents, et craint les réactions à son retard autant que le lecteur, au fur et à mesure des 159 pages de ce roman étouffant. Le chat qu’il tient contre sa poitrine, qu’il protège des coups (des blousons noirs, des chiens de fermiers, des junkies, du spectre de la Fanée retrouvée), c’est lui, l’allégorie de l’innocence suppliciée, la malenfance. Le moment de la bascule, symbolique chez le psychologue Sandoz. Qui laisse le lecteur exsangue – tout mouillé, dit Frémiot – rendu au silence. On parle trop d’autres auteurs, et pas assez de Sandoz.
Grasset, 14,50€
12:51 Publié dans Blog | Lien permanent
17/06/2014
Demain.
J'ouvre une nouvelle catégorie, après la note sur l'absence de note: l'annonce de la note de demain. Parce que demain, je dirai du bien du superbe "Malenfance", de Thomas Sandoz. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui, alors? Parce qu'écrire sur ce livre est aussi éprouvant que de le lire. Une épreuve au sens mélioratif, quelque chose dont on sort grandi. En plus de ça, je dois interroger l'immodestie qui m'a conduit à penser, tout au long de l'ouvrage, à ma "partie de cache-cache", à moi. En mieux, bien sûr.
18:18 Publié dans Blog | Lien permanent
16/06/2014
Problématiques.
Je ne sais pas si l'on doit tout faire pour être heureux, mais je sais qu'on s'affaire suffisamment pour qu'on ne le soit pas: ça devient presqu'une question de principe, de fait.
18:16 Publié dans Blog | Lien permanent
15/06/2014
L'inconnue du Bac de Philo.
Demain, mon fils passe l'épreuve de philosophie, c'est en soi un événement. Evidemment, je ne peux m'empêcher de projeter mes inquiétudes sur lui, qui s'en accommode tant qu'il peut. Il se trouve que j'aimerais être à sa place, et profiter de nouveau de ces instants magiques - qui ne le sont pas pour les candidats - du temps qu'on accorde à l'esprit. Mais il ne faudrait pas que la mémoire s'arrange un peu trop de ses souvenirs: j'ai surtout passé les quatre heures qu'on m'a accordées à regarder cette jolie jeune fille qui planchait deux bureaux devant moi, dans l'allée d'à côté, à droite. Je la regardais, elle m'inspirait, elle était toutes celles à qui, jusque là, je n'avais jamais osé dire qu'elles me plaisaient, que je pouvais être intéressant et attentionné, en retour. J'avais dix-sept ans, et on me demandait d'être sérieux, sans l'antiphrase rimbaldienne? Allons bon. Il n'empêche - et ça, même ma mémoire ne me l'enlèvera pas - quinze jours après, peut-être, je retrouvai cette inconnue dans un concert, nous nous reconnûmes et, dans l'euphorie, échangeâmes de longs baisers langoureux sur fond de musique new-wave. Avant de nous quitter sans jamais nous revoir, sans que je sache jamais comment elle s'appelait. Peut-être surveillera-t-elle l'épreuve, demain.
17:39 Publié dans Blog | Lien permanent
14/06/2014
Fondre un câble.
Aujourd'hui, j'ai trouvé dans une brocante, en bas de chez moi, un ampli hi-fi haut de gamme, un Marantz, très bien entretenu, fonctionnant à merveille, qui me permettra d'optimiser l'écoute des milliers de disques que je garde chez moi. Le tout à un prix très raisonnable, au regard de ce que je comptais investir dans l'exercice. Seulement, il manquait un câble, que j'ai cherché partout, jusque dans les magasins de bricolage dans lesquels je ne vais JAMAIS, situés dans des centres commerciaux dans lesquels JE NE METS PAS LES PIEDS, le tout un samedi, JOUR INFERNAL DE SORTIE DES NEUNEUS. Pour le trouver sur Internet après avoir traversé la ville d'Est en Ouest.
16:08 Publié dans Blog | Lien permanent
13/06/2014
La plume, l'épée.
Que je demande à cet expert du krav maga de valider le récit d'une violente dispute, clé de bras à l'appui, dans "Aurélia Kreit" ne sous-entendait pas qu'il m'en fît la démonstration! Le statut de l'écrivain-reporter n'est pas de tout repos, pas plus que l'Ukraine d'aujourd'hui ne l'est davantage qu'il y a cent ans.
16:45 Publié dans Blog | Lien permanent
12/06/2014
Sphères mondiales.
La planète en ébullition, des dizaines de pays représentés, des champions qui n'en peuvent plus d'attendre de se confronter aux meilleurs, des outsiders qui se verraient bien créer la surprise, des fans qui préparent les apéros et les veillées, nul doute, le championnat inter-régional de billes sur sable va bientôt commencer, à Oléron.
18:53 Publié dans Blog | Lien permanent

















































