22/04/2011
Marjo', Alex, Esther, Esteban & les autres.
Je m'autorise une pause d'une semaine en Andalousie, cette région où j'aime à me retrouver. Je pars avec le livret de "Trop pas!", cette comédie musicale lycéenne dont le tour est enfin arrivé. Frédéric Dubois, un esthète dont l'abord de la musique m'a immédiatement marqué, a pris sa direction artistique en charge. L'homme est exigeant, et rigoureux. Il nous a ouvert, à Eric Hostettler et à moi, un carnet d'adresses conséquent, qui fera que, dès la première semaine de mai, notre petite pochade déjà remarquable entamera sa métamorphose. Chrysalide, papillon, toussa, comme on l'écrit sur les forums Internet. Marjo', notre héroïne, a les soucis de ses quinze ans et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Tout le monde le sait ici, 'tout menace de ruine un jeune homme"... Il sera temps, bientôt, de vous en dire plus, quand je verrai tout ce beau monde à l'oeuvre et que je n'aurai plus qu'à en tenir le journal du quotidien. Je suis impatient. Mais ma semaine espagnole m'attend. J'irai y déposer la promesse du Larrouquis à venir... Après tout, même si ce n'est rien, c'est déjà ça.
10:17 Publié dans Blog | Lien permanent
19/04/2011
Brouiller les pistes.
- C’est lui, tu crois ?
Sbigniew Konchalowziak désignait un petit homme nerveux, coiffé d’un tricorne, qui martelait d’une canne de jonc le sol d’un champ pierreux. Jonché de cadavres, dont certains convulsaient encore. Il s’adressait à Petrus Warziniaski, assis à même le sol, la kurtka déchirée, tenant la bride d’un cheval blessé au flanc. Le sang versait par flots, l’animal était terrifié, il n’allait pas tarder, lui aussi, à mettre un genou à terre. Mais si sa monture allait mourir, Petrus Warziniaski était bien vivant, il avait survécu à cette charge insensée décidée au petit matin. Ils savaient tous les deux que la route était trop encaissée pour qu’on y envoie les fantassins : en arrivant à portée des canons et des fusils, ils se feraient massacrer, et la colonne du centre ne serait pas protégée. Il fallait une action foudroyante, la cavalerie allait charger.
Konchalowziak et Warziniaski venaient de la banlieue de Lodz. Pour échapper à la mine, ils avaient décidé, bien que ne se connaissant pas, d’élever des chevaux. Des chevaux de trait, d’abord, qui coûtaient moins cher à l’entretien. Ils se sont rencontrés au comice agricole de Gdansk, l’un venant vendre, l’autre acheter. Ils auraient pu en rester là, mais sont devenus amis, se sont associés. Pas une fois ils ne se sont fâchés : tous les jours, ils s’occupaient de leurs bêtes, partageaient leurs repas et bientôt le même toit.
C’est Sbigniew qui a proposé à Petrus de se lancer dans l’élevage, pour les vendre à l’armée polonaise. Leur commerce a bien fonctionné, mais quand la foudre a fait brûler l’étable, que les trois géniteurs ont péri carbonisés, ils se sont enrôlés eux-mêmes. En y restant quelques années, s’étaient-ils dit, ils pourraient rembourser leurs créanciers et reprendre leur activité. De plus, ça ne les sortait pas des chevaux…
C’est vrai que la plupart des hommes du régiment n’avaient pas connu le feu. Que pour eux, l’Espagne serait un baptême. Ils étaient habitués à ce qu’on les regarde défiler, qu’on admire leur tenue d’apparat : habit de drap blanc, pantalons amarantes, double bande latérale blanche, czapska à pavillon, arête et galon blancs, bombe de cuir noir. Le sabre de cavalerie légère à garde de laiton à trois branches et fourreau de fer, dragonne blanche… Ils aimaient qu’on les regarde parce qu’ils faisaient corps avec leurs chevaux. Alors, quand le lieutenant Niegolewski leur a dit qu’ils allaient attaquer, ils se sont surtout inquiétés pour les bêtes, parce qu’elles allaient essuyer le feu, charger en pente sur les cailloux que les éboulis avaient laissés, risquer de se casser les pattes. Tous les cavaliers savent que sur un tel dénivelé, les chevaux peinent. Pourtant, il allait falloir le faire.
Ça a été l’enfer. Ils les ont tous vu tomber. Au premier coude, les quatre canons espagnols ont fauché le peloton de tête, le commandant Kozietluski en premier. Au fur et à mesure que les hommes et les bêtes chutaient, ceux de derrière les remplaçaient. Konchalowziak et Warziniaski avaient pour eux les innombrables courses de côte qu’ils avaient faites en campagne pour dresser les plus impétueux des chevaux. La vitesse était leur atout, la foulée déliée leur permettrait d’atteindre les servants, de les abattre avant qu’ils aient le temps de recharger. Au delà de la quatrième batterie, l’ouverture allait s’élargir, il suffisait d’atteindre ce cap, que le cheval comprenne que c’était le but à atteindre.
Quand les Espagnols ont fui, quand ils ont atteint le sommet, ils n’étaient plus qu’une cinquantaine sur les cent cinquante qui avaient chargé. Partout, c’était la désolation, les hurlements de ceux qui n’avaient pas eu la chance de mourir vite, les hennissements terrifiés des chevaux démembrés… Des cris mais des chants aussi, et pas de victoire. Des hommes rendus sourds par les canons fredonnaient des berceuses, erraient en haut de la colline quand la troupe d’élite est arrivée, quand le petit homme s’est fait aider pour descendre de cheval. Sbigniew Konchalowziak l’a vu le premier. Ce qui l’a le plus surpris, c’est la propreté de sa tenue. Cet homme pour qui des centaines de soldats venaient de mourir était immaculé, la mèche un peu rebelle peut-être. Dans l’hébétude générale, il apparaissait comme un sauveur : personne ne songeait à lui demander si ça valait bien la peine d’avoir fait tout ça.
Il est venu directement vers Niegolowski, l’a regardé dans les yeux. L’autre était à terre, il a voulu se redresser mais l’Empereur lui a dit de ne pas bouger. C’est lui qui s’est accroupi, tout le monde regardait la scène, il a enlevé sa croix, l’a épinglée sur la poitrine du lieutenant et lui a dit : « Vous êtes un brave. C’est vous qui porterez à Paris les drapeaux pris ici. ». Le soir, il dormait tranquillement à Buitrago, de l’autre côté de la sierra. Le lendemain, Konchalowziak, Warziniaski et les survivants – dont la plupart étaient blessés – eurent droit au chapeau bas du Grand Homme, qui les reconnut pour sa plus brave cavalerie, dignes de sa Garde. À ce moment précis, les pensées des deux paysans se croisèrent. Elles allaient vers les bêtes mortes de la démesure des hommes, vers les vallées désertiques du Boug, au moment du dégel, quand la terre est meuble, que les pas des chevaux l’épousent facilement et qu’ils ont eux l’impression de ne faire qu’un avec leur monture.
Extrait du Poignet d'Alain Larrouquis, à paraître prochainement, aux Editions Raison & Passions (Tous droits réservés).
00:37 Publié dans Blog, Livre | Lien permanent
18/04/2011
Devant le néant.
Personne n'attendant non plus mon avis sur rien, je reprends, en même temps que kronix, le cours de mes chroniques régulières. Rien n'avance, sur aucun des chantiers que je dois mener, et pourtant, j'ai des échéances. De celles dont on se convainc qu'elles sont importantes alors que, pas plus que ces billets d'humeur, elles ne sont attendues par personne d'autre que moi et les quelques-uns qui me font l'amitié de me prendre pour qui j'aimerais être. C'est confus.
Je n'ai jamais voulu personnaliser ce medium, indépendamment de mes activités littéraires. Je vais faire une exception, pour ceux qui n'auraient pas vu ce petit film sur d'autres réseaux. Mon fils de quinze ans poursuit son rêve d'absolu et de liberté. Il s'est essayé, après le parapente et avant le parachute, au saut à l'élastique, dans un cadre idyllique, avec un certain brio. C'est idiot d'être fier de ses enfants pour de mauvaises raisons; celle-ci est anodine, mais terriblement essentielle.
La semaine prochaine, je retrouve furtivement l'Andalousie; puis ce sera l'heure, enfin, de "Trop pas!". Là, le journal sera nourri, et quotidien.
16:13 Publié dans Blog | Lien permanent
09/04/2011
Excipit
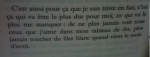 J'en termine, ces jours-ci, avec le PAL. Du moins le pense-je. C'est sa quatrième ou cinquième version, je crois qu'il est de la même veine que ses prédécesseurs. Du moins l'espère-je. Je pensais qu'il allait falloir que je lutte contre l'idée fausse que j'écris un livre par an. Mon "Larrouquis" marquera la fin d'une décennie d'écriture. Il faudra que je trouve la force de relancer la machine à créer puisque Aurélia m'attend, même si, depuis tout ce temps, elle sait encore se faire toute petite.
J'en termine, ces jours-ci, avec le PAL. Du moins le pense-je. C'est sa quatrième ou cinquième version, je crois qu'il est de la même veine que ses prédécesseurs. Du moins l'espère-je. Je pensais qu'il allait falloir que je lutte contre l'idée fausse que j'écris un livre par an. Mon "Larrouquis" marquera la fin d'une décennie d'écriture. Il faudra que je trouve la force de relancer la machine à créer puisque Aurélia m'attend, même si, depuis tout ce temps, elle sait encore se faire toute petite.
Je n'aurai pas eu à écrire sur la fatalité qui fait qu'un des autres moi-mêmes (ils sont rares mais ils sont pluriels) a subi une lourde opération. On a eu peur, on a craint, mais maintenant on est rassurés. L'opération "Trop pas!" va pouvoir commencer. Avec les premiers lilas blancs du mois d'avril.
19:20 Publié dans Blog | Lien permanent
03/04/2011
Juste après "Peindre".
 Hier avait lieu, au théâtre municipal de Roanne, la première et – pour le moment – unique représentation de « Peindre », une pièce issue des laboratoires de la Compagnie Nu, bien décidée à pratiquer le mélange des genres et la transversalité des disciplines artistiques. Ainsi, « peindre », plus qu’une pièce de théâtre, se veut réflexion sur l’acte même de création et interpénétration des spécialités, jusqu’à ce qu’elles ne fassent qu’une. Dans le jeu, outre le drame tel qu’il se joue et qu’il a été écrit, on trouve les photographies de Marc Bonnetin projetées en fond de scène et la composition sonore de Jérôme Bodon-Clair. Quatre fois deux mains, ça fait huit, si l’on rajoute les éclairages, on a le nombre impair nécessaire à toute création. Puisqu’il est acquis que la création est déséquilibre. Pourbus - un peintre dont le nom est emprunté au « chef d’œuvre inconnu », le texte de Balzac mettant en scène le jeune Nicolas Poussin et un Pourbus finissant, une oeuvre à partir de laquelle Rivette créera sa « Belle noiseuse »* - est entre deux âges « présent à la peinture » dans le lieu vaudou qui est l’atelier : « puisque le lieu de mon travail, c’est le temps que je me donne », assène-t-il, il considère son œuvre sous la double égide d’une voix off qui retranscrit spontanément la moindre de ses pensées et celle de E. incarnée sur scène par Nathalie Vincent. E. c’est à la fois la mauvaise conscience de Pourbus - qui trouve son atelier aussi raide qu’il peut l’être parfois et voudrait « oublier le spectacle de la douleur du monde » en dépliant une toile immense et vierge – et le double de la Muse qui, ressasse-t-il, l’a abandonné. Ils vont toréer ensemble tout au long de la pièce, elle est apparue par le haut, au bout d’un fil, tenu(e). Le texte de Chavassieux – puisque c’est de lui qu’il s’agit – prend place, par oppositions, souvent : pour Pourbus, l’inspiration, la création, sont, dans la même seconde, « présentes comme évanouies », « pleines et absentes ». Dans les blancs, dit-il, il y a la respiration calme et la sueur. Il prend la posture du peintre, absorbé, aspiré, campé devant la toile et ses géographies, il a « le temps entre les dents serré ». C’est un enfant, ajoute-t-il, « le monde est dans (s)a main", il joue avec mais dans le même temps, ajoute-t-il, il « travaille », « retrouve le sérieux de l’enfance ». En exergue de « la partie de cache-cache », se souvient-on, il y a cette phrase de Nietzsche : "la maturité de l'homme, c'est retrouver le sérieux qu'il mettait au jeu, étant enfant"...
Hier avait lieu, au théâtre municipal de Roanne, la première et – pour le moment – unique représentation de « Peindre », une pièce issue des laboratoires de la Compagnie Nu, bien décidée à pratiquer le mélange des genres et la transversalité des disciplines artistiques. Ainsi, « peindre », plus qu’une pièce de théâtre, se veut réflexion sur l’acte même de création et interpénétration des spécialités, jusqu’à ce qu’elles ne fassent qu’une. Dans le jeu, outre le drame tel qu’il se joue et qu’il a été écrit, on trouve les photographies de Marc Bonnetin projetées en fond de scène et la composition sonore de Jérôme Bodon-Clair. Quatre fois deux mains, ça fait huit, si l’on rajoute les éclairages, on a le nombre impair nécessaire à toute création. Puisqu’il est acquis que la création est déséquilibre. Pourbus - un peintre dont le nom est emprunté au « chef d’œuvre inconnu », le texte de Balzac mettant en scène le jeune Nicolas Poussin et un Pourbus finissant, une oeuvre à partir de laquelle Rivette créera sa « Belle noiseuse »* - est entre deux âges « présent à la peinture » dans le lieu vaudou qui est l’atelier : « puisque le lieu de mon travail, c’est le temps que je me donne », assène-t-il, il considère son œuvre sous la double égide d’une voix off qui retranscrit spontanément la moindre de ses pensées et celle de E. incarnée sur scène par Nathalie Vincent. E. c’est à la fois la mauvaise conscience de Pourbus - qui trouve son atelier aussi raide qu’il peut l’être parfois et voudrait « oublier le spectacle de la douleur du monde » en dépliant une toile immense et vierge – et le double de la Muse qui, ressasse-t-il, l’a abandonné. Ils vont toréer ensemble tout au long de la pièce, elle est apparue par le haut, au bout d’un fil, tenu(e). Le texte de Chavassieux – puisque c’est de lui qu’il s’agit – prend place, par oppositions, souvent : pour Pourbus, l’inspiration, la création, sont, dans la même seconde, « présentes comme évanouies », « pleines et absentes ». Dans les blancs, dit-il, il y a la respiration calme et la sueur. Il prend la posture du peintre, absorbé, aspiré, campé devant la toile et ses géographies, il a « le temps entre les dents serré ». C’est un enfant, ajoute-t-il, « le monde est dans (s)a main", il joue avec mais dans le même temps, ajoute-t-il, il « travaille », « retrouve le sérieux de l’enfance ». En exergue de « la partie de cache-cache », se souvient-on, il y a cette phrase de Nietzsche : "la maturité de l'homme, c'est retrouver le sérieux qu'il mettait au jeu, étant enfant"...
E. n’est pas tendre avec Pourbus. Au fur et à mesure que les scènes défilent, rythmées par les séquences sonores d’une contrebasse tendue et une scénographie épurée, jouant entre les drapés de la toile et des images en mouvement, elle le reprend, le contredit. Il doute de la mise à nu de son univers, dit qu’il peint « pour savoir ce que je veux faire avec la peinture », elle le relance : « tu sens cet espace ménagé pour toi ? ». L’interview, intermède burlesque dans l’introspection philosophique, ramène l’homme à toutes ses contradictions : le discours est rodé, il parle d’épure, de creux révélés, mais au final, il le dira plus tard dans une de ces insères comiques qui ponctuent la pièce :
- J’ai dit, ça, moi ? C’est stupide
- Oui ( répond E.)
- Je suis pudique
A E. qui, encore, trouve que ce blanc, décidément, « c’est l’auberge espagnole », Pourbus rétorque qu’il a trouvé dans le blanc originel une façon de retrouver son geste perdu, qu’un jour, il a compris « ce qu’était le fond ». Il passe, dit-il, par le Beau pour « arranger un monde dérangé », souligne le tragique qu’il y a dans la Beauté. Chavassieux glisse un peu de lui même et de Charon quand il fait dire à son peintre qu’il plonge « âme et sexe » dans son œuvre et demande à E. de comprendre « pourquoi je suis mal dans les vernissages ».
François Podetti, il est grand temps d’en parler, habite la fonction avec force. Il est la masse face au mouvement gracile de son daemon. Dans la mise à nu finale, que je ne dévoilerai pas, il revêt le blanc de la solitude et des regrets, se souvient qu’ « elle devinait les moments où il fallait me laisser seul ». Le père, équarisseur (dont le linge ensanglanté revenait étincelant sur l’étendage), et la mère, à qui plaisait les nus qu’il faisait, sont sollicités. Les voisins, aussi, les paysans pour qui un peintre n’est jamais que quelqu’un qui ne fait rien, ce que confirment et transmettent leurs enfants venus en atelier. Ils ne l’ont pas vu « en compagnie de l’humanité entière », lutter contre la tentation du retour à la figuration : « ce serait revenir dans un pays qu’on a quitté très jeune », souffle-t-il…
Alors, oui, on entend dire que le projet est très ambitieux, qu’il mériterait un traitement plus resserré, mais le jugement est imbécile, dirait René-Pierre Colin. Il faut avoir vu le public se concentrer sur une réflexion qui pose la question de ce qu’on fait de notre vie. Pourbus, comme Chavassieux, travaille « sans arrêt, de peur que la vie s’arrête ». Il veut créer « l’inverse du trou noir », E. veut le ramener au sourire qu’il avait quand il créait, celui « des bébés adressé à personne ». La scène devient une Pieta ensanglantée, les acteurs se subliment, sont sublimes. Les noms de peintres défilent en voix off, les questions (« Y’a pas de questions à se poser, y’a rien de magique, rien de sorcier ! ») défilent et s’éludent, Pourbus ne sait pas pourquoi, au final, lui entend et pas les autres.
« Peindre » n’échappe pas au politique et à l’idéalisme : l’Humanité, « les autres ». Le peintre a renoncé à contenir « la douleur du monde entier » dans son atelier, E. veut le persuader qu’il en est capable, de nouveau. On y verra la touche finale de l’auteur quand un spectateur sceptique se serait bien arrêté à l’apologie du (vrai) travail, celui que, souvent, la société ne reconnaît pas à celui qui s’y acharne, pourtant. Ce n’est pas important, le résultat est le même : il faut « recommencer », remettre l’ouvrage sur le métier. « Peindre » ne s’est joué qu’une seule fois, pour l’instant, mais c’est déjà un texte essentiel, qui brusquera sans doute les gens de théâtre. Il serait artistiquement criminel que l’aventure s’arrête là, ne serait-ce que pour voir la réflexion s’appliquer à elle-même.
Photo. Christian Verdet©
* Une des manifestations de l’optimisme de Chavassieux aura été de croire que tout le monde le savait.
17:31 Publié dans Blog | Lien permanent

















































