31/07/2021
153.
"Hier soir je repensais à la lecture de ton Aurelia tome 1, j'ai le souvenir d'un voyage sublime dans l'Est, au sein d'un groupe qui feint l'errance, ils sont bien plus déterminés que ce qu'on imagine. Je garde des images fortes de cette première partie du roman. De la seconde, en France, j'en garde, non pas le voyage, mais l'univers ouvrier. Encore merci pour ce souvenir bien au-delà d'une lecture que tu laisses. Les livres vont bien au-delà de l'apparence." H.d.P
11:05 Publié dans Blog | Lien permanent
30/07/2021
154.
07:43 Publié dans Blog | Lien permanent
29/07/2021
155.
 Je me suis longtemps demandé, à Agde, hier soir, si on n’était pas en pleines fêtes de Pâques tellement j’ai assisté, en plus d’un fabuleux concert, à une Résurrection, celle d’une des voix les plus marquantes de la chanson française. Onfray disait avant-hier, sur le Roquerols, que la chanson, genre populaire, allait beaucoup plus vite que la philosophie, et si Véronique Sanson est populaire, elle le doit sans doute plus à ses déboires qu’à sa linéarité (cherchez bien, le problème est dans les substantifs). J’appréhendais de la voir une nouvelle fois, la troisième sur trois décennies, après une tournée annulée il y a deux ans, et une maladie rendue publique puis vaincue, semble-t-il. Y a-t-il là rapport de cause à effet, la jeune septuagénaire est revenue sur la scène flottante pleine de vie, avec une voix revigorée comme jamais: le vibrato le plus célèbre de l’art mineur a aligné ses tubes et de nouvelles chansons pendant près de deux heures et comme souvent avec cet art-là, les souvenirs affleurent, et la mémoire se recrée: mon ami Richard Perret, immense comédien, alors serveur dans un restaurant dont j’étais le cuisinier - je n’invente rien - m’a dit un jour de 1990, alors que j’objectais une réserve : « Tu aimeras Véronique Sanson ». Jusque là je n’avais pas encore écouté ces morceaux mythiques que sont « Mi maître mi esclave » ou « le temps est assassin », qui m’ont tellement apporté, mais je n’aimais pas, déjà, le pan américain de la culture de ce petit bout de femme qui en a inspiré tellement d’autres, connues ou pas, par son absolue liberté, à commencer par celle de faire des erreurs. Hier, elle a époustouflé le public venu en masse par la qualité de son big band, d’outre-Atlantique, trois cuivres, trois choristes, une session rythmique à assécher l’Hérault et un guitariste à la Stephen Stills, pour la permanence. Son extraordinaire, au sens premier, pour un concert français. Et Véro, contente d’être là, de ces retrouvailles comme elle les appelle, qui sourit, s’amuse, propose de nouvelles chansons - dont une sur sa mère et une sur Simone Veil - essaie de se persuader qu’elles pourraient prendre le pas dans le cœur des gens de celles qu’ils attendent tous. Sa première entrée dans le passé, c’est avec « Je me suis tellement manquée » qu’elle le tente, un de ses textes les plus durs, malgré la note d’espoir finale : « je me suis pardonnée ». Là, l’évidence se fait: sa voix est supérieure en qualité aux concerts qu’elle faisait il y a vingt ans, et c’est peut-être pour ça qu’elle la rechante, parce que tout ce qui l’a brisée est derrière elle. Trois très jeunes filles dansent sur des chansons qu’elles ont dû apprendre de leurs mères, et touchent le Graal quand le Big Band entonne « Chanson sur ma drôle de vie », que le film « Tout ce qui brille » a remise en lumière. C’est fascinant de pouvoir encore entendre ces morceaux de patrimoine, qui sont venus sans prévenir, en un éclair de trente ans d’âge, et « Amoureuse » renvoie tout le monde à ses émois d’adolescent, à cette volonté, souvent, de vouloir partir, ailleurs. Il y a un entracte, pendant lequel les percussionnistes jouent avec le public et Véro réapparaît sur un bateau, pour un Bernard’s Song stratosphérique: les cuivres et la basse sont tellement énormes qu’on se croirait au MSG, pas sur une scène flottante. « Il est de nulle part », peut-être, mais le public est ravi, étymologiquement. Il y aura encore, en rappel, « ma révérence » qu’on s’est si souvent vu tirer, là encore, et les larmes suffisent. Mes titres-phares ne seront pas joués mais le Bahia final est à tomber, entonné par 5000 voix conquises, jusque tard le soir, ou là, dans la nuit, encore. Je pensais venir au dernier de mes rendez-vous avec Véronique Sanson, mais la beauté du moment vécu me redonne le choix, c’est un privilège immense. À la mesure de l’élégie à laquelle elle a consacré sa vie.
Je me suis longtemps demandé, à Agde, hier soir, si on n’était pas en pleines fêtes de Pâques tellement j’ai assisté, en plus d’un fabuleux concert, à une Résurrection, celle d’une des voix les plus marquantes de la chanson française. Onfray disait avant-hier, sur le Roquerols, que la chanson, genre populaire, allait beaucoup plus vite que la philosophie, et si Véronique Sanson est populaire, elle le doit sans doute plus à ses déboires qu’à sa linéarité (cherchez bien, le problème est dans les substantifs). J’appréhendais de la voir une nouvelle fois, la troisième sur trois décennies, après une tournée annulée il y a deux ans, et une maladie rendue publique puis vaincue, semble-t-il. Y a-t-il là rapport de cause à effet, la jeune septuagénaire est revenue sur la scène flottante pleine de vie, avec une voix revigorée comme jamais: le vibrato le plus célèbre de l’art mineur a aligné ses tubes et de nouvelles chansons pendant près de deux heures et comme souvent avec cet art-là, les souvenirs affleurent, et la mémoire se recrée: mon ami Richard Perret, immense comédien, alors serveur dans un restaurant dont j’étais le cuisinier - je n’invente rien - m’a dit un jour de 1990, alors que j’objectais une réserve : « Tu aimeras Véronique Sanson ». Jusque là je n’avais pas encore écouté ces morceaux mythiques que sont « Mi maître mi esclave » ou « le temps est assassin », qui m’ont tellement apporté, mais je n’aimais pas, déjà, le pan américain de la culture de ce petit bout de femme qui en a inspiré tellement d’autres, connues ou pas, par son absolue liberté, à commencer par celle de faire des erreurs. Hier, elle a époustouflé le public venu en masse par la qualité de son big band, d’outre-Atlantique, trois cuivres, trois choristes, une session rythmique à assécher l’Hérault et un guitariste à la Stephen Stills, pour la permanence. Son extraordinaire, au sens premier, pour un concert français. Et Véro, contente d’être là, de ces retrouvailles comme elle les appelle, qui sourit, s’amuse, propose de nouvelles chansons - dont une sur sa mère et une sur Simone Veil - essaie de se persuader qu’elles pourraient prendre le pas dans le cœur des gens de celles qu’ils attendent tous. Sa première entrée dans le passé, c’est avec « Je me suis tellement manquée » qu’elle le tente, un de ses textes les plus durs, malgré la note d’espoir finale : « je me suis pardonnée ». Là, l’évidence se fait: sa voix est supérieure en qualité aux concerts qu’elle faisait il y a vingt ans, et c’est peut-être pour ça qu’elle la rechante, parce que tout ce qui l’a brisée est derrière elle. Trois très jeunes filles dansent sur des chansons qu’elles ont dû apprendre de leurs mères, et touchent le Graal quand le Big Band entonne « Chanson sur ma drôle de vie », que le film « Tout ce qui brille » a remise en lumière. C’est fascinant de pouvoir encore entendre ces morceaux de patrimoine, qui sont venus sans prévenir, en un éclair de trente ans d’âge, et « Amoureuse » renvoie tout le monde à ses émois d’adolescent, à cette volonté, souvent, de vouloir partir, ailleurs. Il y a un entracte, pendant lequel les percussionnistes jouent avec le public et Véro réapparaît sur un bateau, pour un Bernard’s Song stratosphérique: les cuivres et la basse sont tellement énormes qu’on se croirait au MSG, pas sur une scène flottante. « Il est de nulle part », peut-être, mais le public est ravi, étymologiquement. Il y aura encore, en rappel, « ma révérence » qu’on s’est si souvent vu tirer, là encore, et les larmes suffisent. Mes titres-phares ne seront pas joués mais le Bahia final est à tomber, entonné par 5000 voix conquises, jusque tard le soir, ou là, dans la nuit, encore. Je pensais venir au dernier de mes rendez-vous avec Véronique Sanson, mais la beauté du moment vécu me redonne le choix, c’est un privilège immense. À la mesure de l’élégie à laquelle elle a consacré sa vie.
02:27 | Lien permanent
28/07/2021
156.
 Le principe de la philosophie étant de s’exprimer sur la place publique, à la portée de tous, il y avait des raisons réelles de douter de l’opportunité de la venue de Michel Onfray sur l’esplanade du Roquerols, à l’occasion d’un centenaire Brassens dont on peut regretter – quelles que soient les bonnes volontés – qu’il ne fût pas si populaire que l’aurait certainement voulu le célébré. Le prix des places fixe toujours la sociologie du public, et il y avait de l’ironie (voltairienne) à voir les têtes chenues de l’île singulière venir écouter le remueur d’idées traiter d’un Brassens libertaire. Vite assimilé, dans l’imaginaire collectif, à l’anarchie de droite, qui n’a rien d’économique mais privilégie l’individu et ses valeurs à l’illusion collective. Onfray, en renard des plateaux rompu à la rhétorique, construisant son raisonnement par le langage, commence par la déconstruction, quand Bernard Lonjon met en perspective son œuvre et celle de Brassens, rappelle que La Boétie a 17 ans quand il écrit « le discours sur la servitude volontaire » et assène, déjà, que rien ne restera de ce que lui a fait. Préciosité ? Non, simplement parce que pour comprendre les traces qu’on a laissées, pour décoder les livres, il faut avoir appris à décoder et que ce n’est plus d’actualité : il faut une culture qui n’existe plus, ce sera son credo d’athée post-chrétien. Et le premier Exocet envoyé à Emmanuel Macron, sa cible préférée : il rappelle que le Président actuel a obtenu une maîtrise de philosophie, mais que son directeur de mémoire, Etienne Balibar ne s’en souvenait même plus ! C’est gratuit, mais ça soulage, et c’est le principe d’Onfray, l’exigence permanente qui l’a perdu médiatiquement, parce qu’il met l’appareil médiatique en face de ses manquements culturels, de Léa Salamé à Cyril Hanouna : qui peut décoder, encore, l’ironie de Voltaire, l’intelligence subtile de Montaigne, le politique dans l’œuvre romanesque d’Hugo, questionne-t-il, rappelant que l’école républicaine dont il est issu doit apprendre aux élèves à disposer d’un jugement avant d’apprendre bêtement, mais usant de l’exemple de son père, ouvrier agricole, capable de mémoriser des dizaines de poèmes et de s’en vouloir d’avoir confondu deux auteurs contemporains. Onfray attaque rapidement, use de l’effet-miroir avec son interlocuteur pour le traiter ironiquement de fasciste, de réactionnaire, de vendu à la solde du capital histoire d’évacuer les procès qui lui sont faits pour mieux aborder les thèmes qui lui sont chers, sa Gauche old school et la manifestation de la vérité, via l’Histoire, celle qu’on travaille, pas celle qu’on reçoit toute faite. Il évoque ses émotions d’enfant lorsque, dans une famille où la culture n’existait pas, il entendait Brassens, dans la Citroën paternelle, faire danser la langue française. Se réjouissait d’apprendre de nouveaux mots, vite cherchés dans le dictionnaire, d’entendre l’intelligence s’exprimer dans un genre populaire, abordable. Il insiste sur la distinction entre démocratie et démagogie, la seconde prétendant s’abaisser au niveau des plus faibles quand la première a l’espoir de les élever. Élever un enfant, dit-il, c’est le faire grimper le plus haut possible, dans un pays partagé, à son époque, entre Aragon et Bernanos, les cocos et les cathos. Onfray est de gauche, profondément, et croit en l’éducation populaire : le sale gosse qu’il était (la Mauvaise réputation, c’est mon affaire !) a reçu l’aide et l’enseignement, au sens propre, d’instituteurs, de surgés, lesquels ne l’ont pas jugé quand ils ont compris qu’il ne ferait rien comme les autres. Il rit des syllogismes qui font de lui, parce qu’il ne partage pas le catéchisme bêlant d’une partie de la gauche un homme de droite, donc d’extrême-droite et, après tout, allons-y, un antisémite, un nazi, un ennemi de classe. Il parle de Brassens comme d’un libertaire écrasé par le rouleau compresseur marxiste, lequel marxisme s’est empressé de réduire la gauche libertaire au rang de porteuse de valises : quand Proudhon refuse, parce qu’il a sa propre pensée, de devenir le secrétaire général de Marx, Marx écrit une « Misère de la philosophie » éreintant la « Philosophie de la misère » du premier, rappelle-t-il. Il préfèrera toujours la Commune qui brûle les guillotines à la Révolution française, bourgeoise et contre le peuple, qui les construit. Conchie les Versaillais qui feront des émules, de François Mitterrand à Manuel Valls, jusqu’à l’autre Manu, l’enfant-roi. Ça dézingue, chez Onfray, et ça n’est pas fini : les communistes en prendront pour leur grade, de la dictature du prolétariat qui conduit à mener une partie du prolétariat à l’asservissement de l’autre jusqu’à la relecture de la résistance communiste, effective, puisqu’il faut faire de l’histoire, après la rupture du pacte germano-soviétique, seulement. Avant, les prolétariats français et allemands prônaient la destruction des mêmes ennemis, souvent Juifs ou Francs-Maçons. Et cette crapule d’Aragon émettait l’enthymème suprême, lors du procès Nizan, arguant qu’un écrivain qui écrit sur les traitres ne pouvait être qu’un traitre lui-même. Quelle jubilation d’entendre Onfray sous-entendre que la balle qui a tué l’auteur des Chiens de Garde n’était peut-être pas venue de l’ennemi… Tout à sa quête de défendre la vérité, fût-elle dans le camp adverse, de ne pas confondre la liberté et la licence, il déconstruit aussi le mythe récent de Guy Môquet – qui distribuait des tracts défaitistes visant à convaincre des bienfaits de la collaboration – et refait l’éloge de la pensée libertaire. Cite Camus qui dit que si la vérité était de droite, alors il le serait aussi. Renvoie dos à dos les résistants et les collabos, comme dans « les deux oncles » quand les premiers sont de la dernière heure. Onfray, à trois fois vingt ans – l’âge auquel on voit la vie en noir et blanc, les couleurs arrivant tardivement - a poli son diamant, affiné son trajet : il sait que la pensée libertaire est subtile, passe, comme chez Brassens, par les copains, la guitare, les pâtes et les femmes, sollicite l’horizon indépassable de la Gauche, distingue l’idéal de Mai 68 des larrons de soixante-huitards, pédophiles avérés, fils de bourgeois dont les fils reprendront les places. Les pédagogues qui prônent que la langue est fasciste et ont contribué à son effondrement. Il donne des noms, qu’on connaît tous, se fout de se faire des amis puisqu’il faut faire de l’histoire. Le maître mot de la soirée, finalement. Il a parlé plusieurs fois de son père, comme dans Antoine Bloyé. Résume Proudhon à la belle allégorie de l’aubaine, quand deux-cents hommes ont érigé l’obélisque de la Concorde en une heure alors qu’un homme, en deux cents heures, n’aurait rien pu faire. Les exploitants y ont vu une aubaine, celle de payer chaque homme une heure seulement, en dénaturant la force collective du travail. Il le voit comme ça, le contrat libertaire, dans le couple, au travail, en amitié ou ailleurs : donner à l’autre sans rien attendre, espérer qu’il fasse de même. Ne plus rien solliciter d’une force régalienne, mais prôner le circuit court, la solidarité, l’échange et le don. Défendre tous les patrimoines, quels qu’ils soient. Il préfère Hobbes à Rousseau, mais rappelle que dans le Contrat social, la liberté, c’est l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite. Il est aussi enthousiaste et dithyrambique sur la force individuelle qu’il est sombre sur l’avenir des civilisations, en l’absence – définitive – de morale. Dans ce contrat libertaire, qui me parle, il faut être au centre de soi-même, pas par égoïsme, mais en conscience de ce qu’on peut apporter. Le vrai discours que la gauche devrait tenir, et que ses représentants ne tiennent pas. Il s’est passé trois heures, devant le Roquerols, les réactions sont nombreuses, il ne répond pas forcément, revient sur des antiennes, montre les dents (ironie mordante) avec une femme qui n’écoute pas la réponse à la question qu’elle lui a posée. Les bourgeois sétois se sont acoquinés et rentrent chez eux ragaillardis, rajeunis de quarante ans. Ils n’en garderont rien le lendemain, mais ça n’est pas grave : ça n’est que bien longtemps après que la philosophie porte ses fruits, le plus souvent au moment de se demander ce qu’on a réellement fait de sa vie. Le Michel Onfray d’hier s’est demandé comment s’en sortirait le M.O d’il y a 52 ans, aujourd’hui. Sans doute très mal, de son propre aveu. Il n’empêche, par-delà le Bien et le Mal (E.M & M.L.P), c’est un souffle nietzschéen qui s’est posé sur l’esplanade, hier : « la maturité de l’homme, cela veut dire retrouver le sérieux qu’on avait au jeu, étant enfant ».
Le principe de la philosophie étant de s’exprimer sur la place publique, à la portée de tous, il y avait des raisons réelles de douter de l’opportunité de la venue de Michel Onfray sur l’esplanade du Roquerols, à l’occasion d’un centenaire Brassens dont on peut regretter – quelles que soient les bonnes volontés – qu’il ne fût pas si populaire que l’aurait certainement voulu le célébré. Le prix des places fixe toujours la sociologie du public, et il y avait de l’ironie (voltairienne) à voir les têtes chenues de l’île singulière venir écouter le remueur d’idées traiter d’un Brassens libertaire. Vite assimilé, dans l’imaginaire collectif, à l’anarchie de droite, qui n’a rien d’économique mais privilégie l’individu et ses valeurs à l’illusion collective. Onfray, en renard des plateaux rompu à la rhétorique, construisant son raisonnement par le langage, commence par la déconstruction, quand Bernard Lonjon met en perspective son œuvre et celle de Brassens, rappelle que La Boétie a 17 ans quand il écrit « le discours sur la servitude volontaire » et assène, déjà, que rien ne restera de ce que lui a fait. Préciosité ? Non, simplement parce que pour comprendre les traces qu’on a laissées, pour décoder les livres, il faut avoir appris à décoder et que ce n’est plus d’actualité : il faut une culture qui n’existe plus, ce sera son credo d’athée post-chrétien. Et le premier Exocet envoyé à Emmanuel Macron, sa cible préférée : il rappelle que le Président actuel a obtenu une maîtrise de philosophie, mais que son directeur de mémoire, Etienne Balibar ne s’en souvenait même plus ! C’est gratuit, mais ça soulage, et c’est le principe d’Onfray, l’exigence permanente qui l’a perdu médiatiquement, parce qu’il met l’appareil médiatique en face de ses manquements culturels, de Léa Salamé à Cyril Hanouna : qui peut décoder, encore, l’ironie de Voltaire, l’intelligence subtile de Montaigne, le politique dans l’œuvre romanesque d’Hugo, questionne-t-il, rappelant que l’école républicaine dont il est issu doit apprendre aux élèves à disposer d’un jugement avant d’apprendre bêtement, mais usant de l’exemple de son père, ouvrier agricole, capable de mémoriser des dizaines de poèmes et de s’en vouloir d’avoir confondu deux auteurs contemporains. Onfray attaque rapidement, use de l’effet-miroir avec son interlocuteur pour le traiter ironiquement de fasciste, de réactionnaire, de vendu à la solde du capital histoire d’évacuer les procès qui lui sont faits pour mieux aborder les thèmes qui lui sont chers, sa Gauche old school et la manifestation de la vérité, via l’Histoire, celle qu’on travaille, pas celle qu’on reçoit toute faite. Il évoque ses émotions d’enfant lorsque, dans une famille où la culture n’existait pas, il entendait Brassens, dans la Citroën paternelle, faire danser la langue française. Se réjouissait d’apprendre de nouveaux mots, vite cherchés dans le dictionnaire, d’entendre l’intelligence s’exprimer dans un genre populaire, abordable. Il insiste sur la distinction entre démocratie et démagogie, la seconde prétendant s’abaisser au niveau des plus faibles quand la première a l’espoir de les élever. Élever un enfant, dit-il, c’est le faire grimper le plus haut possible, dans un pays partagé, à son époque, entre Aragon et Bernanos, les cocos et les cathos. Onfray est de gauche, profondément, et croit en l’éducation populaire : le sale gosse qu’il était (la Mauvaise réputation, c’est mon affaire !) a reçu l’aide et l’enseignement, au sens propre, d’instituteurs, de surgés, lesquels ne l’ont pas jugé quand ils ont compris qu’il ne ferait rien comme les autres. Il rit des syllogismes qui font de lui, parce qu’il ne partage pas le catéchisme bêlant d’une partie de la gauche un homme de droite, donc d’extrême-droite et, après tout, allons-y, un antisémite, un nazi, un ennemi de classe. Il parle de Brassens comme d’un libertaire écrasé par le rouleau compresseur marxiste, lequel marxisme s’est empressé de réduire la gauche libertaire au rang de porteuse de valises : quand Proudhon refuse, parce qu’il a sa propre pensée, de devenir le secrétaire général de Marx, Marx écrit une « Misère de la philosophie » éreintant la « Philosophie de la misère » du premier, rappelle-t-il. Il préfèrera toujours la Commune qui brûle les guillotines à la Révolution française, bourgeoise et contre le peuple, qui les construit. Conchie les Versaillais qui feront des émules, de François Mitterrand à Manuel Valls, jusqu’à l’autre Manu, l’enfant-roi. Ça dézingue, chez Onfray, et ça n’est pas fini : les communistes en prendront pour leur grade, de la dictature du prolétariat qui conduit à mener une partie du prolétariat à l’asservissement de l’autre jusqu’à la relecture de la résistance communiste, effective, puisqu’il faut faire de l’histoire, après la rupture du pacte germano-soviétique, seulement. Avant, les prolétariats français et allemands prônaient la destruction des mêmes ennemis, souvent Juifs ou Francs-Maçons. Et cette crapule d’Aragon émettait l’enthymème suprême, lors du procès Nizan, arguant qu’un écrivain qui écrit sur les traitres ne pouvait être qu’un traitre lui-même. Quelle jubilation d’entendre Onfray sous-entendre que la balle qui a tué l’auteur des Chiens de Garde n’était peut-être pas venue de l’ennemi… Tout à sa quête de défendre la vérité, fût-elle dans le camp adverse, de ne pas confondre la liberté et la licence, il déconstruit aussi le mythe récent de Guy Môquet – qui distribuait des tracts défaitistes visant à convaincre des bienfaits de la collaboration – et refait l’éloge de la pensée libertaire. Cite Camus qui dit que si la vérité était de droite, alors il le serait aussi. Renvoie dos à dos les résistants et les collabos, comme dans « les deux oncles » quand les premiers sont de la dernière heure. Onfray, à trois fois vingt ans – l’âge auquel on voit la vie en noir et blanc, les couleurs arrivant tardivement - a poli son diamant, affiné son trajet : il sait que la pensée libertaire est subtile, passe, comme chez Brassens, par les copains, la guitare, les pâtes et les femmes, sollicite l’horizon indépassable de la Gauche, distingue l’idéal de Mai 68 des larrons de soixante-huitards, pédophiles avérés, fils de bourgeois dont les fils reprendront les places. Les pédagogues qui prônent que la langue est fasciste et ont contribué à son effondrement. Il donne des noms, qu’on connaît tous, se fout de se faire des amis puisqu’il faut faire de l’histoire. Le maître mot de la soirée, finalement. Il a parlé plusieurs fois de son père, comme dans Antoine Bloyé. Résume Proudhon à la belle allégorie de l’aubaine, quand deux-cents hommes ont érigé l’obélisque de la Concorde en une heure alors qu’un homme, en deux cents heures, n’aurait rien pu faire. Les exploitants y ont vu une aubaine, celle de payer chaque homme une heure seulement, en dénaturant la force collective du travail. Il le voit comme ça, le contrat libertaire, dans le couple, au travail, en amitié ou ailleurs : donner à l’autre sans rien attendre, espérer qu’il fasse de même. Ne plus rien solliciter d’une force régalienne, mais prôner le circuit court, la solidarité, l’échange et le don. Défendre tous les patrimoines, quels qu’ils soient. Il préfère Hobbes à Rousseau, mais rappelle que dans le Contrat social, la liberté, c’est l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite. Il est aussi enthousiaste et dithyrambique sur la force individuelle qu’il est sombre sur l’avenir des civilisations, en l’absence – définitive – de morale. Dans ce contrat libertaire, qui me parle, il faut être au centre de soi-même, pas par égoïsme, mais en conscience de ce qu’on peut apporter. Le vrai discours que la gauche devrait tenir, et que ses représentants ne tiennent pas. Il s’est passé trois heures, devant le Roquerols, les réactions sont nombreuses, il ne répond pas forcément, revient sur des antiennes, montre les dents (ironie mordante) avec une femme qui n’écoute pas la réponse à la question qu’elle lui a posée. Les bourgeois sétois se sont acoquinés et rentrent chez eux ragaillardis, rajeunis de quarante ans. Ils n’en garderont rien le lendemain, mais ça n’est pas grave : ça n’est que bien longtemps après que la philosophie porte ses fruits, le plus souvent au moment de se demander ce qu’on a réellement fait de sa vie. Le Michel Onfray d’hier s’est demandé comment s’en sortirait le M.O d’il y a 52 ans, aujourd’hui. Sans doute très mal, de son propre aveu. Il n’empêche, par-delà le Bien et le Mal (E.M & M.L.P), c’est un souffle nietzschéen qui s’est posé sur l’esplanade, hier : « la maturité de l’homme, cela veut dire retrouver le sérieux qu’on avait au jeu, étant enfant ».
01:52 Publié dans Blog | Lien permanent
27/07/2021
157.
Le syllogisme remplace l’argument, l’illusion de la raison fait la raison, l’interlocuteur est déconsidéré avant même qu’il ait parlé, tout est en place pour l’abrutissement des masses, et l’agonie des amitiés.
00:46 Publié dans Blog | Lien permanent
26/07/2021
158.
Chaque année le même rituel: cet ami de 35 ans qui vit au bout du monde depuis longtemps, qui passe me voir tous les étés comme il va voir d’autres de ses proches et que je quitte dans un train, lui poursuivant moi descendant. Avec la même angoisse qui monte au fur et à mesure que la gare approche: que serons-nous devenus dans un an?
07:27 Publié dans Blog | Lien permanent
25/07/2021
159.
Le terme de besogneux fit débat, jusqu’à l’étymologie.
07:52 Publié dans Blog | Lien permanent
24/07/2021
160.
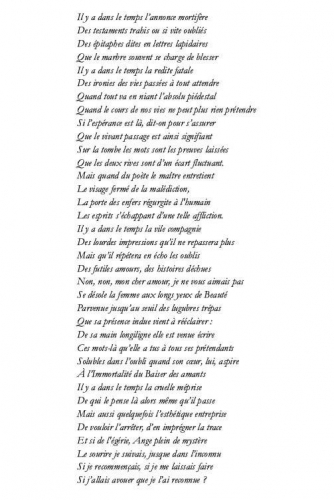
08:48 | Lien permanent

















































