15/07/2021
169.
Ce monde n'est pas le mien.
07:44 | Lien permanent
14/07/2021
170.
Le rêve de la nuit est atroce et complexe : un chanteur que j'admire est assassiné, le jour de son mariage, par une fan dérangée - et je m'y connais - qui défenestre son cadavre devant la foule horrifiée. Dans le même temps, choquée au plus haut point, une personne âgée de ma famille fait une crise cardiaque, et meurt dans mes bras, alors qu'un ancien élève révèle que la meurtrière est sa mère et que justice est faite! Le tout dans un jardin de Toscane, des décors shakespeariens d'un Songe d'une nuit d'été. Il est temps que j'arrête d'écouter cet homme, ça risque de lui porter la poisse.
10:48 Publié dans Blog | Lien permanent
13/07/2021
171.
J’ai besoin de beauté, j’ai besoin qu’on me dise
Qu’il y a autre chose que la sombre méprise
Je veux qu’on m’aime encore pour tout ce que je suis
Et qu’on m’idéalise, cristallisé, épris
J’ai besoin de beauté, je veux qu’on me susurre
D’une voix qui se noue et dit dans un murmure:
Et comment va ta vie, oui, comment va ta vie?
Je veux rêver encore de ce lien permanent
Qui fait qu’on se projette, ensemble et infini
Vers un autre horizon, délesté des tourments.
07:46 | Lien permanent
12/07/2021
172.
J’ai besoin de beauté et de sérénité
J’ai besoin de pouvoir à nouveau respirer
Sortir de l’hébétude, et de l’humiliation
Être à nouveau aimée, sans plus de concession
J’ai besoin d’une épaule, au bout de quarante ans
D’un homme qui toujours est resté mon amant
Le témoin viscéral de mes belles années
Qui me fera penser, au soir du crépuscule
Que la beauté fut là, qu’on me l’a destinée
Comme on laisse un récit sans omettre une virgule.
07:25 | Lien permanent
11/07/2021
173.
La mélancolie, c’est comme la mort dans les campagnes: on n’en parle pas parce qu’on a peur que ça la fasse venir.
10:21 Publié dans Blog | Lien permanent
10/07/2021
174.
 À ce niveau-là, ça n’est plus de la chronique, mais un journal de bord. À peine trois semaines après les avoir vus, à la Casa, inaugurer ISQLAF (Il semblerait que l’amour fut), leur nouvel album, double galette qui raconte une histoire, celle d’un monde duquel l’amour serait radié, pourchassé, désigné comme le virus le plus redoutable pour l’espèce humaine. Un album à tiroirs, comme toujours avec Petrier, une dystopie dans laquelle des êtres organisent une résistance, une fuite orchestrée, vinyles à l’appui. Cet album, le Voyage de Noz le défendait pour la deuxième fois, dans les jardins de l’Institut Lumière, au cours d’un festival qui alignait quatre groupes, en plein air, face au soleil rasant d’une belle soirée d’été. Il avait beau avoir aligné la veste et le pantalon de costume, il n’a pas été à la noce, Petrier, pas plus que ses camarades, le Jedi Desprat aux manettes luttant pour installer un son correct et eux se démenant contre les perles de sueur et les petits ratés de micro, dans les premiers morceaux, pour enfin aligner les chansons du dernier opus, et rien que celles-ci, ce qui est une excellente idée : ça évite les trous de mémoire, et la dispersion narrative. Le titre éponyme, qui ouvre le set, pose le fameux spectre musical despratien, son lourd, grosse session rythmique, nappes de synthé, guitares aériennes et performance vocale, avec une énumération des villes du monde dans lesquelles, partout dans les rues, il semblerait que l’amour fut. Stéphane a vite tombé la veste, et se déchaîne sur des pistes psychédéliques, comme le Patient zéro, qu’il finit au bord de l’apoplexie. Ça fonctionne, dans la foule, un peu timide et distante, comme s’il n’était pas encore sûr que tout cela soit terminé, on s’étonne, comme depuis 35 ans, de la présence scénique de ce chanteur qui défie le temps, et porte bien la guitare, aussi, sur ce projet. Le lien entre les chansons donne de la cohérence au récit, entre zone libre et Café de Paris, il y a quelque chose du livret d’opéra (leur premier album) dans ce qui est donné à entendre. Marc, le guitariste, confiera avoir souffert des ratés de la technique, mais son jeu permet de nombreuses ruptures, en solo, et correspond à la fois aux lignes de synthé et à la mélodie chantée. Les voix de Stéphane et de Nathalie s’entremêlent et se répondent, le Train, sans doute ma chanson préférée, en témoigne et les deux compères de la rythmique défendent le tout : avec flegme pour Alex à la batterie, avec des ronds de jambes (et de bras) pour Pedro, à la basse. Le set passe vite, un peu plus d’une heure, mais c’est une bonne formule pour roder un récital, et ça évite les fioritures, blagues du chanteur comprises. On les sent heureux d’être (encore) là, face, enfin, à des personnes qui le sont toujours, même si on les voudrait plus nombreuses. Depuis la Casa, le set s’est fixé, et on imagine ce qu’il donnera dans des lieux moins bucoliques, mais plus appropriés, avec un système-son plus adéquat. Mais l’essentiel était ailleurs. Aujourd’hui, on a encore entendu l’histoire d’ISQLAF, comme on regarde un film une fois de plus parce qu’on sait qu’il ne nous a pas tout livré, encore. Dans le public, après le concert, un musicien me confie que c’est la première fois qu’il voit les Noz sur scène. Il y a dix ans, il me disait que ça n’était pas sa tasse de thé – euphémisme – mais là, il est conquis, réellement. Et je le comprends : il y a quelque chose de fascinant dans l’empreinte qu’ils laissent, une fois le concert terminé. Ça n’est jamais pour rien que les enfants veulent qu’on leur lise toujours la même histoire (c’est toujours le même rêve), et toujours de la même façon. Il y a dix ans, Bonne-Espérance n’avait été joué qu’une seule fois, de mémoire, en intégralité. Il faudra qu’ISQLAF soit dit et redit, qu’on en saisisse les nuances et qu’on finisse surpris, à chaque fois. Le Voyage de Noz a déjà réussi à confondre, dans le temps, les notions de début et de fin. Son chanteur termine le concert en disant qu’il ne chantera plus, puis se reprend dans la chanson d’après, présentant ses excuses, le titre du dernier morceau de l’album, avant de laisser les instruments exploser dans un finale dantesque. Tant que les Noz joueront, j’irai ; tant qu’ils m’inspireront une chronique, je l’écrirai. Et si, comme hier, ils me permettent de retrouver mon vieux copain d’école, un ancien basketteur qui m’a pris pour mon frère et un ancien élève venu m’avouer à quel point il m’admirait, à l’époque, tant que leur photographe officiel me fera garder son sac et me shootera en cachette, à contre-jour et dans la lignée du raconteur d’histoire, je serai là. Il semblerait que l’amour ait encore de beaux jours devant lui.
À ce niveau-là, ça n’est plus de la chronique, mais un journal de bord. À peine trois semaines après les avoir vus, à la Casa, inaugurer ISQLAF (Il semblerait que l’amour fut), leur nouvel album, double galette qui raconte une histoire, celle d’un monde duquel l’amour serait radié, pourchassé, désigné comme le virus le plus redoutable pour l’espèce humaine. Un album à tiroirs, comme toujours avec Petrier, une dystopie dans laquelle des êtres organisent une résistance, une fuite orchestrée, vinyles à l’appui. Cet album, le Voyage de Noz le défendait pour la deuxième fois, dans les jardins de l’Institut Lumière, au cours d’un festival qui alignait quatre groupes, en plein air, face au soleil rasant d’une belle soirée d’été. Il avait beau avoir aligné la veste et le pantalon de costume, il n’a pas été à la noce, Petrier, pas plus que ses camarades, le Jedi Desprat aux manettes luttant pour installer un son correct et eux se démenant contre les perles de sueur et les petits ratés de micro, dans les premiers morceaux, pour enfin aligner les chansons du dernier opus, et rien que celles-ci, ce qui est une excellente idée : ça évite les trous de mémoire, et la dispersion narrative. Le titre éponyme, qui ouvre le set, pose le fameux spectre musical despratien, son lourd, grosse session rythmique, nappes de synthé, guitares aériennes et performance vocale, avec une énumération des villes du monde dans lesquelles, partout dans les rues, il semblerait que l’amour fut. Stéphane a vite tombé la veste, et se déchaîne sur des pistes psychédéliques, comme le Patient zéro, qu’il finit au bord de l’apoplexie. Ça fonctionne, dans la foule, un peu timide et distante, comme s’il n’était pas encore sûr que tout cela soit terminé, on s’étonne, comme depuis 35 ans, de la présence scénique de ce chanteur qui défie le temps, et porte bien la guitare, aussi, sur ce projet. Le lien entre les chansons donne de la cohérence au récit, entre zone libre et Café de Paris, il y a quelque chose du livret d’opéra (leur premier album) dans ce qui est donné à entendre. Marc, le guitariste, confiera avoir souffert des ratés de la technique, mais son jeu permet de nombreuses ruptures, en solo, et correspond à la fois aux lignes de synthé et à la mélodie chantée. Les voix de Stéphane et de Nathalie s’entremêlent et se répondent, le Train, sans doute ma chanson préférée, en témoigne et les deux compères de la rythmique défendent le tout : avec flegme pour Alex à la batterie, avec des ronds de jambes (et de bras) pour Pedro, à la basse. Le set passe vite, un peu plus d’une heure, mais c’est une bonne formule pour roder un récital, et ça évite les fioritures, blagues du chanteur comprises. On les sent heureux d’être (encore) là, face, enfin, à des personnes qui le sont toujours, même si on les voudrait plus nombreuses. Depuis la Casa, le set s’est fixé, et on imagine ce qu’il donnera dans des lieux moins bucoliques, mais plus appropriés, avec un système-son plus adéquat. Mais l’essentiel était ailleurs. Aujourd’hui, on a encore entendu l’histoire d’ISQLAF, comme on regarde un film une fois de plus parce qu’on sait qu’il ne nous a pas tout livré, encore. Dans le public, après le concert, un musicien me confie que c’est la première fois qu’il voit les Noz sur scène. Il y a dix ans, il me disait que ça n’était pas sa tasse de thé – euphémisme – mais là, il est conquis, réellement. Et je le comprends : il y a quelque chose de fascinant dans l’empreinte qu’ils laissent, une fois le concert terminé. Ça n’est jamais pour rien que les enfants veulent qu’on leur lise toujours la même histoire (c’est toujours le même rêve), et toujours de la même façon. Il y a dix ans, Bonne-Espérance n’avait été joué qu’une seule fois, de mémoire, en intégralité. Il faudra qu’ISQLAF soit dit et redit, qu’on en saisisse les nuances et qu’on finisse surpris, à chaque fois. Le Voyage de Noz a déjà réussi à confondre, dans le temps, les notions de début et de fin. Son chanteur termine le concert en disant qu’il ne chantera plus, puis se reprend dans la chanson d’après, présentant ses excuses, le titre du dernier morceau de l’album, avant de laisser les instruments exploser dans un finale dantesque. Tant que les Noz joueront, j’irai ; tant qu’ils m’inspireront une chronique, je l’écrirai. Et si, comme hier, ils me permettent de retrouver mon vieux copain d’école, un ancien basketteur qui m’a pris pour mon frère et un ancien élève venu m’avouer à quel point il m’admirait, à l’époque, tant que leur photographe officiel me fera garder son sac et me shootera en cachette, à contre-jour et dans la lignée du raconteur d’histoire, je serai là. Il semblerait que l’amour ait encore de beaux jours devant lui.
00:14 | Lien permanent
09/07/2021
175.
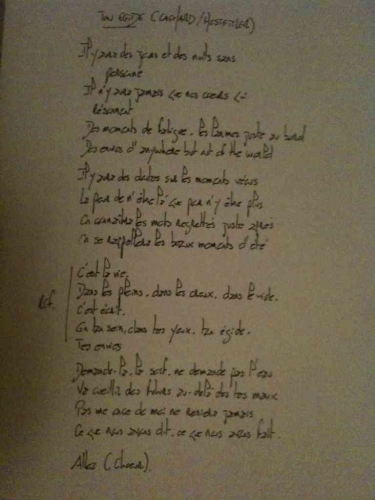
10:15 | Lien permanent
08/07/2021
176.
 Il y a quelque chose d’initiatique dans le fait, comme je l’ai toujours fait, d’aller voir des artistes tout au long de leur carrière, parfois plus de vingt fois (Eicher, Kent, Murat, le Voyage de Noz), parfois un peu moins, à peine (Barbara, U2, Springsteen, d’autres). Il y a des groupes qu’on voit une fois tous les 30 ans (Aurelia Kreit) et puis il y a des artistes qu’on a vu émerger et qui nous ramènent, toujours, à l’endroit où on les a entendus pour la première fois. J’aurai toujours le souvenir des Cerfs-volants, entendus à Kergaradec-Ar-Gor, de cet album d’un petit génie qui, disait-on, se prenait pour Gainsbourg. On a d’ailleurs toujours trop parlé de Benjamin Biolay sans aller le voir là où il donne sa pleine mesure, sur scène. Biolay à Fourvière, en régional de l’étape, ça n’était pas la première fois, et rien ne vaudra - pour lui comme pour moi - le soir de 2008 où, en première partie de Cat Power, il avait foulé les planches juste en-dessous du Conservatoire qui l’avait mené là, avec émotion et une scène partagée - déjà touche à tout doué en rien, comme il dit - entre formation rock, quatuor à cordes et quatuor à cuivres. Depuis, de l’eau a coulé entre Saône et Rhône, et le petit Benjamin est devenu une pointure, au public conquis d’avance, à 98,7% féminin (j’ai compté), qui n’a rien contre un peu de bruelisation dans le jeu de scène et les adresses. Il est toujours touchant, Biolay, quand il cache sa pudeur derrière des attitudes et des blousons de bad-boy, et toujours juste quand il est au plus intime, dans le sublime « Ton héritage » ou dans l’hommage, permanent, à son mentor Hubert Mounier (« Voyager léger »). À Lyon, BB peut se faire lever un amphithéâtre a le seconde sur « Lyon Presqu’île », c’est cabotin mais ça fonctionne. La set-list est variée, et va jusqu’à Palermo Hollywood, propose une variante électro du mythique Cerfs-volants, faiblit un peu sur deux trois morceaux dispensables ou mal exécutés (Papillon noir, Duel au soleil). Tout le monde s’en fiche, entre deux scrolls de leur FB ou des conversations insignes tentant de recouvrir la musique, les filles s’ébaudissent et leurs mecs tentent de danser pour attirer leur attention. Le public est WASP, CSP+ (à ce prix-là, c’est obligatoire) et BB déroule, visiblement heureux d’être là, et on le comprend. Adé, d’ex-Thérapie Taxi, vient chanter « Parc fermé » avec lui, et c’est ce qui rendra le concert inoubliable, pour moi. Parce que le final, après un « Comment est ta peine » version disco assez démentiel mais plutôt attendu, les deux derniers morceaux, dont l’ultime rappel, sont moyens, et surtout remplacent « Ma route » (vas-y, demande à ta mère), que j’aurais attendu en vain. Mais c’est du délit d’initié, ça, il faut voir repartir ces quinqua remontés comme des coucous pour se réjouir aussi, apprécier la fin des mesures sanitaires, remercier l’organisation d’avoir permis de jouer quatre minutes après minuit. C’était un bon concert, pas dans mon Panthéon (le Transbordeur 2009, pour « la Superbe » - joué hier, qui fit croire que - est inatteignable), mais marquant par l’impression que cet homme peut désormais faire ce qu’il veut quand il veut, sur scène. Une impression à double tranchant. J’attends de le croiser de nouveau devant Monoprix à Sète pour lui en toucher deux mots. Padam pam pam.
Il y a quelque chose d’initiatique dans le fait, comme je l’ai toujours fait, d’aller voir des artistes tout au long de leur carrière, parfois plus de vingt fois (Eicher, Kent, Murat, le Voyage de Noz), parfois un peu moins, à peine (Barbara, U2, Springsteen, d’autres). Il y a des groupes qu’on voit une fois tous les 30 ans (Aurelia Kreit) et puis il y a des artistes qu’on a vu émerger et qui nous ramènent, toujours, à l’endroit où on les a entendus pour la première fois. J’aurai toujours le souvenir des Cerfs-volants, entendus à Kergaradec-Ar-Gor, de cet album d’un petit génie qui, disait-on, se prenait pour Gainsbourg. On a d’ailleurs toujours trop parlé de Benjamin Biolay sans aller le voir là où il donne sa pleine mesure, sur scène. Biolay à Fourvière, en régional de l’étape, ça n’était pas la première fois, et rien ne vaudra - pour lui comme pour moi - le soir de 2008 où, en première partie de Cat Power, il avait foulé les planches juste en-dessous du Conservatoire qui l’avait mené là, avec émotion et une scène partagée - déjà touche à tout doué en rien, comme il dit - entre formation rock, quatuor à cordes et quatuor à cuivres. Depuis, de l’eau a coulé entre Saône et Rhône, et le petit Benjamin est devenu une pointure, au public conquis d’avance, à 98,7% féminin (j’ai compté), qui n’a rien contre un peu de bruelisation dans le jeu de scène et les adresses. Il est toujours touchant, Biolay, quand il cache sa pudeur derrière des attitudes et des blousons de bad-boy, et toujours juste quand il est au plus intime, dans le sublime « Ton héritage » ou dans l’hommage, permanent, à son mentor Hubert Mounier (« Voyager léger »). À Lyon, BB peut se faire lever un amphithéâtre a le seconde sur « Lyon Presqu’île », c’est cabotin mais ça fonctionne. La set-list est variée, et va jusqu’à Palermo Hollywood, propose une variante électro du mythique Cerfs-volants, faiblit un peu sur deux trois morceaux dispensables ou mal exécutés (Papillon noir, Duel au soleil). Tout le monde s’en fiche, entre deux scrolls de leur FB ou des conversations insignes tentant de recouvrir la musique, les filles s’ébaudissent et leurs mecs tentent de danser pour attirer leur attention. Le public est WASP, CSP+ (à ce prix-là, c’est obligatoire) et BB déroule, visiblement heureux d’être là, et on le comprend. Adé, d’ex-Thérapie Taxi, vient chanter « Parc fermé » avec lui, et c’est ce qui rendra le concert inoubliable, pour moi. Parce que le final, après un « Comment est ta peine » version disco assez démentiel mais plutôt attendu, les deux derniers morceaux, dont l’ultime rappel, sont moyens, et surtout remplacent « Ma route » (vas-y, demande à ta mère), que j’aurais attendu en vain. Mais c’est du délit d’initié, ça, il faut voir repartir ces quinqua remontés comme des coucous pour se réjouir aussi, apprécier la fin des mesures sanitaires, remercier l’organisation d’avoir permis de jouer quatre minutes après minuit. C’était un bon concert, pas dans mon Panthéon (le Transbordeur 2009, pour « la Superbe » - joué hier, qui fit croire que - est inatteignable), mais marquant par l’impression que cet homme peut désormais faire ce qu’il veut quand il veut, sur scène. Une impression à double tranchant. J’attends de le croiser de nouveau devant Monoprix à Sète pour lui en toucher deux mots. Padam pam pam.
02:35 Publié dans Blog | Lien permanent
















































