02/09/2024
JOURDOTHÈQUE (8/10)
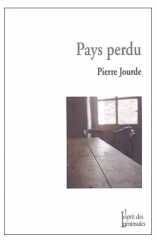 Il faut savoir relire les livres qui vous ont – considérablement – marqué en leur temps. Ainsi, l’antépénultième station de ma jourdothèque m’a conduit à rouvrir Pays perdu, un roman dont on a trop parlé pour le scandale qui a suivi que pour sa réalité littéraire, époustouflante. Même 20 ans après, ou un peu plus. Ainsi Jourde, dans Pays perdu, s’attaque-t-il à la légende des villages pour mieux, a contrario, en restituer la réalité, fût-elle sordide. Aux yeux de qui, par ailleurs ? Son abord est celle d’un orographe – celui qui étudie l’étude des reliefs montagneux, on l’a vu dans Littérature & authenticité (2005) – dans un premier temps, puisqu’il aborde vite, après le prétexte littéraire d’un héritage sur des terres anciennes, la notion de paysage fait d’axes, de bifurcations, de courbes, de route épuisée pour vite, interroger l’idée même de lieu, la présence invisible et tyrannique de l’espace. S’il revient 35 ans après, parce que son frère a hérité du cousin Joseph, c’est pour (re)trouver un pays plus perdu que jamais, ce qui reste une expression puisque le temps n’a eu aucune emprise sur la topologie, pas davantage sur les êtres, sauf que la plupart des seconds ont disparu, sans bruit, alors que la première est en place, ad vitam aeternam. Si les deux frères y vont dans la fantasmagorie du trésor (souvent fait de dettes et de lieux dont personne ne veut), ils retrouvent des hommes qui ont fini, dit l’auteur, par ressembler aux pierres. Et tombent, puisque l’analogie ne manque pas d’ironie, au moment de la mort de Lucie, qu’ils ont connue, qui est de leur âge. Ainsi se doivent-ils d’aller saluer les parents – François et Marie-Claude – lors de la veillée funèbre, et voir défiler, au fur et à mesure de la journée, toutes les figures du village et des villages voisins, que Jourde étudie en entomologiste, avec des descriptions qu’on jugerait dures si elles n’étaient pas l’exacte réalité de ce qu’il voit mieux qu’il ne voyait enfant.
Il faut savoir relire les livres qui vous ont – considérablement – marqué en leur temps. Ainsi, l’antépénultième station de ma jourdothèque m’a conduit à rouvrir Pays perdu, un roman dont on a trop parlé pour le scandale qui a suivi que pour sa réalité littéraire, époustouflante. Même 20 ans après, ou un peu plus. Ainsi Jourde, dans Pays perdu, s’attaque-t-il à la légende des villages pour mieux, a contrario, en restituer la réalité, fût-elle sordide. Aux yeux de qui, par ailleurs ? Son abord est celle d’un orographe – celui qui étudie l’étude des reliefs montagneux, on l’a vu dans Littérature & authenticité (2005) – dans un premier temps, puisqu’il aborde vite, après le prétexte littéraire d’un héritage sur des terres anciennes, la notion de paysage fait d’axes, de bifurcations, de courbes, de route épuisée pour vite, interroger l’idée même de lieu, la présence invisible et tyrannique de l’espace. S’il revient 35 ans après, parce que son frère a hérité du cousin Joseph, c’est pour (re)trouver un pays plus perdu que jamais, ce qui reste une expression puisque le temps n’a eu aucune emprise sur la topologie, pas davantage sur les êtres, sauf que la plupart des seconds ont disparu, sans bruit, alors que la première est en place, ad vitam aeternam. Si les deux frères y vont dans la fantasmagorie du trésor (souvent fait de dettes et de lieux dont personne ne veut), ils retrouvent des hommes qui ont fini, dit l’auteur, par ressembler aux pierres. Et tombent, puisque l’analogie ne manque pas d’ironie, au moment de la mort de Lucie, qu’ils ont connue, qui est de leur âge. Ainsi se doivent-ils d’aller saluer les parents – François et Marie-Claude – lors de la veillée funèbre, et voir défiler, au fur et à mesure de la journée, toutes les figures du village et des villages voisins, que Jourde étudie en entomologiste, avec des descriptions qu’on jugerait dures si elles n’étaient pas l’exacte réalité de ce qu’il voit mieux qu’il ne voyait enfant.
La matière des morts, dit-il, agit comme un révélateur de ce qu’ils ont vécu, voire de ce à quoi ils échappent désormais. Le village, c’est Freaks, empli d’obèses, d’handicapés, de vin rouge dans le biberon, de dents uniques, d’estropiés et de blessés par les machines modernes, on y croise, dans l’histoire, un scalpé qui remet son chapeau tranquillement, un autre qui laisse ses doigts gelés dans les barbelés dans lesquels sa cuite l’a laissé toute la nuit. Des fatalités domestiques locales, comme ces monceaux et chiffons qu’on laisse s’accumuler et se déliter. Des araignées dans les verres, du pus sur le visage, des cadavres de chiots dans les draps, la crasse entre les doigts qui s’écoule sous l’effet du jambon cru mangé à pleines mains… Une dizaine de foyers, dans un très petit espace, à 40 minutes de route de la première ville, où personne n’est allé. Des êtres qui sont des très peu d’hommes, des vies qui sont si peu, mais rien ne relève du jugement ou du dégoût. Juste une réflexion sur le temps – qui ne passe que pour celui qui s’est défait de ceux, différents,entrecroisés pour l’enterrement, des gens d’ici (ou de là-bas, c’est selon), sur la nécessité de revenir à l’image du mort, à sa tombe, à son corps. Le père du narrateur est enterré dans ce pays perdu, détenteur d’un secret que seule la tante Léontine pourra lever : généalogiste et chroniqueuse, dit Jourde, en digne héritier, puisqu’il mène, de son côté, une étude sociologique qui vaut celle de la Vie mode d’emploi, sans l’esthétique. Ou alors avec l’esthétique propre aux rituels complexes de la vie paysanne. Il y a parfois une pointe de nostalgie – le pays de son enfance perdue – dans le constat clinique : si rien ne semble évoluer, les machines ont remplacé les fenaisons avec les vieux et les enfants au râteau ; il n’y a toujours pas de toilettes ni de douche, mais des télés, qui ouvrent sur un monde qu’ils ne connaîtront jamais. Dans ces crêtes désertiques, on croise les écrasés, les ébouillantés, les énuclées, ceux qui se pendirent d’ennui, une détrousseuse de cadavres, les tonnes de merde remuées, puisque, écrit-il, une grande partie de l’activité agricole lui est consacrée. Et l’alcool, partout, dont Jourde étudie la fonction avec dureté mais – une fois de plus – justesse. On gage que ça n’a pas plu, et que le mode coup de poing (et pire) a remplacé le débat sur réalité et fiction, la licence littéraire, les prête-noms, les lieux déplacés ailleurs. Mais un ailleurs qui ne se reconnaît pas comme tel, surtout pour ceux qui n’en sont pas, et qui se sont reconnus jusque dans l’holocauste des mouches. Dans les années 80, on vantait le mérite littéraire de l’autofiction, baudruche heureusement vite démontée (quoique)… Au début du XXI°s. Jourde posait là un brûlot dont le seul défaut est celui de sa très grande qualité : une écriture du réel, sans faux-semblants, sans récit mélioratif qui éloigne de la véracité. Dure mais juste. Il s’est expliqué largement depuis, sur le sujet, mais ce roman-là, qui enterre les derniers paysans avec une mélancolie qu’on n’aura pas reconnue, va au-delà de la nécessité de mémoire : il en est le sujet.
21:39 Publié dans Blog | Lien permanent
01/09/2024
JOURDOTHÈQUE (7/10)
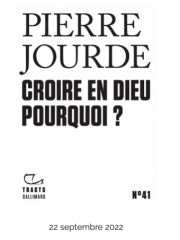 Sacrée gageure, pour un intellectuel, de poser la question de Dieu en 40 pages, dans la belle collection des Tracts de Gallimard. Pourtant, il y a deux ans, Pierre Jourde s’y est attelé, sous le titre Croire en Dieu, pourquoi ? qui n’a rien d’anodin puisqu’il pose en soi la problématique de l’utilité dans un domaine supposé immanent, au-dessus même de toute question. Il y répond en un essai en six points, qui vont de la Création à sa bizarrerie, de l’autorité des textes sacrés au choix d’un Dieu (plutôt qu’un autre), des prescriptions divines au concept de morale. Une construction philosophique, qui commence – on s’en serait douté – par déconstruire la croyance, au nom de l’évolution et de la connaissance. Jusqu’à l’époque moderne, dit Jourde, toutes les sociétés étaient religieuses, et n’offraient donc pas la possibilité d’interroger la nature de la religion. On sait désormais par la science que Dieu ne peut pas être considéré comme la cause originelle – une cause en soi – pour autant, il relève encore, pour certains, d’un besoin profond, considérant (avec Kant) qu’il est impossible pour l’homme seul d‘avoir une connaissance de l’absolu. Dieu devient donc, dit Jourde, sollicitant Nabilla (sic) une hypothèse possible, mais non nécessaire, dans la perception des multivers qu’appréhendent les cosmologues. Dieu devient donc, avec l’histoire, un créateur bizarre, que l’auteur interroge en même temps que l’idée de souffrance qui justifierait une vie meilleure, après. Difficile de ne pas rapprocher les drames qu’il a vécus lui de l’idée d’en questionner Dieu, dans l’idée de salut, qu’il finit néanmoins par associer, de l’Immaculée conception chrétienne aux vierges du martyr d’Allah, à des énormités qu’il convient, toujours, de dénoncer, au nom de la connaissance.
Sacrée gageure, pour un intellectuel, de poser la question de Dieu en 40 pages, dans la belle collection des Tracts de Gallimard. Pourtant, il y a deux ans, Pierre Jourde s’y est attelé, sous le titre Croire en Dieu, pourquoi ? qui n’a rien d’anodin puisqu’il pose en soi la problématique de l’utilité dans un domaine supposé immanent, au-dessus même de toute question. Il y répond en un essai en six points, qui vont de la Création à sa bizarrerie, de l’autorité des textes sacrés au choix d’un Dieu (plutôt qu’un autre), des prescriptions divines au concept de morale. Une construction philosophique, qui commence – on s’en serait douté – par déconstruire la croyance, au nom de l’évolution et de la connaissance. Jusqu’à l’époque moderne, dit Jourde, toutes les sociétés étaient religieuses, et n’offraient donc pas la possibilité d’interroger la nature de la religion. On sait désormais par la science que Dieu ne peut pas être considéré comme la cause originelle – une cause en soi – pour autant, il relève encore, pour certains, d’un besoin profond, considérant (avec Kant) qu’il est impossible pour l’homme seul d‘avoir une connaissance de l’absolu. Dieu devient donc, dit Jourde, sollicitant Nabilla (sic) une hypothèse possible, mais non nécessaire, dans la perception des multivers qu’appréhendent les cosmologues. Dieu devient donc, avec l’histoire, un créateur bizarre, que l’auteur interroge en même temps que l’idée de souffrance qui justifierait une vie meilleure, après. Difficile de ne pas rapprocher les drames qu’il a vécus lui de l’idée d’en questionner Dieu, dans l’idée de salut, qu’il finit néanmoins par associer, de l’Immaculée conception chrétienne aux vierges du martyr d’Allah, à des énormités qu’il convient, toujours, de dénoncer, au nom de la connaissance.
C’est ainsi qu’il faut aborder les textes sacrés, dans leur autorité même, qui ne trouve réponse que dans le nombre, la répétition et l’opinion. En philosophie, l’inverse de la vérité, parce qu’elle est fondée sur l’aléa, le fait que possiblement, l’autre ait la même opinion que moi – auquel cas ça me conforte dans l’idée que j’ai raison – ou pas – auquel cas, je considère que c’est un imbécile, voire que je peux le tuer, au nom de Dieu. Le texte sacré, avance Jourde, a ceci de sacré qu’il décide à l’avance être la vérité, quelles qu’en soient les approximations, les imbécillités ou les anachronismes. Mais qui a décidé de ça, s’interroge-t-il, encore, opposant le discours scientifique, réfutable par essence, au religieux, définitif, même s’il est fondé sur des connaissances d’époque, une vision du monde très militée, de fait. Et Jourde de souligner un paradoxe (de plus) : les croyants évitent de se poser des questions sur un sujet aussi important que Dieu et, par extension, c’est l’ignorance qui fait la religion. Facile, ensuite, de donner les exemples multiples dans la vie que nous menons ou celle que nous entendons des autres. Alors, interroge-t-il, puisque c’est la nature de l’exercice de susciter des questions davantage que d’apporter de réponses, pourquoi ce Dieu plutôt qu’un autre ? Là encore, il remet l’aléa en route, soulignant qu’un Turc, par exemple, serait né Chrétien au XVI° siècle, à Istanbul, alors qu’il naîtra musulman, vraisemblablement, aujourd’hui. Ça n’est ni idéologique, ni spirituel, mais factuel. Dans l’histoire, des conversions se sont faites au nom d’un confort social, pas d’une croyance acharnée, rappelle-t-il. Sur ce terrain glissant – on tue des intellectuels pour moins que ça – il cite l’hindouisme comme la croyance la moins opposée à la connaissance, puisque la divinité se confond avec la matière, ramène les règles, contraintes et interdits (souvent imbéciles) à la crainte que l’homme se fait de sa propre liberté. Et conclue sur la confusion qu’on doit, chacun, éviter de faire entre la morale et la croyance, sous peine de tartufferie, notamment quand il s’agit de définir et faire le Bien. On lapide des jeunes filles, dans certains pays, parce qu’elles ont été immorales, dit-on ; ceux qui jettent les pierres – et Jourde, malheureusement, sait ce que le geste signifie, même dans d’autres circonstances – le font au nom de la morale, mais pose-t-il, qui fait mal à l’autre ? La morale n’a pas besoin de Dieu, elle est inhérente à l’homme.
C’est toujours un plus, des petits textes philosophiques très abordables, offerts (3,90€) à la conscience de chacun. Et dans l’œuvre – la vie, même - d’un auteur, c’est important qu’il se confronte à des idées beaucoup plus grandes que lui. C’est réussi.
18:27 Publié dans Blog | Lien permanent

















































