Rechercher : Didier le Bras
Neuf ans et demi.
J’ai trouvé dans le fond d’un verre de Manzanille
l’amertume des soirs passés à m’imprégner
des couleurs de la lune qui pour nous deux brillait
à distance légale d’émois partis en vrille ;
il ne me reste rien de cette cantilène,
c’est l’état d’abandon et puis de décalages,
une atrophie des sens, comme pour un retour d’âge,
la torpeur d’être en face d’une vie qui fut sienne
J’ai tant de souvenirs, ma mémoire en est pleine
sur l’écran Adèle H. rechausse ses lunettes :
je voudrais être en face d’une âme souveraine
délestée de tout ce qu’un beau soir on regrette
Plaza de España, j’ai attendu des heures
voir à Séville sombra prendre le pas sur sol,
fuyant tous les humains, réfutant les écoles,
priant pour que le temps concordât à mon cœur
Il me reste le vide, dans lequel je m’installe,
décidé à pallier toutes les parts manquantes
le vide est une vie dont on décore l’étal
[ un étal d’où dévale l’étendue d’eau régale
et qui parfois attire jusqu’au pas des passantes
J’ai tant de souvenirs, ma mémoire est espiègle,
elle accole Adèle H. à mes amours défaites
bien qu’à la table rase plus que jamais je tienne,
qu’à l’issue de l’oubli lentement je m’apprête
Ici une lumière a recentré la ville,
tous ces lieux qui ravivent m’ont fait me retrouver
au fond du fond du verre glacé de Manzanille,
in fine du fino jaillit la vérité.
Va ! née sabéenne, ma reine est sévillane
je griffonne une Ode sur le coin d’une table :
l’encre noire dessine sur le papier de sable
d’inédits aphorismes aux ambitions profanes
Alors à Triana je vais la rechercher,
mon Adèle isolée du reste de sa vie,
près du Guadalquivir je vais déambuler
à mon bras une muse que jamais on ne vit
ad lib « Los balcones se cierran
Para enjaular los besos
!Oh cuanta estrella
cuanta estrella ! »*
*Federico Garcia Lorca « Ocaso de feria »,1921
15/06/2011 | Lien permanent
Passé le Guadalquivir...

J'ai trouvé dans le fond d’un verre de Manzanille
l’amertume des soirs passés à m’imprégner
des couleurs de la lune qui pour nous deux brillait
à distance légale d’émois partis en vrille ;
il ne me reste rien de cette cantilène,
c’est l’état d’abandon et puis de décalages,
une atrophie des sens, comme pour un retour d’âge,
la torpeur d’être en face d’une vie qui fut sienne
J’ai tant de souvenirs, ma mémoire en est pleine
sur l’écran Adèle H. rechausse ses lunettes :
je voudrais être en face d’une âme souveraine
délestée de tout ce qu’un beau soir on regrette
Plaza de Espaa, j’ai attendu des heures
voir à Séville sombra prendre le pas sur sol,
fuyant tous les humains, réfutant les écoles,
priant pour que le temps concordât à mon cœur
Il me reste le vide, dans lequel je m’installe,
décidé à pallier toutes les parts manquantes
le vide est une vie dont on décore l’étal
[ un étal d’où dévale l’étendue d’eau régale
et qui parfois attire jusqu’au pas des passantes
J’ai tant de souvenirs, ma mémoire est espiègle,
elle accole Adèle H. à mes amours défaites
bien qu’à la table rase plus que jamais je tienne,
qu’à l’issue de l’oubli lentement je m’apprête
Ici une lumière a recentré la ville,
tous ces lieux qui ravivent m’ont fait me retrouver
au fond du fond du verre glacé de Manzanille,
in fine du fino jaillit la vérité.
Va ! née sabéenne, ma reine est sévillane
je griffonne une Ode sur le coin d’une table :
l’encre noire dessine sur le papier de sable
d’inédits aphorismes aux ambitions profanes
Alors à Triana je vais la rechercher,
mon Adèle isolée du reste de sa vie,
près du Guadalquivir je vais déambuler
à mon bras une muse que jamais on ne vit
ad lib « Los balcones se cierran
Para enjaular los besos
!Oh cuanta estrella
cuanta estrella ! »*
*Federico Garcia Lorca « Ocaso de feria »,1921
11/04/2009 | Lien permanent
185.
J’ai trouvé dans le fond d’un verre de Manzanille
l’amertume des soirs passés à m’imprégner
des couleurs de la lune qui pour nous deux brillait
à distance légale d’émois partis en vrille ;
il ne me reste rien de cette cantilène,
c’est l’état d’abandon et puis de décalages,
une atrophie des sens, comme pour un retour d’âge,
la torpeur d’être en face d’une vie qui fut sienne
J’ai tant de souvenirs, ma mémoire en est pleine
sur l’écran Adèle H. rechausse ses lunettes :
je voudrais être en face d’une âme souveraine
délestée de tout ce qu’un beau soir on regrette
Plaza de España, j’ai attendu des heures
voir à Séville sombra prendre le pas sur sol,
fuyant tous les humains, réfutant les écoles,
priant pour que le temps concordât à mon cœur
Il me reste le vide, dans lequel je m’installe,
décidé à pallier toutes les parts manquantes
le vide est une vie dont on décore l’étal
[ un étal d’où dévale l’étendue d’eau régale
et qui parfois attire jusqu’au pas des passantes
J’ai tant de souvenirs, ma mémoire est espiègle,
elle accole Adèle H. à mes amours défaites
bien qu’à la table rase plus que jamais je tienne,
qu’à l’issue de l’oubli lentement je m’apprête
Ici une lumière a recentré la ville,
tous ces lieux qui ravivent m’ont fait me retrouver
au fond du fond du verre glacé de Manzanille,
in fine du fino jaillit la vérité.
Va ! née sabéenne, ma reine est sévillane
je griffonne une Ode sur le coin d’une table :
l’encre noire dessine sur le papier de sable
d’inédits aphorismes aux ambitions profanes
Alors à Triana je vais la rechercher,
mon Adèle isolée du reste de sa vie,
près du Guadalquivir je vais déambuler
à mon bras une muse que jamais on ne vit
ad lib « Los balcones se cierran
Para enjaular los besos
!Oh cuanta estrella
cuanta estrella ! »*
*Federico Garcia Lorca « Ocaso de feria »,1921
29/06/2021 | Lien permanent
Hors les Murs.
Femme-muraille, devant ces murs qui prétendent enfermer jusqu’à ce que tu représentes, ton geste, l’hypnose de tes bras, comme une gitane dont l’esprit se confondrait avec le feu, est une rédemption, il ré éclaire l’état dans lequel l’homme s’est condamné à être celui qu’il n’aurait jamais dû être. Les cerbères qui te délimitent ne sont plus imposants que par ce qu’ils ont enfermé, les âmes qu’ils ont confisquées, les vies, les phénomènes : à leur pied, tu deviens LA vie, tu rayonnes, tu es à la fois la féminité et ses incidences. A mi-chemin entre l’ombre et la lumière, tu cherches l’improbable issue, tu es celle qui part, celle qui redessine les contours que les huis jamais franchis de chacune des pierres qui font les murs avaient à jamais intégrés et définis. Dans la cambrure de tes reins, le galbe de tes hanches, il y a l’espoir qui se tend, dressé vers un infini plus haut encore, plus lointain dans l’âme que l’obstacle infranchissable. Le geste est authentique, comme le sera l’enjeu, quand derrière l’élément, tu te donneras à celui qui te fera l’amour pour recommencer, réinventer l’état de nature : alors, l’imposant édifice rendra les énergies, il épousera le rythme de tes mouvements, la pierre retrouvera de sa majesté ; d’un coup un peu moins glacée, elle aura l’écume de tes tempes qui se serrent… L’équerre des murs qui te font face n’est plus autoritaire, elle est soumise, elle semble indiquer la direction qu’elle a longtemps refusée, et la volupté que tu ressens à l’idée de t’y engager n’est rien par rapport à l’immensité du temps que tu libères, que tu recrées, après qu’il sera détruit. Temps réel, temps maîtrisé, aimé et materné, ton hymne est à la femme et à l’amour, il oriente, considère le sens qu’il va donner à la marche et la conscience de son contraire. Sisyphe sans absurde, tu deviens le cours et sa justification, jusque dans la douleur. Comme une reine, une égérie. La pierre se fissure, elle libère les interdits, les âmes de ceux qui y vivaient reclus, elle te porte, tu deviens l’immensité de ce que tu as réalisé, une cime parmi les sommets. La nudité t’épargne, ton corps est un rempart, il crée une distance attractive, toutes les ondes s’y retrouvent, comme dans un champ magnétique. Tu parviens même à faire de la dissymétrie des murs un équilibre parfait, que l’arête de ton dos fige, que ton vol suspend. L’estampe japonaise qu’on ferait de ton image appellerait un haïku, circonstanciel:
J’entends tes silences Et devine tes conflits Je ne dirai rien
mais c’est le chant de la terre et de ses barrières naturelles que tu entreprends de réécrire, et d’aimer à nouveau, la liberté qui n’est plus qu’elle-même, délivrée de son illusion. Libre, tu concours à la liberté des autres, tu la façonnes, la malaxes comme tu le ferais de l’argile, qui s’insère, gagne du terrain sur le roc, et, paradoxalement, gagne en justice ce qu’il perd en solidité. Nous sommes déjà ensemble, moi derrière le mur, toi qui le franchis et le ruine ; mais quand nous le serons vraiment , regarde moi à chaque seconde comme si c’était la dernière fois, que nous ne verrons pas venir, puisque nous serons ensemble… Alors seulement, la pureté de ton geste nous reviendra et nous éprouverons de la mélancolie, celle des nuits d’Espagne, auxquelles renvoie ta danse, la liane de tes bras. Nous pourrons nous dire que nous n’avions pas fini de nous aimer, que les murs qui enferment ne sont que les projections de toutes nos vies cassées, nous prendrons la mesure de ce qui nous reste à réinventer. Nous serons nous, vraiment, pas ceux que nous aurions dû être. Quoiqu’il nous arrive désormais, tu sais maintenant que pour moi, il est écrit que ceux qui se sont aimés comme ceux qui se sont défaits, finissent, forcément, par se retrouver.
Le Mur, ainsi, devient liaison, il relie, s’il est entre, c’est pour mieux assembler : c’est pour ça que tu donnes l’impression de l’épouser, de rentrer dedans, comme un spectre pour qui rien n’est infranchissable. Mon champ d’amour pour toi n’est plus paradigmatique, mais syntagmatique : un horizon, un infini.
Voilà. Hors les murs, notre vie existe de nouveau ; ils sont des épreuves plus que des obstacles, ils se passent. La pierre ne s’envisage plus en hauteur, elle forme des couloirs, sert le labyrinthe dans lequel se perdra et ton corps et le souvenir que je m’en fais, ta nudité et l’effet qu’elle a sur le regard. La confusion est grande, grande est aussi la tentation d’être l’endroit où tu te montres dans la plus absolue de ta prude impudeur : soudain je me métamorphose, mes jambes, mes bras deviennent de pierre, je me fige, je m’emmure et te regarde danser. Je n’ai pas ton altruisme, et désire te garder pour moi, à jamais. Je deviens la sentinelle du temps qui te valide : l’impression d’avoir à reconstruire constamment le peu que nous avons édifié est à la fois excitante et éprouvante, mais si tu me laissais le choix entre partir et t’oublier, je choisirais de t’oublier, parce que ça ne m’engage en rien, puisque ce n’est pas possible… Toi à la danse, moi à l’édifice, tu m’accompagnes déjà, comme une contrainte libératrice; car si j’ai enfin le courage et l’envie d’ouvrir cette brèche que je sens nécessaire à mon bonheur, c’est avec toi que j’aimerais l’explorer pas à pas, comme un voyage intérieur. Vers la lumière.
01/11/2014 | Lien permanent
298.
HORS LES MURS / Variations sur une photographie de Jean Frémiot, 2000
 Femme-muraille, devant ces murs qui prétendent enfermer jusqu’à ce que tu représentes, ton geste, l’hypnose de tes bras, comme une gitane dont l’esprit se confondrait avec le feu, est une rédemption, il réinvente, ré éclaire l’état dans lequel l’homme s’est condamné à être celui qu’il n’aurait jamais dû être. Les cerbères qui t’entourent, te délimitent, ne sont plus imposants que par ce qu’ils ont enfermé, par les âmes qu’ils ont confisquées, les vies, les phénomènes : à leur pied, tu deviens LA vie, tu rayonnes, tu es à la fois la féminité et ses incidences. A mi-chemin entre l’ombre et la lumière, tu cherches une improbable issue, tu es celle qui part, celle qui redessine les contours que les huis jamais franchis de chacune des pierres qui composent les murs avaient à jamais intégrés et définis. Dans la cambrure de tes reins, le galbe de tes hanches, il y a l’espoir qui se tend, dressé vers un infini plus haut encore, plus lointain dans l’âme que l’obstacle infranchissable. Le geste est authentique, comme le sera l’enjeu, quand derrière l’élément, tu te donneras à celui qui te fera l’amour pour recommencer, redéfinir l’état de nature : alors, l’imposant édifice rendra les énergies, il épousera le rythme de tes mouvements, la pierre retrouvera de sa majesté, elle sera d’un coup un peu moins glacée, elle aura l’écume de tes tempes qui se serrent…
Femme-muraille, devant ces murs qui prétendent enfermer jusqu’à ce que tu représentes, ton geste, l’hypnose de tes bras, comme une gitane dont l’esprit se confondrait avec le feu, est une rédemption, il réinvente, ré éclaire l’état dans lequel l’homme s’est condamné à être celui qu’il n’aurait jamais dû être. Les cerbères qui t’entourent, te délimitent, ne sont plus imposants que par ce qu’ils ont enfermé, par les âmes qu’ils ont confisquées, les vies, les phénomènes : à leur pied, tu deviens LA vie, tu rayonnes, tu es à la fois la féminité et ses incidences. A mi-chemin entre l’ombre et la lumière, tu cherches une improbable issue, tu es celle qui part, celle qui redessine les contours que les huis jamais franchis de chacune des pierres qui composent les murs avaient à jamais intégrés et définis. Dans la cambrure de tes reins, le galbe de tes hanches, il y a l’espoir qui se tend, dressé vers un infini plus haut encore, plus lointain dans l’âme que l’obstacle infranchissable. Le geste est authentique, comme le sera l’enjeu, quand derrière l’élément, tu te donneras à celui qui te fera l’amour pour recommencer, redéfinir l’état de nature : alors, l’imposant édifice rendra les énergies, il épousera le rythme de tes mouvements, la pierre retrouvera de sa majesté, elle sera d’un coup un peu moins glacée, elle aura l’écume de tes tempes qui se serrent…
L’équerre des murs qui te font face n’est plus autoritaire, elle est soumise, elle semble maintenant indiquer la direction qu’elle a si longtemps refusée, et la volupté que tu ressens à l’idée de t’y engager n’est rien par rapport à l’immensité du temps que tu libères, que tu recrées, après qu’il fût détruit. Temps réel, temps maîtrisé, aimé et materné, ton hymne est à la femme et à l’amour, il oriente, considère le sens qu’il va donner à la marche et la conscience de son contraire. Toi, Sisyphe sans absurde, tu deviens le cours et sa justification, jusque dans la douleur. Comme une reine, une égérie. La pierre se fissure, libère les interdits, les âmes de ceux qui y vivaient reclus, elle te porte, tu deviens l’immensité de ce que tu as réalisé, cime parmi les sommets. La nudité t’épargne, ton corps est un rempart, il crée une distance attractive, toutes les ondes s’y retrouvent, comme dans un champ magnétique. Tu parviens même à faire de la dissymétrie des murs un équilibre parfait, que l’arête de ton dos fige, que ton vol suspend. L’estampe japonaise qu’on ferait de ton image appellerait un haïku, circonstanciel:
J’entends tes silences / Et devine tes conflits / Je ne dirai rien
mais c’est le chant de la terre, et de ses barrières naturelles que tu entreprends de réécrire, et d’aimer à nouveau, la liberté qui n’est plus qu’elle-même, délivrée de son illusion. Libre, tu concours à la liberté des autres, tu la façonnes, la malaxes comme tu le ferais de l’argile, un argile qui s’insère, gagne du terrain sur le roc, et, paradoxalement, gagne en justice ce qu’il perd en solidité. Nous sommes déjà ensemble, moi derrière le mur, toi qui le franchis et l’annihile ; mais quand nous le serons vraiment , regarde moi à chaque seconde comme si c’était la dernière fois, que nous ne verrons pas venir, puisque nous serons ensemble...
Alors seulement, la pureté de ton geste nous reviendra et nous éprouverons de la mélancolie, celle des nuits d’Espagne, auxquelles renvoie ta danse, la liane de tes bras. Nous pourrons nous dire que nous n’avions pas fini de nous aimer, que les murs qui enferment ne sont que les projections de nos infaisabilités, nous prendrons la mesure de ce qui nous reste à réinventer. Nous serons nous, vraiment, pas ceux que nous aurions dû être. Quoiqu’il nous arrive désormais, tu sais maintenant que pour moi, il est écrit que ceux qui se sont aimés comme ceux qui se sont déchirés, finissent, forcément, par se retrouver.
Le Mur, ainsi, devient liaison, il relie, s’il est entre, c’est pour mieux assembler : c’est pour ça que tu donnes l’impression de l’épouser, de rentrer dedans, comme un spectre pour qui rien n’est infranchissable. Mon champ d’amour pour toi n’est plus paradigmatique, mais syntagmatique : un horizon, un infini.
Voilà. Hors les murs, notre vie existe de nouveau ; ils sont des épreuves plus que des obstacles, ils se passent, comme on le dit en anglais d’un examen pour signifier qu’on l’a réussi. La pierre ne s’envisage plus en hauteur, elle forme des couloirs, sert le labyrinthe dans lequel se perdra et ton corps et le souvenir que je m’en fais, ta nudité et l’effet qu’elle a sur le regard. La confusion est grande, grande est aussi la tentation d’être l’endroit où tu te montres dans la plus absolue de ta prude impudeur : soudain je me métamorphose, mes jambes, mes bras deviennent de pierre, je me fige, je m’emmure et te regarde danser. Je n’ai pas ton altruisme, et désire te garder pour moi, à jamais. Je deviens la sentinelle du temps qui te valide : l’impression d’avoir à reconstruire constamment le peu que nous avons édifié est à la fois excitante et éprouvante, mais si tu me laissais le choix entre partir et t’oublier, je choisirais de t’oublier, parce que ça ne m’engage en rien, puisque ce n’est pas possible...
Toi à la danse, moi à l’édifice, tu m’accompagnes déjà, comme une contrainte libératrice ; car si j’ai enfin le courage et l’envie d’ouvrir cette brèche que je sens nécessaire à mon bonheur, c’est avec toi que j’aimerais l’explorer pas à pas, comme un voyage intérieur. Vers la lumière.
09/03/2021 | Lien permanent
Ce que les autres n'ont pas lu.
C’est en lui tenant la porte du restaurant qu’il comprit qu’il ne pourrait faire que rechuter. Cette petite Havane au cœur du vieux Lille, ils y étaient pourtant passés le premier jour de leur rencontre, mais au sein d’un groupe qui avait dilué le quelque chose qui s’était éveillé dans son regard à elle, sa mémoire à lui. Comme pour toutes les rencontres, la genèse avait été anodine, une question posée, une réponse qui ne convient pas, une émulation qui commence. Elle avait l’incongruité des filles du Sud arrivant dans le Nord pour constater les quinze degrés perdus, et le pull enroulé autour du cou semblait ne pas suffire puisqu’elle le relevait jusque dans la partie basse du visage. Il s’est amusé de ne savoir d’elle que ce qu’elle avançait bruyamment, sous l’effet grégaire, étonné par son culot, la facilité avec laquelle elle riait de tout. Il n’en croyait rien et de ce chiasme naquit le trouble. Quand elle riait, elle avait un petit mouvement d’épaules moqueur qui lui faisait croire qu’elle voulait danser : le són de Cuba provoque cet effet. Il n’avait que son regard à opposer à sa jeunesse moqueuse, qui pouvait à tout moment lui signifier qu’elle s’ennuyait! Alors il ne cesserait plus de la regarder, de s’imprégner de son image. C’est toute l’âme de la Habana qu’il sollicitait, ces brumes du passé de Leonardo Padura. Ce qu’il appelait, comme une santeria, c’était une perception accrue de l’instant qui se vivait. Cette femme avait accepté son invitation, il n’y avait vu que du défi, la provocation sur laquelle il n’était pas question, pour elle, de reculer d’un pouce. Lui-même s’était organisé pour pouvoir retrouver les autres, regagner en neutralité, enfouir dans le collectif ce qui pouvait apparaître comme une anomalie.
Elle parlait de son fils avec un tel amour qu’il jalousa l’homme avec lequel elle l’avait eu et d’avec qui elle était séparée. Il avait eu d’elle une exclusivité, incarnée, sur l’instant, il s’était vu lui demander la même marque d’éternité. La suite naturelle des frôlements qu’il recherchait. Elle touchait, caressait, frappait ou pinçait, au détour d’une remarque déstabilisante, revenait à ses mouvements d’épaule et de tête et lançait, entre deux plissements moqueurs, un regard qui lui venait du plus profond. Là où il était venu la chercher, là où elle avait accepté de le suivre.
Ils s’étaient, la veille, provoqué sur des chansons de variétés qu’on écoute à l’adolescence, persuadé qu’elles ont été écrites pour nous. Elle n’avait pas cédé face à sa mémoire et aux pièges qu’il lui tendait, à l’amener vers des chansons qu’elle avait sans doute écoutées en pleurant. Ses yeux dissimulaient mal les picotements qui la prenaient et les bulles du mojito ne pouvaient pas tout expliquer. Peut-être aurait-elle voulu le rencontrer avant, pour qu’il la protège. Ou peut-être lui rappelait-il l’homme qu’elle avait perdu parce qu’elle n’avait jamais pensé qu’elle pût le perdre.
Ils étaient installés dans un coin discret du restaurant qui contrastait avec la table ronde et centrale qu’ils avaient occupée l’autre jour avec le groupe. Comme il parlait aussi bas qu’elle s’amusait à parler fort, il fallait qu’elle se penche sur lui, comme si elle allait l’embrasser. Parfois, le battement de sa poitrine, à travers le tricot noir, disait l’inverse des légèretés avancées quand il l’emmenait sur des terrains glissants. Quelque chose dans la situation l’attirait. Ce qui se passait ici n’aurait aucune incidence sur l’avenir, elle ne reverrait jamais ce type qui s’intéressait à elle. Pour une fois, elle n’avait pas envie de se poser ce type de questions. Il l’avait invitée alors que le groupe rentrait. Quand il a annoncé qu’il l’invitait seule, elle ne s’est pas défilée : la boutade est devenue projet, puis rendez-vous, au grand dam des autres. La petite Havane s’est imposée à la pause du lendemain. Toute la journée, il l’avait fixée dans son travail, discrètement, captant de temps en temps son regard, s’était amusé à la provoquer sur l’appellation ex- mari : il voulait dire qu’un ex est encore une part de soi. Elle avait dû s’expliquer de l’admiration qu’elle lui maintenait, sans dire que cette admiration-là, elle lui avait fait payer au centuple. En libertine, avait-elle rétorqué, histoire que le rouge lui monte aux joues.
Elle aimait danser et dansait bien. Ses hanches l’avaient entraîné dans un tourbillon dont son regard ne saurait le tirer ; il rendait grâce en essayant de la suivre. Quand il reprenait pied, il la plaquait contre sa poitrine et rattrapait une partie des pas perdus. Ces moments-là les laissaient exsangues, elle était belle, charnelle, adaptée ; tout le ramenait à son état de décalage. Maladjusted, disait-il de lui.. Son corps à elle marquait et le rythme et l’impatience qu’elle éprouvait à communiquer. Ils avançaient doucement sur le récit de leurs existences. Qui lança la tirade de Perdican ? Lui, en associant l’orgueil et l’ennui des êtres factices? Elle, en la reprenant mot pour mot ? Alors qu’elle récitait la tirade, il lui prit la main, comme dans un geste d’encouragement. Elle ne se déroba pas, concentrée sur les mots qui - dans l’ambiance tamisée d’un restaurant cubain - n’avaient plus la moindre espèce de signification. Dans son esprit, à cet instant, le baiser s’imposait : un baiser hors du temps et des contingences, pour dire que leur entité existait. Les moments, il faut savoir les saisir. Lui aurait tout donné pour la volupté d’un baiser d’elle. La prendre dans ses bras, sentir son souffle. Il connaissait bien l’abandon , ses douleurs, ses déséquilibres. L’avoir pour lui n’était pas envisageable. Est-ce pour ça que, alors qu’il lui tenait la main, il ne fit, à la fin de la tirade, que déposer un baiser sur le bout des doigts ? Le silence s’était fait mais il n’avait pas lâché sa main : elle la retira doucement et d’une voix plus fragile que jamais, susurra:
- J’ai envie qu’on se promène, tu veux bien ?
Le vieux Lille est sibyllin dans la façon qu’il a de s’ouvrir sur des ruelles sinueuses autant sur de larges places. Il pensa au sens du mot déambuler : marcher en espérant que la promenade ne cesse jamais. Déjà emmitouflée dans l’unique pull dont elle s’était munie, elle sollicita son bras puis son épaule protectrice. Elle réglait son pas sur ceux du contemplatif qui délaissait les façades flamandes pour qu’elle se sente en confiance, comprenne au toucher que le regard n’annonçait que du beau et du doux. Quand il lui montra une coupole hindoue côtoyant un créneau médiéval, elle lova sa tête contre le creux de son épaule, il continua ses explications. Tout convergeait vers le point symbolique mais s’il n’avait pas franchi l’étape dans le restaurant cubain, il ne le franchirait pas plus maintenant. Il saurait ne pas l’embrasser, encore. Dans le froid saisissant, elle avait besoin de lui. Elle ne l’écoutait pas, mais elle était bien : elle aurait bien passé la nuit contre son corps massif. Une nuit sans faire l’amour, pour mieux le faire au matin. Ils prirent un taxi, elle s’endormit contre lui, fatiguée par les poids cumulés des nuits précédentes, des journées de travail et de ses émotions. De temps en temps, elle remontait son pull sur sa joue, s’en servait comme oreiller entre sa tempe à elle et sa poitrine à lui. Il massait son épaule et la base de son cou. N’importe qui, à cet instant, les aurait pris pour des amants : ça lui suffisait, rien, dans la réalité, ne pouvait égaler un tel instant. Elle avait, parfois, de petits soubresauts, se recalait dans la courbe de son corps, cherchait à quoi se raccrocher, et se rendormait, rassérénée.
« C’est triste de ne pas savoir aimer ». Elle avait fait cette réflexion en insistant, comme si elle la lui avait destinée. Elle l’habitait, alors qu’il la ramenait vers sa chambre. Savait-on aimer avant d’aimer ? L’amour est-il décelable par celui qui le ressent ou doit-il s’y brûler avant de dire que l’amour qu’il ressent, c’est de l’amour ? Qu’avait-elle vécu qui la ramène à cette tristesse ? Se plaignait-elle de n’avoir pas su aimer, ou qu’on n’ait pas su l’aimer ? Il ne pouvait la questionner: il avait dû la réveiller. Sa vulnérabilité le toucha doublement ; si elle s’était départie de son assurance, c’est parce qu’elle s’était sentie en confiance. Savoir aimer, c’était peut-être ne rien faire qui dénature le désir. Maintenir l’envie quand sa réalisation la pervertirait. Dom Juan souffre de ne pas aimer assez, parce que l’amour qu’il porte est à une hauteur à laquelle l’autre ne peut accéder. Le libertinage, elle en souffrait maintenant que celui qu’elle avait aimé en usait. Son corps cédait à l’endormissement, à moins qu’il ne s’agît d’une ruse pour qu’il la soutienne encore. Leurs pas crissaient sur les graviers du centre, peut-être les entendrait-on, nourriraient-ils la rumeur? Ils passèrent devant l’entrée de son bâtiment à lui, elle marqua une hésitation, comme si elle lui donnait le choix : continuer avec elle ou arrêter là. Elle se défit de son étreinte et se mit au travers de son chemin. Il caressa sa chevelure déliée, la prit dans ses bras et alla, sans qu’elle s’en défende, déposer un premier baiser dans son cou, puis un second à la commissure des lèvres. Elle se pencha pour le regarder, l’enserra de ses bras et alla s’enfouir de nouveau. Ils restèrent longtemps comme ça, au pied de son bâtiment, à une encablure de sa chambre d’étudiant. Il lui offrait ses bras sans qu’elle ait à expliquer qu’elle n’était pas seule, dans la vraie vie, qu’elle cherchait juste un répit.
Ils étaient là, dans le silence. Le baiser qu’il lui avait donné, c’était celui que l’instant appelait ; ils n’étaient plus des adolescents, n’avaient plus personne à qui demander l’autorisation. Ils allaient faire l’amour dans cette chambre d’étudiant, se quitteraient au matin, vivraient leur retour bercés d’images, elle redescendrait vers le midi, lui aussi, en s’arrêtant plus tôt, seulement. Ils marchaient dans l’obscurité du couloir, en attente. Peut-être ne se quitteraient-ils pas, iraient-ils jusqu’à tout bouleverser? La 403, déjà. Elle ouvre la porte, sans le regarder. Il est derrière elle, perçoit les petits mouvements de tête nerveux. Il ne sait pas s’il la désire plus qu’il en est fier. D’avoir été avec elle sans avoir pensé la posséder. Elle lui tourne encore le dos, une seconde peut-être, elle balaie sa chambre du regard, doit décider là si elle le laisse entrer ou pas. Il ne perçoit, derrière elle, que les vêtements qu’elle a rangés sur le dossier de la chaise. La veille, elle était en baskets roses, pratiques pour marcher et prévenir du froid ; ce soir, elle s’était faite femme, talons, robe noire à bustier. Elle pourrait se rappeler, des années après, qu’elle a revêtu cette robe parce qu’un inconnu l’a invitée à dîner. Dans l’intention de faire l’amour avec elle ? Qu’allait-il faire qui ne pût ni la blesser ni la décevoir ? Elle se retourna, toujours sur le seuil de la porte. Il vit à la seconde qu’elle se demandait s’il fallait le faire, ce fut suffisant pour que l’impulsion définisse l’action : il passa ses mains autour de son cou, appuya son front contre le sien, dégagea les cheveux qui masquaient son regard. Il se pencha vers son oreille, approcha ses lèvres et, au moment même où elle crut qu’il allait l’embrasser, où elle aurait accepté que l’instant l’emporte, il se mit, dans un murmure, à chantonner une chanson. Au premier Ciao Bella, elle ne put réfréner une larme ; à les autres on s’en fout, elle l’entoura de ses bras, sans rien chercher d’autre qu’il continue. Au dernier tu manques à ma vie, elle sut qu’elle n’oublierait jamais sa voix. C’est juste là, qu’il déposa un baiser sur le bord de ses lèvres, la fit reculer de quelques pas sans la quitter des yeux et referma la porte sur elle, sans bruit.
Extrait de "la 3e jouissance du Gros Robert", 2013, Editions Raison & Passions.
02/01/2014 | Lien permanent
Opus Deuce

Jolie balade musicale cet après-midi avec les Deuce en studio. Deuce, le groupe de l'Inoxydable, l'épistémologue de la scène rock lyonnaise et au-delà. Jour des prises de voix, ça tombait bien. A la Casa musicale, l'élévation est telle qu'on trouve en haut celui qui va pousser la chansonnette et en contrebas les manants de la technique, néanmoins aux manettes... Le choeur est en haut, alors et les conseils du directeur artistique sont fermes et délicats: il s'agit d'aller chercher le coffre, pas la gorge. Quand on enregistre en studio, fût-ce pour soi, on se trouve en face d'une opération délicate, celle d'arrêter le temps. Si j'osais reprendre une expression déjà ancrée elle-même dans le marbre d'une quatrième de couverture, comme si le temps lui-même avait le culot de s'arrêter. Quand il chante "le pays du Roi de rien", quand il trouve un ton soudain grave dans "Démobilisé" (Tout m'indiffère dans les journaux, la radio, la télé", belle antiphrase), il doit chercher l'intention davantage que la sonorité. Sous l'égide très personnelle d'un Freddy Mercury aux Ray-Ban dantesques, l'Inox reprend, il ne lève pas toujours les bras pour que l'air emplisse ses poumons. Le directeur artistique l'assiste en haut, ils mènent un étrange ballet tous les deux, l'un chante et l'autre est chargé de saisir si l'estomac est dans les vibrations. Qu'il capte parfois à même le sol, en s'agenouillant. Le reste sera une question de mixage, de mastering, un juste condensé des oreilles qui écoutent, en bas. C'est une belle expérience, à la fois similaire à ce que j'ai déjà vécu avec Eric Hostettler mais différente aussi par son abord, celui du groupe. J'ai l'agréable honneur d'entendre la prise de "Je connais mes limites", ma petite participation à l'exercice: il aura fallu ce temps pour que nos univers se rencontrent et, ma foi, ça m'a l'air plutôt réussi. J'aurai donc fait un petit peu plus pour les Deuce que de préparer les mojitos pris sous la verrière, dans ce bel endroit qu'est la Casa. C'est toujours un peu intrigant de pénétrer une famille en pleine préparation des noces à venir. J'en écrirai un peu plus quand l'opus sera là. Il sera temps alors de faire entrer l'Inoxydable dans mes portraits de mémoire, ceux des musiciens, après les écrivains. D'ici là, dès lundi, j'aurai entrepris cet exercice de réécriture dont je feins d'ignorer qu'il sera sans nul doute le plus éprouvant que j'aurai jamais connu.
07/04/2010 | Lien permanent
Mme Bovary à l'Arbresle.
 Ce n'est pas très charitable, j'avoue, mais pas plus que de me planter après deux fois deux heures de jérémiades et une histoire genre Mme Bovary à l'Arbresle, dont elle était convaincue, néanmoins, qu'elle intéresserait tout le monde. Je suis un peu en colère contre cette partie du genre humain qui pense pouvoir disposer des services de l'autre quand bon leur semble, et cesser toute collaboration pour des raisons absconses. Ce n'est pas une première pour moi, en cette année d'expérimentation: c'est la 2ème fois que ça se passe, si je ne compte pas les choix hasardeux faits par d'autres. Et ça me gave. Voici donc, en exclusivité mondiale, mon 2ème Marc Lévy, après l'essai que j'ai fait la dernière fois. J'y ai mis tout mon talent, et il en faut, pour raconter une telle ineptie. Vous comprendrez néanmoins que ça ne figure pas dans mon recueil de nouvelles à paraître.
Ce n'est pas très charitable, j'avoue, mais pas plus que de me planter après deux fois deux heures de jérémiades et une histoire genre Mme Bovary à l'Arbresle, dont elle était convaincue, néanmoins, qu'elle intéresserait tout le monde. Je suis un peu en colère contre cette partie du genre humain qui pense pouvoir disposer des services de l'autre quand bon leur semble, et cesser toute collaboration pour des raisons absconses. Ce n'est pas une première pour moi, en cette année d'expérimentation: c'est la 2ème fois que ça se passe, si je ne compte pas les choix hasardeux faits par d'autres. Et ça me gave. Voici donc, en exclusivité mondiale, mon 2ème Marc Lévy, après l'essai que j'ai fait la dernière fois. J'y ai mis tout mon talent, et il en faut, pour raconter une telle ineptie. Vous comprendrez néanmoins que ça ne figure pas dans mon recueil de nouvelles à paraître.
Je ne savais même pas que ça pouvait exister, un tel bonheur. Ni même que j’aurais été capable de faire ce que j’avais fait pour être là à cet instant précis. Quand je suis rentrée sur la piste de danse avec Carole et Sylvie, dont nous venions de faire la connaissance, je m’étais déjà promis que cette semaine durerait toute une semaine et que j’en savourerais la moindre seconde. Impossible, du coup, d’aller dormir, même si nous avions passé la nuit dans l’avion et que le retard accumulé à l’aéroport et dans le transfert jusqu’à Hammamet nous avait laissé épuisées, dans l’hôtel où enfin je réalisais mon rêve. Un rêve de voyage, d’exotisme, d’aventure, le contraire de la vie que j’avais laissée là-bas, en France, où m’attendaient déjà des êtres que j’avais pris pour ma famille depuis tellement d’années. Une famille, nous dit-on dès l’enfance, c’est un socle, quelque chose sur lequel on s’appuie et sur qui on peut compter, toujours. Je ne savais pas, en entrant sur la piste de danse, que la mienne me rejetterait parce que j’avais osé, à quarante ans passés, vouloir devenir celle que je pensais être, pas celle à laquelle on me limitait. On, un mari, des enfants, des amis. Un mari, pour l’état civil, oui : pas un amant, même pas un compagnon. Jamais de marques de tendresse, jamais d’attention : on ne garde pas une femme comme ça, mais je ne le savais pas. On ne me l’avait jamais appris. Des enfants, deux filles, deux merveilles, l’une le portrait de son père, l’autre le mien. Des filles, ma chair, dont je ne savais pas non plus qu’elles prendraient parti, et violemment, contre moi qui leur ai tout donné. Qui devrai attendre qu’elles soient femmes pour comprendre un minimum.
Ce lundi 8 novembre, je ne savais pas encore que j’allais renaître à moi-même en te voyant. Que ton badge blanc sur ta tenue noir ancrerait en mon être et en ma mémoire les deux syllabes de ton prénom. Tu es venu vers moi comme dans un rêve oriental, de ceux dont je pensais qu’ils ne m’étaient pas permis et tu m’as dit qu’une femme aussi belle que moi ne pouvait qu’être accompagnée. Les mots simples de la séduction, mais tu ne savais pas qu’à moi, c’était la première fois qu’on les disait. Et qu’ils ont fait du bien à mon âme autant qu’ils ont bouleversé mon corps. Dans la bijouterie où j’ai travaillé, l’autre Carole m’avait pourtant raconté les mots doux, les élans du corps qu’ils avaient maintenus malgré les années qui passaient. Je lui avais confié que je détestais être touchée - sans rien lui dire de ce que l’enfance m’avait réservé - que tout cela nous arrangeait, mon mari et moi, elle m’avait confié avec un air coquin que je n’avais sans doute pas le bon professeur pour cela… J’en étais à me demander si Dieu ne m’avait pas oubliée dans sa distribution des belles choses quand je t’ai aperçu et que tu es venu vers moi. Qu’avec une douce insistance tu as obtenu de moi ce que tu avais obtenu de mes amies, vers qui je t’ai d’abord envoyé : que tu me tiennes la taille, que tu me fasses tourner, que je ressente dans tous mes pores les vibrations de ta musique, celle de ta culture. Que je ressente ta force et ta douleur mêlés, celles que je retrouverai après, dans la chambre, quand tu m’as redonné vie en me faisant l’amour comme jamais on ne me l’avait fait. Je dansais, comme j’avais toujours aimé le faire, mais je n’étais plus seule. Dans ma vie d’avant toi, pour danser, il fallait que j’organise la sortie, que je rameute les amis du « couple » : on vantait mes qualités d’animatrice, mon énergie, mais on ne se doutait pas qu’à l’intérieur, je mourais, déjà, de cet empêchement, de ce manque d’amour. Qui fait que les vies, parfois, passent sans qu’on les vive. C’est tout cela qu’a fait remonter, en une seconde, ton badge blanc sur ta tunique noire d’animateur, mon amour. Tout cela qui a fait que quand Carole et Sylvie, exténuées, m’ont dit qu’elles allaient se coucher, la première, mon amie, la seule à savoir qui j’étais ailleurs, m’a dit que j’étais grande, que je savais ce que je faisais. Carole qui, en arrivant, m’a dit qu’elles allaient parcourir le pays plutôt que de rester dans des hammams qu’elles pourraient trouver en France. « Tu es grande, tu sais ce que tu fais », chez Carole, que j’admirais pour son indépendance, ça avait valeur d’accord. Ce fut le déclenchement. On s’est retrouvé seuls sur la piste, tes bras se sont serrés un peu plus, tu m’as enserrée, envoutée, je me sentais fondre comme jamais je ne l’avais fait. Quand tes lèvres se sont approchées des miennes, je n’entendais plus rien de ce que tu me disais. Je savais juste que c’était là, à cet instant précis, que ma vie allait prendre son envol, après s’être tellement manquée. Je n’avais plus d’autres repères que celui de tes mains qui me caressaient le dos. Il n’y avait plus rien, ailleurs qu’ici et maintenant : plus d’époux, plus d’enfants, plus cette ville médiocre qui ne me définissait pas. C’est toujours à l’aune de l’intensité qu’on mesure le temps qu’on a perdu. Sur cette piste, dans tes bras, je me suis jurée alors que plus rien de ce que j’avais envie de vivre ne m’échapperait. Qu’aucune mer, aucun continent ne m’empêcherait de te voir, de t’aimer et enfin, enfin, me sentir vivante. Absolument.
04/06/2012 | Lien permanent
Au bon plaisir de la gargouille.
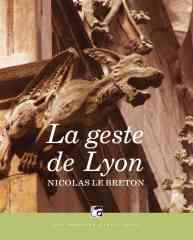 J’ai mis du temps (l’été) pour terminer, entre deux lectures, la trilogie romanesque de Nicolas le Breton, « la Geste de Lyon », un recueil de trois polars médiévaux, dont l’appellation elle-même prête à confusion – et donc à éclaircissement, en préface. Ces romans historiques, « le maître des gargouilles », « le seigneur des corbeaux » et « le prince des ours » ne font appel à nulle heroic-fantasy ni chevalier de quelque engeance, mais dépeignent , très précisément – l’auteur est guide de tourisme – les différentes strates au pouvoir à Lyon, au XIV° siècle, dans le bas d’un Moyen-Age dont les coutumes restent, quand elles servent les manigances des grandes familles qui s’entre-déchirent : c’est là que, nonobstant la difficulté première d’assimiler les titres hiérarchiques du clergé ou de la noblesse, on sourit de retrouver des noms qui sont, de nos jours encore, des quartiers de notre ville, à commencer par Grolée – le personnage principal – Ainay, et en continuant, par extension, aux communes proches, Montluel, Saint-Priest ou d’Anthon. L’intrigue mêle les forces du Roi de France, en lutte contre celles du Comte de Savoie pour la conquête de la ville : meurtres maquillés en crimes sataniques, procès en sorcellerie, Nicolas Le Breton reconstitue dans les trois récits une geste qui restitue une époque dont on n’a gardé qu’une mythologie. Il y fait référence, ponctuellement, quand on fait allusion à Lancelot et à la charrette d’infamie, mais pour mieux s’en éloigner, par le cynisme affiché de ses personnages face à l’ignorance généralisée de leur époque : Anselmus, fameuse figure du nain retors, mais pugnace, Guillaume Bâtard et Barthélémy Chevrier luttent chacun, d’une manière différente, contre les simulacres de justices et les diverses Inquisitions : on y croise Bernard Guidoni et Bernard Gui, qui décrètent du veneficium à tour de bras (séculier) pour disposer du pouvoir. Les Templiers sont condamnés, traqués, exécutés (Memento Moris !) comme pour signifier que l’âge preux et courtois est terminé et qu’il est l’heure des stratégies d’alcôves : dans cette trilogie, les Papes se succèdent (Innocent IV, Clément V, Grégoire X*, peut-être ?) mais n’ont d’autorité que de façade, les magistrats les plus respectés sollicitent, dans les bas-fonds de la ville, les criminels les plus sordides, des prostituées juives qu’ils convertissent ou des dresseurs d’ours. Nicolas Le Breton conduit ses personnages dans une action prenante, parce qu’on savoure les stratégies politiques, sans s’empêcher de penser que quelque chose, à Lyon, est resté en l’état… On passe d’une porte à une autre, d’une maison (de Savoie) à celle de Roanne, on suit les fleuves, les traboules, les ruelles, on se retrouve rue Mercière, au Pont du Change ou à St-Nizier, en quête de pots de saindoux empoisonné… Nicolas Le Breton maîtrise le passé simple et semble accélerer la narration quand le piège de l’épistémologie se dessine : les dialogues sont ciselés, les personnages profonds, jusqu’à la deuxième génération, avec Jacelme et Peronin, le lyrisme n’est pas dans l’action mais dans ce qu’elle recèle : on devine à travers les complots qu’elle défait le caractère prégnant de la ville, en « grand animal trop piqué, trop blessé », qui se redresse. Quel que soit son gardiateur. Au final, on laisse ces personnages à regret, avec une persistance qui vous fait guetter les détours de rue de votre ville autrement que vous les regardiez avant. Et s’asseoir sur les bancs de marbre à l’entrée de la cathédrale en pensant à ceux qui s’y sont assis avant nous, regarder les gargouilles et voir se profiler l’ombre de Hiéronymus. Moins assotis qu’on l’était en arrivant. Mais conscients, nous aussi, que la vie était là.
J’ai mis du temps (l’été) pour terminer, entre deux lectures, la trilogie romanesque de Nicolas le Breton, « la Geste de Lyon », un recueil de trois polars médiévaux, dont l’appellation elle-même prête à confusion – et donc à éclaircissement, en préface. Ces romans historiques, « le maître des gargouilles », « le seigneur des corbeaux » et « le prince des ours » ne font appel à nulle heroic-fantasy ni chevalier de quelque engeance, mais dépeignent , très précisément – l’auteur est guide de tourisme – les différentes strates au pouvoir à Lyon, au XIV° siècle, dans le bas d’un Moyen-Age dont les coutumes restent, quand elles servent les manigances des grandes familles qui s’entre-déchirent : c’est là que, nonobstant la difficulté première d’assimiler les titres hiérarchiques du clergé ou de la noblesse, on sourit de retrouver des noms qui sont, de nos jours encore, des quartiers de notre ville, à commencer par Grolée – le personnage principal – Ainay, et en continuant, par extension, aux communes proches, Montluel, Saint-Priest ou d’Anthon. L’intrigue mêle les forces du Roi de France, en lutte contre celles du Comte de Savoie pour la conquête de la ville : meurtres maquillés en crimes sataniques, procès en sorcellerie, Nicolas Le Breton reconstitue dans les trois récits une geste qui restitue une époque dont on n’a gardé qu’une mythologie. Il y fait référence, ponctuellement, quand on fait allusion à Lancelot et à la charrette d’infamie, mais pour mieux s’en éloigner, par le cynisme affiché de ses personnages face à l’ignorance généralisée de leur époque : Anselmus, fameuse figure du nain retors, mais pugnace, Guillaume Bâtard et Barthélémy Chevrier luttent chacun, d’une manière différente, contre les simulacres de justices et les diverses Inquisitions : on y croise Bernard Guidoni et Bernard Gui, qui décrètent du veneficium à tour de bras (séculier) pour disposer du pouvoir. Les Templiers sont condamnés, traqués, exécutés (Memento Moris !) comme pour signifier que l’âge preux et courtois est terminé et qu’il est l’heure des stratégies d’alcôves : dans cette trilogie, les Papes se succèdent (Innocent IV, Clément V, Grégoire X*, peut-être ?) mais n’ont d’autorité que de façade, les magistrats les plus respectés sollicitent, dans les bas-fonds de la ville, les criminels les plus sordides, des prostituées juives qu’ils convertissent ou des dresseurs d’ours. Nicolas Le Breton conduit ses personnages dans une action prenante, parce qu’on savoure les stratégies politiques, sans s’empêcher de penser que quelque chose, à Lyon, est resté en l’état… On passe d’une porte à une autre, d’une maison (de Savoie) à celle de Roanne, on suit les fleuves, les traboules, les ruelles, on se retrouve rue Mercière, au Pont du Change ou à St-Nizier, en quête de pots de saindoux empoisonné… Nicolas Le Breton maîtrise le passé simple et semble accélerer la narration quand le piège de l’épistémologie se dessine : les dialogues sont ciselés, les personnages profonds, jusqu’à la deuxième génération, avec Jacelme et Peronin, le lyrisme n’est pas dans l’action mais dans ce qu’elle recèle : on devine à travers les complots qu’elle défait le caractère prégnant de la ville, en « grand animal trop piqué, trop blessé », qui se redresse. Quel que soit son gardiateur. Au final, on laisse ces personnages à regret, avec une persistance qui vous fait guetter les détours de rue de votre ville autrement que vous les regardiez avant. Et s’asseoir sur les bancs de marbre à l’entrée de la cathédrale en pensant à ceux qui s’y sont assis avant nous, regarder les gargouilles et voir se profiler l’ombre de Hiéronymus. Moins assotis qu’on l’était en arrivant. Mais conscients, nous aussi, que la vie était là.
* Et pas XIII, comme me l'a soufflé l'Inoxydable, même je positionne le XIII comme mon pape préféré, puisqu’il a fait suivre, inter gravissimas, le 4 octobre du 15, en 1582, validant ainsi mon rapport relatif au temps qui passe.
17/10/2013 | Lien permanent
C'est qui, ce Baudelaire?
 Un très bon moment, hier, à l’espace Baudelaire de Rillieux-la-pape où, à l’invitation de Cécile Dérioz et de Marie-Claude Douot, je suis venu présenter « le Poignet d’Alain Larrouquis ». Enfin, plus exactement, l’ensemble de mon œuvre, tant il fut autant question, in fine, des deux autres romans que du dernier. Parce que quand Cécile Dérioz me présente, elle raconte à quel point « Tébessa, 1956 », que j’aurais dû présenter là-bas en 2008, déjà, les a marqués, elle et tous ceux à qui elle l’a fait lire. Elle me présente via mon activité, ce qui a toujours, sans coquetterie, tendance à m’impressionner et confie à l’auditoire (une trentaine de personnes quand même) le plaisir d’accueillir et de découvrir des auteurs « pas encore célèbres ». Je note l’euphémisme et en souris, j’attends le moment – s’il se confirme – de mon entrée dans les manuels scolaires pour me confronter de mon vivant à ma propre postérité. Ces charmantes responsables de l’Espace Baudelaire sont bienveillantes, mais timides et peu bavardes, ce qui fait que rapidement, on me confie le micro et on me laisse me débrouiller seul. J’avoue que je ne sais pas forcément toujours pas quoi commencer, je reste debout, adossé à la table, je prends l’auditoire à la gorge comme il m’arrive de le faire dans d’autres domaines et voilà que je parle de moi. Justement pour chasser le narcissisme, l’autofictionnel. Je parle de la proximité des romans, de la maldonne qu’elle peut entraîner chez ceux qui me découvrent, de mon entrée dans l’édition, de la fameuse lettre de Claude Raisky. De Lettres-frontière passé, de Grignan à venir. Je confie à des lecteurs la fierté d’être reconnu par eux, avant d’être reconnu tout court. Je parle des thèmes du Larrouquis, de l’identification, de la distance du tireur, de l’Espagne, de Somosierra. Je regarde ces visages à l’air intéressé, pense en moi-même que j’y prends goût, une semaine après le Cabaret Poétique, que ma vie est là et que eux n’en doutent pas. Pas comme la société, je veux dire. Je parle d’une vie d’écriture qui est la mienne et leur attention la valide. Après un premier temps où l’on n’ose sans doute pas m’interrompre, on m’interroge sur la portée historique de Tébessa, je retrouve les questions qu’on m’a posées en 2009, j’y réponds. Par la mécanique des places, par l’écriture simplifiée. Je parle pour la première fois publiquement des portraits de mémoire, j’en vois dans l’assemblée qui sourient parce qu’ils en font partie. Un monsieur très cultivé – qui viendra par la suite me parler de la métrique des chansons – me demande si l’actualité pourrait inspirer le romancier que je suis, je lui réponds en philosophe, arguant du fait que mon engagement à moi est esthétique mais qu’on peut poser des problématiques actuelles en écrivant un dialogue de 1906. Aurélia, donc. Pour la première fois aussi, je ne respecte pas la dissociation en évoquant mon autre métier pour répondre à une question sur la nécessité d’avoir fait des études de Lettres pour écrire. Ce qui est évidemment faux, sauf, peut-être, pour boucler un Dom Juan en vers en une quinzaine de jours… Bref, je m’amuse bien, je crois tenir l’auditoire, il est donc temps de le lâcher. Je présente la partie musicale du projet, mon travail d’auteur au sens large, raconte un peu la genèse et laisse la place à Eric et Gérard, dont les répétitions le matin même m’avaient enchanté, pendant que je repassais ma chemise dans la pièce à côté. Quelques pains, pour reprendre un terme du milieu, un dobro peut-être pas assez fort, un ou deux oublis de texte (Eric confiera la difficulté d’entrer tout de suite dans le sujet, après une heure d’écoute de l’autre), mais la magie opère, je crois. La relation entre eux est palpable, en tout cas, je ne m’en lasse pas. C’est sublime et touchant d’entendre ces chansons dans des lieux aussi inédits pour le genre. « Au-dessus des eaux et des plaines » fait donc son retour, comme annoncé, je sais aussi qu’elle clôt la rencontre à chaque fois. Nous nous quittons à regret, après une séance de dédicaces finalement assez nourrie, des retrouvailles avec de vieux amis de trente ans, d’autres qui s’annoncent par des démarches singulières, je signe autant de T. ou de CC que de PAL (vous notez l’aspect pratique de mes titres ?), je regarde des gens partir avec tout Cachard sous le bras et, plus tard, dans leur vie. Cécile Dérioz m’a appris hier qu’un enseignant de collège avait choisi Tébessa pour travailler avec ses 3èmes et qu’une rencontre serait bientôt organisée avec les classes. Il ne me fallait pas moins que l’assurance de revenir pour que je puisse partir en toute tranquillité.
Un très bon moment, hier, à l’espace Baudelaire de Rillieux-la-pape où, à l’invitation de Cécile Dérioz et de Marie-Claude Douot, je suis venu présenter « le Poignet d’Alain Larrouquis ». Enfin, plus exactement, l’ensemble de mon œuvre, tant il fut autant question, in fine, des deux autres romans que du dernier. Parce que quand Cécile Dérioz me présente, elle raconte à quel point « Tébessa, 1956 », que j’aurais dû présenter là-bas en 2008, déjà, les a marqués, elle et tous ceux à qui elle l’a fait lire. Elle me présente via mon activité, ce qui a toujours, sans coquetterie, tendance à m’impressionner et confie à l’auditoire (une trentaine de personnes quand même) le plaisir d’accueillir et de découvrir des auteurs « pas encore célèbres ». Je note l’euphémisme et en souris, j’attends le moment – s’il se confirme – de mon entrée dans les manuels scolaires pour me confronter de mon vivant à ma propre postérité. Ces charmantes responsables de l’Espace Baudelaire sont bienveillantes, mais timides et peu bavardes, ce qui fait que rapidement, on me confie le micro et on me laisse me débrouiller seul. J’avoue que je ne sais pas forcément toujours pas quoi commencer, je reste debout, adossé à la table, je prends l’auditoire à la gorge comme il m’arrive de le faire dans d’autres domaines et voilà que je parle de moi. Justement pour chasser le narcissisme, l’autofictionnel. Je parle de la proximité des romans, de la maldonne qu’elle peut entraîner chez ceux qui me découvrent, de mon entrée dans l’édition, de la fameuse lettre de Claude Raisky. De Lettres-frontière passé, de Grignan à venir. Je confie à des lecteurs la fierté d’être reconnu par eux, avant d’être reconnu tout court. Je parle des thèmes du Larrouquis, de l’identification, de la distance du tireur, de l’Espagne, de Somosierra. Je regarde ces visages à l’air intéressé, pense en moi-même que j’y prends goût, une semaine après le Cabaret Poétique, que ma vie est là et que eux n’en doutent pas. Pas comme la société, je veux dire. Je parle d’une vie d’écriture qui est la mienne et leur attention la valide. Après un premier temps où l’on n’ose sans doute pas m’interrompre, on m’interroge sur la portée historique de Tébessa, je retrouve les questions qu’on m’a posées en 2009, j’y réponds. Par la mécanique des places, par l’écriture simplifiée. Je parle pour la première fois publiquement des portraits de mémoire, j’en vois dans l’assemblée qui sourient parce qu’ils en font partie. Un monsieur très cultivé – qui viendra par la suite me parler de la métrique des chansons – me demande si l’actualité pourrait inspirer le romancier que je suis, je lui réponds en philosophe, arguant du fait que mon engagement à moi est esthétique mais qu’on peut poser des problématiques actuelles en écrivant un dialogue de 1906. Aurélia, donc. Pour la première fois aussi, je ne respecte pas la dissociation en évoquant mon autre métier pour répondre à une question sur la nécessité d’avoir fait des études de Lettres pour écrire. Ce qui est évidemment faux, sauf, peut-être, pour boucler un Dom Juan en vers en une quinzaine de jours… Bref, je m’amuse bien, je crois tenir l’auditoire, il est donc temps de le lâcher. Je présente la partie musicale du projet, mon travail d’auteur au sens large, raconte un peu la genèse et laisse la place à Eric et Gérard, dont les répétitions le matin même m’avaient enchanté, pendant que je repassais ma chemise dans la pièce à côté. Quelques pains, pour reprendre un terme du milieu, un dobro peut-être pas assez fort, un ou deux oublis de texte (Eric confiera la difficulté d’entrer tout de suite dans le sujet, après une heure d’écoute de l’autre), mais la magie opère, je crois. La relation entre eux est palpable, en tout cas, je ne m’en lasse pas. C’est sublime et touchant d’entendre ces chansons dans des lieux aussi inédits pour le genre. « Au-dessus des eaux et des plaines » fait donc son retour, comme annoncé, je sais aussi qu’elle clôt la rencontre à chaque fois. Nous nous quittons à regret, après une séance de dédicaces finalement assez nourrie, des retrouvailles avec de vieux amis de trente ans, d’autres qui s’annoncent par des démarches singulières, je signe autant de T. ou de CC que de PAL (vous notez l’aspect pratique de mes titres ?), je regarde des gens partir avec tout Cachard sous le bras et, plus tard, dans leur vie. Cécile Dérioz m’a appris hier qu’un enseignant de collège avait choisi Tébessa pour travailler avec ses 3èmes et qu’une rencontre serait bientôt organisée avec les classes. Il ne me fallait pas moins que l’assurance de revenir pour que je puisse partir en toute tranquillité.
15/01/2012 | Lien permanent





































